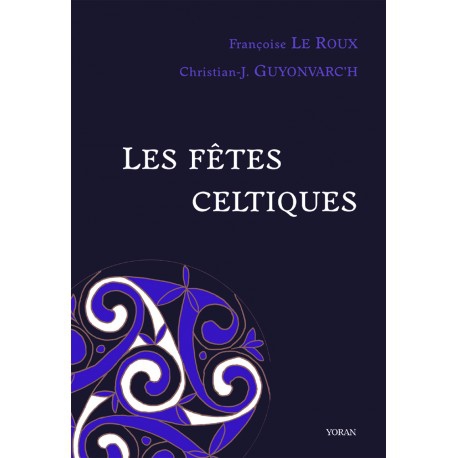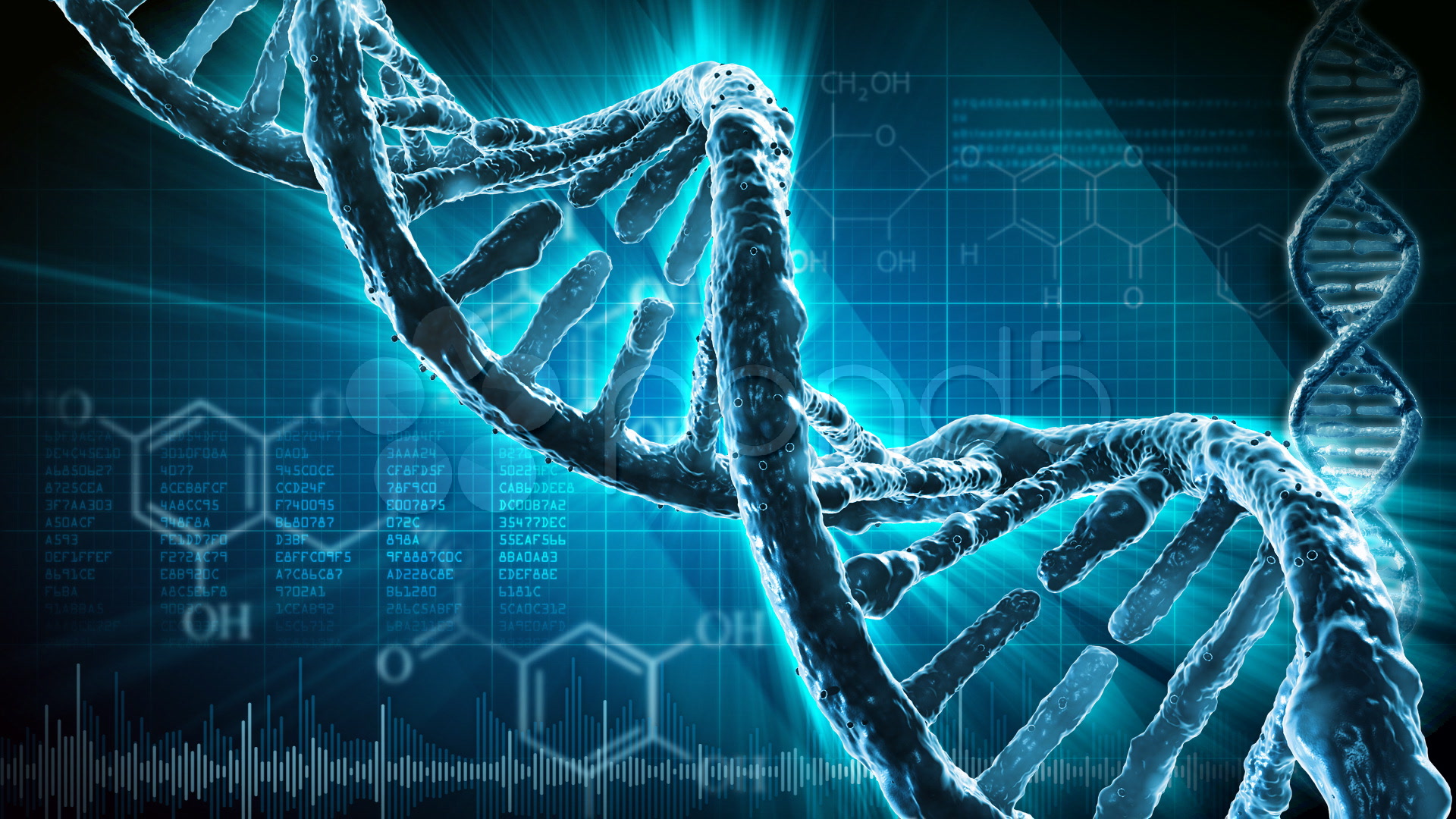« État d’urgence : quand une mesure d’exception peut devenir la norme… »
La France est en état d’urgence. Qu’est-ce que cela veut dire exactement ? Est-ce un « état normal » ou un « état d’exception » ?
Au même titre que l’état de siège (art. 36 de la Constitution) ou que les pleins pouvoirs conférés au chef de l’État (art. 16), l’état d’urgence relève de l’état d’exception. Prévu par une loi du 3 avril 1955, il n’avait été décrété qu’à deux reprises depuis la fin de la guerre d’Algérie : en 1984, en Nouvelle-Calédonie, et en 2005, pour faire face aux émeutes des banlieues. Sa caractéristique majeure est de suspendre, au nom du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif, donc sans le contrôle d’un juge, un certain nombre de libertés publiques : principe de sûreté, droit de séjour, intimité de la vie privée, liberté de la presse et de la radio, liberté de circulation, liberté d’expression, liberté d’association, de réunion, de manifestation, etc. Bref, c’est la mise en œuvre du principe de Montesquieu : « Il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté » (De l’esprit des lois). Nécessité fait loi.
Derrière l’« état d’urgence », d’autres mesures semblent se mettre en place, toutes plus liberticides les unes que les autres. Faut-il craindre un « Patriot Act » à la française ?
C’est évidemment le problème central. Dans ses Commentaires sur la société du spectacle, Guy Debord écrivait : « Les populations spectatrices ne peuvent certes pas tout savoir du terrorisme, mais elles peuvent toujours en savoir assez pour être persuadées que, par rapport à ce terrorisme, tout le reste devra leur sembler acceptable. » L’expérience montre en effet que l’opinion publique accepte volontiers la suppression des libertés quand elle est présentée comme le prix à payer pour plus de sécurité : en cas de crise, les postures martiales sont plébiscitées. La raison majeure est que la plupart des gens ont la conviction que les mesures d’exception s’appliqueront aux autres – ceux que nous combattons – mais pas à eux. Croyance en large partie illusoire.
En temps normal, la justice pénale qualifie une action passée et formule une peine pour l’avenir. En déplaçant la responsabilité vers l’intentionnalité ou la « dangerosité » (notions éminemment floues), en mettant en place une justice visant non plus à sanctionner les actes mais les intentions des suspects présumés, voire à sanctionner « toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics », le risque est grand, non seulement de criminaliser les mouvements sociaux, mais d’accélérer la mise en place d’une société de surveillance plaçant sous contrôle permanent l’ensemble des citoyens, afin de prémunir le pouvoir en place contre de possibles opposants. La vidéosurveillance, le fichage des populations, l’espionnage des particuliers, l’assimilation des pratiques contestataires à une « menace » ouvrent des perspectives qui ne sont pas rassurantes. Les mêmes dispositions qui prévoient la fermeture des sites Internet « faisant l’apologie du terrorisme », par exemple, pourraient tout aussi bien être utilisées pour en fermer d’autres tout différents – à commencer par Boulevard Voltaire.
L’expérience montre, en outre, que les textes votés en période de crise ont tendance à devenir permanents. Il y a donc de bonnes chances que les mesures prises au nom de l’état d’urgence soient conservées lorsque la menace aura disparu. L’exception deviendrait ainsi la règle. Le gouvernement, qui a déjà indiqué que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence entraîneront une « dérogation à certains droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme », veut d’ailleurs faire inscrire dans la Constitution la possible prolongation des mesures d’exception après la fin de l’état d’urgence. Cela revient à brouiller la distinction entre situation normale et situation extraordinaire, et à favoriser l’instauration d’une dictature légale permanente.
Mais entre la politique et le droit, comment fixer le statut de l’état d’exception ?
Dans ses Considérations sur le gouvernement de Pologne, Rousseau affirme que « tout État libre où les grandes crises n’ont pas été prévues est à chaque orage en danger de périr ». Mais dans le Contrat social, il disait aussi que « c’est une prévoyance très nécessaire de sentir qu’on ne peut tout prévoir ». Or, si l’on peut prévoir en théorie le cas d’exception, on ne peut en prévoir la forme. Par définition, les normes ne s’appliquent qu’à l’état normal. L’état d’exception implique donc la suspension des normes. Tout le paradoxe tient au fait qu’on peut le définir comme une suspension du droit prévue par le droit. Mais que dire d’un système juridique qui prévoit sa propre suspension ? L’état d’exception peut-il, du point de vue du droit, se réduire à une situation juridiquement qualifiée par des normes de droit ? Telles sont les questions qui ne cessent, depuis deux siècles, de susciter des débats passionnés chez les politologues et les juristes.
Que l’état d’exception implique la suspension des normes impersonnelles montre en fait que le droit n’est d’aucune utilité pour distinguer ou qualifier par avance une situation exceptionnelle. Face à l’indétermination de la règle de droit, c’est au pouvoir politique qu’il revient de trancher et de créer les conditions d’application du droit. Le politique prime ainsi le juridique : contrairement à ce que croient les tenants de l’« État de droit », le rapport de droit ne peut pas toujours se substituer au rapport de force. Carl Schmitt fait d’ailleurs de l’état d’exception (Ausnahmezustand) un critère de la souveraineté : « Est souverain celui qui décide de (ou sur) la situation d’exception. » Schmitt ajoute que c’est à partir de l’exception qu’il faut penser la règle, et non pas l’inverse. Cela ouvre des aperçus vertigineux.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 18 décembre 2015)