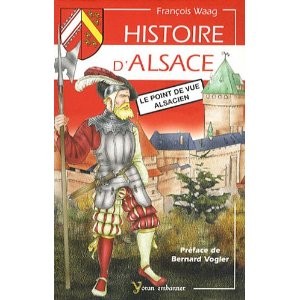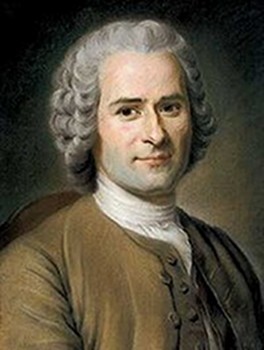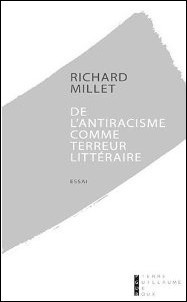Jean-Jacques Rousseau, un moderne antimoderne
Il y a tout juste un siècle, le 11 juin 1912, Maurice Barrès prononçait à la Chambre des députés un discours dans lequel il dénonçait solennellement la commémoration nationale du bicentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, auteur qu’il avait pourtant chéri et célébré dans sa jeunesse. Le Contrat social, dira-t-il plus tard, est « profondément imbécile », et son auteur un « demi-fou ». Au siècle précédent, Joseph de Maistre, pour ne citer que lui, avait déjà donné le ton en déclarant que Rousseau « ne s’exprime clairement sur rien » et que tous ses écrits sont « méprisables ». Charles Maurras, de même, n’aura de cesse de s’en prendre au « misérable Rousseau ».
Modèle même du « prince des nuées » aux yeux des contre-révolutionnaires, Rousseau ne trouvera pas non plus grâce aux yeux des libéraux, qui voient en lui l’inspirateur de la part la plus contestable de la Révolution française. Cette assimilation s’appuie sur la popularité du Contrat social auprès des révolutionnaires et sur le transfert solennel au Panthéon des cendres de son auteur, le 15 octobre 1794. Mais elle en dit plus long sur l’influence de la Révolution sur l’interprétation de Rousseau que sur l’influence de Rousseau sur la Révolution.
Les écrits autobiographiques de Rousseau, les Confessions et les Rêveries, tout comme la Nouvelle Héloïse, feront surgir d’autres critiques. Cette fois-ci, on s’en prendra à la sensibilité « féminine » et à l’«exhibitionnisme maladif » – Jules Lemaître parlait d’« affreuse sensiblerie » – de ces ouvrages, présentés tantôt comme d’inspiration romantique avant la lettre, tantôt comme vantant un « retour à la nature » suspect de « panthéisme ».
Bref, depuis deux siècles – et même trois, puisque d’innombrables manifestations nous rappellent qu’on célèbre en ce moment le tricentenaire de sa naissance –, Rousseau n’a cessé d’être convoqué au tribunal de l’histoire. Chacun s’accorde à lui reconnaître une place essentielle dans l’histoire des idées, et pourtant ceux qui tonnent contre lui, en le réduisant à des formules toutes faites (le « bon sauvage », l’« homme naturellement bon », etc.), l’ont rarement lu. La preuve en est qu’on l’assimile couramment à la philosophie des Lumières, qu’il récuse expressément.
Mais reprenons par le début. Jean-Jacques Rousseau est né à Genève le 28 juin 1712. En 1742, il monte à Paris pour présenter un système de notation musicale chiffrée à l’Académie des sciences, qui le refuse. Deux ans plus tard, après avoir été pendant quelques mois secrétaire de l’ambassadeur de France à Venise, il revient à Paris, où il commence à fréquenter les salons. C’est là qu’il rencontre les « philosophes », c’est-à-dire les Encyclopédistes. Mais il se découvre vite en opposition avec eux. Il rompt successivement avec Condillac, avec Jean le Rond d’Alembert, et même avec Diderot, l’éditeur de l’Encyclopédie, qui fut pourtant son ami. Il se montre pareillement critique envers Condorcet, D’Holbach ou Helvétius. Quant à Voltaire, il deviendra bientôt son pire ennemi.
Lorsqu’en 1749, il participe au concours ouvert par l’académie de Dijon sur le thème « Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs » (il obtiendra le premier prix), c’est pour répondre avec force par la négative. Sa conclusion est que les sciences, les lettres et les arts ont surtout contribué à la « corruption des moeurs » et que leur prétendu « progrès » s’est partout traduit par un abaissement de la morale : « Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection. » Prendre une telle position, écrit Frédéric Lefebvre, « c’était déjà se tourner contre la Cour et les salons […], le paraître plutôt que l’être […] ». C’était surtout s’en prendre radicalement à l’idéologie du progrès, qui sous-tend tout le projet des Lumières. Car, dans la querelle des Anciens et des Modernes, Rousseau se situe sans équivoque du côté des premiers.
Depuis son enfance, d’ailleurs, il admire par-dessus tout la République romaine (« A douze ans, j’étais un Romain ») et c’est à l’Antiquité qu’il se réfère tout au long de son oeuvre pour exalter la citoyenneté, la vertu antique et la patrie. « Sans cesse occupé de Rome et d’Athènes, écrira-t-il dans ses Confessions, vivant, pour ainsi dire, avec leurs grands hommes, né moi-même citoyen d’une République et fils d’un père dont l’amour de la patrie était la plus forte passion, je m’enflammais à son exemple ; je me croyais Grec ou Romain. »
Les Lumières voyaient dans le développement du commerce un moyen, non seulement d’accroître la richesse, mais aussi de faire disparaître la guerre : la négociation intéressée, profitable à tous, devait se substituer peu à peu à la confrontation armée. Rousseau dénonce au contraire la corruption et les artifices des sociétés vouées au commerce et assure qu’à l’économie de production, qui s’attache au profit et fait de l’argent le moteur de la société, il vaut mieux préférer l’économie de subsistance, qui ne consomme que ce qu’elle produit. C’est pourquoi il fait l’éloge de l’agriculture, persuadé qu’il est en outre que le goût de la terre se confond avec l’apprentissage de la patrie : « Le meilleur mobile d’un gouvernement est l’amour de la patrie, et cet amour se cultive dans les champs. »
De même, dans le grand débat sur le luxe qui agite tout le XVIIIe siècle, Rousseau s’affiche avec force comme un adversaire de la corruption engendrée par le luxe, au moment même où les « philosophes » en font bruyamment l’apologie. Le luxe « corrompt à la fois le riche et le pauvre, l’un par la possession, l’autre par la convoitise; il vend la patrie à la mollesse et à la vanité ». Sur le plan économique, il prône donc la modération : « Que nul citoyen ne soit assez opulent pour pouvoir en acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre […] Ne souffrez ni des gens opulents ni des gueux. Ces deux états, naturellement inséparables, sont également funestes au bien commun » (Du contrat social).
S’opposant frontalement à la thèse de Bernard Mandeville (la Fable des abeilles, 1714), selon laquelle la recherche égoïste du profit individuel aboutit paradoxalement au bonheur de tous, Rousseau rejette l’idée d’une harmonie sociale spontanée résultant de la libre confrontation des intérêts. « Loin que l’intérêt particulier s’allie au bien général, écrit-il, ils s’excluent l’un l’autre dans l’ordre naturel des choses. » Pour lui, les échanges économiques ne réunissent les hommes qu’en les opposant. Récusant l’idée d’un fondement économique de la société, Rousseau en tient pour un fondement strictement politique et, à l’encontre des physiocrates comme des philosophes des Lumières, affirme fermement la nécessaire subordination de l’économie au politique.
Mais il est encore un autre domaine où la pensée de Rousseau s’oppose directement à celle des Lumières. C’est la question du « cosmopolitisme ». Mably affirmait que l’« amour de l’humanité » était une « vertu supérieure à l’amour de la patrie ». Turgot, Condorcet, Voltaire, Diderot se considéraient comme avant tout chargés d’«éclairer le genre humain ». Rousseau est d’un avis tout différent. A partir du premier Discours (1755), il condamne l’universalisme avec de plus en plus de netteté. Constatant que « plus le lien social s’étend, plus il se relâche », il n’hésite pas à mettre en accusation « ces prétendus cosmopolites qui, justifiant leur amour pour la patrie par leur amour pour le genre humain, se vantent d’aimer tout le monde pour avoir droit de n’aimer personne ».
Ici encore, il raisonne en théoricien du politique. Dans le Manuscrit de Genève, première version du Contrat social, il explique longuement pourquoi il ne croit pas à la possibilité d’instaurer une « société générale du genre humain ». Dans son système, la volonté générale n’est générale que pour les membres d’une même société politique ; elle est particulière pour les autres États. On connaît cette célèbre formule, énoncée dans l’Emile : « Il faut opter entre faire un homme ou un citoyen : car on ne peut faire à la fois l’un et l’autre. » Pour Rousseau, « nous ne commençons à devenir hommes qu’après avoir été citoyens » !
C’est cette conviction que la citoyenneté n’a rien à voir avec l’appartenance au genre humain qui conduit le citoyen de Genève à écrire, au début de l’Emile, ces phrases étonnantes : « Tout patriote est dur aux étrangers ; ils ne sont qu’hommes, ils ne sont rien à ses yeux. Cet inconvénient est inévitable, mais il est faible. L’essentiel est d’être bon aux gens avec qui l’on vit […] Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans leurs livres des devoirs qu’ils dédaignent de remplir autour d’eux. »
Des considérations analogues se retrouveront plus tard dans ses projets de Constitution pour la Corse et la Pologne. Aux Corses, Rousseau rappelle que « tout peuple a ou doit avoir un caractère national » et que, « s’il en manquait, il faudrait commencer par le lui donner ». Il en déduit que « le droit de cité ne pourra être donné à nul étranger sauf une seule fois en cinquante ans à un seul s’il se présente et qu’il en soit jugé digne, ou le plus digne de ceux qui se présenteront ». Aux Polonais, il explique que l’essentiel est de confirmer « une physionomie nationale qui les distinguera des autres peuples, qui les empêchera de se fondre[…] ». Il ajoute qu’à rebours de l’« exécrable proverbe » selon lequel « la patrie se trouve partout où l’on se trouve bien », il faut proclamer tout à l’inverse: Ubi patria, ibi bene.
Mais alors, comment faut-il comprendre la thématique du contrat social ? Et les « rêveries » sur l’état de nature ? L’homme « naturellement bon » ? Le point de départ du raisonnement de Rousseau tient tout entier dans ce constat que dans la société moderne l’homme est tout à la fois méchant et malheureux. « Or, comme l’écrit Pierre Manent, il n’est pas naturel à l’homme d’être méchant et malheureux. Cette société est donc contre nature. » Il importe alors savoir comment l’homme moderne a été « dénaturé. » C’est la grande préoccupation de Rousseau.
La société qu’observe Rousseau témoigne d’une aliénation généralisée, qui lui inspire les premières pages du Contrat social : « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux. » La première phrase est la plus souvent citée, mais la plus intéressante est la seconde. Rousseau ne se borne pas, en effet, à dénoncer ceux qui exercent une domination sociale, il affirme d’entrée que ceux-ci sont tout autant « esclaves » que ceux qu’ils asservissent. De façon révélatrice, et bien qu’il soit de toute évidence un adversaire des hiérarchies de l’Ancien Régime, Rousseau ne concentre donc pas ses attaques contre l’absolutisme royal. Observateur perspicace, il réalise (et en cela il est très avance sur son temps), que ce qui gouverne désormais le monde est l’« opinion ». L’opinion est une autorité sans organe, sans lieu d’exercice déterminé, mais dont l’influence se manifeste partout. Or, l’opinion, c’est d’abord l’inégalité, c’est-à-dire une distorsion pathologique des rapports sociaux.
Mais encore faut-il s’entendre sur cette critique de l’inégalité. Chez Rousseau, la valorisation de l’égalité ne se confond nullement avec l’affirmation d’une égalité en nature de tous les hommes. Elle prend plutôt la forme d’un appel à une sorte de réciprocité entre les individus assez proche du système du don et du contre-don. Loin de préconiser un égalitarisme niveleur, Rousseau souligne la nécessité de récompenser à leur juste valeur les services rendus à la patrie. Il ne veut nullement abolir toute hiérarchie, mais fonder les distinctions sociales sur l’utilité commune.
En cela, Rousseau manifeste une fois de plus tout ce qui le distingue des Lumières. Alors que ces dernières ne cessent de vanter la société civile par opposition à l’Etat, parce qu’elles estiment que la société civile permet aux individus de réaliser leur liberté en se soustrayant au pouvoir politique et en devenant chacun la source des actions qu’ils jugent les plus conformes à leurs intérêts (l’Etat n’ayant plus rien d’autre à faire que garantir cette liberté), Rousseau se livre au contraire à une critique radicale de cette même société civile, où s’impose le type du « bourgeois », cet homme qui dissocie radicalement son bien propre du bien commun et qui, pour réaliser son bien propre, cherche à tirer le maximum de profit de l’exploitation d’autrui.
On a constamment accusé Rousseau de prétendre que la société n’est pas l’état naturel de l’homme et qu’il convient d’en revenir à l’état de nature, conçu comme une sorte d’âge d’or ou de paradis perdu. C’est un contresens total. Non seulement Rousseau ne prône aucun retour à l’état de nature, mais il affirme explicitement le contraire. Le passage de l’état de nature à l’état civil est pour lui irréversible.
Certes, tout comme Hobbes, qu’il critique si radicalement par ailleurs, Rousseau commet incontestablement l’erreur de ne pas croire à la sociabilité naturelle de l’homme. Mais c’est précisément parce qu’il ne conçoit pas les hommes comme naturellement sociaux qu’il s’affirme convaincu qu’une société qui conserverait ce trait de nature serait vouée à l’impuissance et à la division. Dans une telle société, dit-il, nul ne pourrait être ni moral, ni sincère, ni même en sécurité. Rousseau exige donc que les individus soient « dénaturés », c’est-à-dire soustraits à l’individualisme et transformés en citoyens patriotes, vertueux et désintéressés, aimant leur cité plus qu’eux-mêmes et recherchant la vertu plutôt que leur propre intérêt.
Ce qu’il veut, c’est déterminer les moyens permettant à l’individu de se défaire de son égoïsme pour s’identifier au tout social, sans pour autant renoncer à sa liberté: « Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, en s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi libre qu’auparavant. » Telle est la raison d’être du Contrat social.
En fait, ce que Rousseau, dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, appelle « état de nature » est un état de simple potentialité où sommeille la perfectibilité humaine. Cette notion de perfectibilité est essentielle, car c’est elle qui assure la médiation entre la nature et la culture. Elle n’a pas de contenu propre, mais permet à toutes les autres facultés de se manifester le moment venu. Rousseau veut montrer que l’homme se construit lui-même pour une large part et que c’est en cela qu’il se distingue des animaux. Les animaux n’ont pas d’histoire, alors que l’homme se construit historiquement. Le propre de la nature humaine est d’être vouée à la culture et, comme telle, à l’historicité. L’homme, en d’autres termes, est un être qui ne peut jamais se borner à ce qu’il est. Il y a chez lui une capacité de dépassement de soi qu’on ne retrouve dans aucune autre espèce.
Quant à la « bonté naturelle » de l’homme, ce n’est nullement une qualité morale, mais une simple propension – cet « homme » n’en étant d’ailleurs pas encore tout à fait un, puisqu’il n’a pas encore intériorisé dans sa conscience l’existence des autres. Rousseau le dit très explicitement : l’humanité proprement dite ne commence qu’avec le surgissement simultané de la conscience d’autrui, la distinction entre le bien et le mal et la possibilité d’agir librement.
Comme l’explique Benjamin Barber, « la première phrase du Contrat social, selon laquelle l’homme, né libre, est partout dans les fers, ne signifie pas que l’homme est libre par nature et que la société l’asservisse. Elle signifie plutôt que la liberté naturelle est une abstraction, tandis que la dépendance est la réalité humaine concrète. Le but de la politique n’est donc pas tant de préserver la liberté naturelle, mais de rendre la dépendance légitime par la citoyenneté et d’établir la liberté politique grâce à la communauté démocratique ».
N’étant pas en lui-même créateur d’un ordre juste, le contrat social de Rousseau n’a pas grand-chose à voir avec le contrat des contractualistes libéraux. « Le pacte social, peut-on lire dans l’Emile, est d’une nature particulière, et propre à lui seul, en ce que le peuple ne contracte qu’avec lui-même : c’est-à-dire, le peuple en corps comme souverain, avec les particuliers comme sujets. »
Cette idée d’un « peuple en corps comme souverain » est incontestablement le grand apport de Rousseau. Contrairement à Diderot, pour qui « ôter du peuple son caractère de peuple équivaudrait à le rendre meilleur », Rousseau affirme que le peuple est le seul à avoir le droit de gouverner parce qu’il est le seul véritable sujet politique : « La puissance législative appartient au peuple, et ne peut appartenir qu’à lui. » Le peuple est ainsi posé d’emblée comme source première de la vie collective.
Alors que les philosophes des Lumières ne rêvent que de transposer en France les institutions anglaises, Rousseau (qui a séjourné à Londres en 1766) se range parmi les contempteurs du système politique britannique. Dans le Contrat social, il s’en prend à la « liberté anglaise » et au système représentatif : « Le peuple anglais pense être libre; il se trompe fort, il ne l’est que durant l’élection des membres du Parlement ; sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien. » C’est pourquoi Rousseau en tient pour le mandat impératif, qui maintient en permanence les élus sous le contrôle de leurs électeurs. Le gouvernement, autrement dit, doit se borner à exécuter les volontés du peuple: une loi qui n’est pas ratifiée par le peuple est nulle. Cette critique de la représentation sera reprise par Carl Schmitt (« le mythe de la représentation supprime le peuple, comme l’individualisme supprime l’individu »). La seule démocratie authentique est la démocratie directe.
Rousseau affirme donc que c’est en s’identifiant à la communauté politique à laquelle il appartient que le citoyen pourra reconnaître son propre bien dans le bien commun que vise la volonté générale. Bien entendu, « chaque homme peut comme homme avoir une volonté particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale qu’il a comme citoyen ». Mais Rousseau écrit alors: « Quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps: ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre. »
Cette dernière formule lui été a beaucoup reprochée. Rousseau ne veut pourtant pas dire que la liberté individuelle doit être supprimée, mais qu’il faut lutter contre les passions personnelles qui écartent de l’intérêt commun et cultiver une vertu qui favorise le lien social. L’expression « forcer à être libre » n’évoque pas une coercition de type totalitaire, mais s’inscrit dans une réflexion sur les conditions de la liberté et celles de l’intériorisation des obligations. Rendre libre, c’est forcer l’individu récalcitrant à s’acquitter de sa part des charges publiques en parvenant à la maîtrise de soi, car l’autonomie authentique suppose de se soumettre à des normes communautaires partagées, c’est-à-dire de respecter les règles que l’on a soi-même fixées. Rousseau, à l’instar des anciens Grecs, ne conçoit donc l’homme que comme citoyen. Le bon citoyen est celui qui participe aux affaires publiques en tant qu’il est membre du peuple, détenteur du pouvoir exécutif. Le mauvais citoyen est celui qui veut faire prédominer son intérêt particulier au détriment du bien commun et qui utilise les autres comme un moyen de parvenir à cette fin. C’est pourquoi Jean-Jacques condamne les factions, les partis et les « groupes d’intérêts » particuliers, car leur existence fait perdre de vue le bien commun et dissout la volonté générale.
Sa conception de la vie sociale est en outre marquée d’un certain organicisme. Dans son « Discours sur l’économie politique », rédigé en 1755 pour l’Encyclopédie, il affirme ainsi que « le corps politique peut être considéré comme un corps organisé, vivant et semblable à celui d’un homme ». Cependant, il réalise aussi qu’à la différence du corps humain, l’unité du corps politique reste toujours précaire, car les intérêts particuliers menacent constamment de prévaloir sur le bien commun. L’harmonie sociale ne peut donc résulter que de la mise en oeuvre d’une volonté politique. C’est la tâche qui revient au législateur, que Rousseau imagine à l’exemple de Lycurgue, de Solon ou de Numa. Le législateur ne doit pas être vu comme un démiurge, mais comme chargé d’exprimer la nature sociale des hommes en les transformant en « vertueux patriotes ». Pour édifier une « âme nationale », il faut une éducation publique qui apprenne au citoyen ce qu’est son pays, son histoire et ses lois et qui les lui fasse aimer au point qu’il se tienne toujours prêt à défendre sa terre, son peuple et sa patrie. En 1778, Jean-Jacques Rousseau accepte l’invitation du marquis de Girardin à séjourner au parc d’Ermenonville. Il y arrive le 20 mai, mais décède le 20 juillet. Ses restes ne seront transférés à Paris qu’en 1794, pour y être inhumés au Panthéon… face à ceux de Voltaire!
Comme Leo Strauss l’a bien remarqué, Rousseau inaugure la deuxième vague de la modernité (Machiavel correspondant à la première et Nietzsche à la troisième). Prosateur incomparable, théoricien du primat du politique, adversaire résolu des Lumières auxquelles on s’obstine encore à l’assimiler au seul motif qu’il professait lui aussi un idéal d’émancipation individuelle et collective, il ne fut pas seulement un précurseur du romantisme, voire de l’écologisme, mais l’un des vrais fondateurs de la psychologie moderne et de la sociologie critique. C’est en cela qu’il défie toutes les étiquettes. Alors, Rousseau révolutionnaire conservateur ? Il serait temps de rouvrir le dossier.
Alain de Benoist (Le spectacle du monde, juin 2012)