L'esprit français au fil de ses penseurs
Indisciplinés, brillants, spirituels, arrogants, donneurs de leçons, hâbleurs, séducteurs, élégants, futiles, experts en galanterie, amateurs de bons mots, frondeurs, joueurs, cartésiens, nuls en langues étrangères, chauvins bien sûr – tous ces termes n’ont cessé d’être employés pour parler des Français.
 Expression récurrente du discours sur la France, l’“esprit français” renvoie à une construction de l’imaginaire liée à certaines valeurs jugées fondatrices de l’identité nationale et assumant une fonction à la fois narrative, idéologique et symbolique. En 1920, le sociologue Célestin Bouglé voyait dans l’esprit français le « ressort intérieur » et la « force profonde de notre civilisation ». Il a même paru à Paris, de 1929 à 1933, un hebdomadaire littéraire intitulé l’Esprit français. Depuis la Renaissance jusqu’au général de Gaulle, c’est au nom d’une « certaine idée de la France » que les Français ont réclamé une place dans le monde. Mais quelle idée ?
Expression récurrente du discours sur la France, l’“esprit français” renvoie à une construction de l’imaginaire liée à certaines valeurs jugées fondatrices de l’identité nationale et assumant une fonction à la fois narrative, idéologique et symbolique. En 1920, le sociologue Célestin Bouglé voyait dans l’esprit français le « ressort intérieur » et la « force profonde de notre civilisation ». Il a même paru à Paris, de 1929 à 1933, un hebdomadaire littéraire intitulé l’Esprit français. Depuis la Renaissance jusqu’au général de Gaulle, c’est au nom d’une « certaine idée de la France » que les Français ont réclamé une place dans le monde. Mais quelle idée ?
« L’esprit français ne se laisse pas aisément définir », remarquait déjà en 1917 Gustave Lanson, qui expliquait cette difficulté par le fait que « tous les tempéraments, tous les caractères se manifestent en France, et cela en proportions plus égales qu’ailleurs ». Le fait est que l’on n’a cessé de caractériser l’esprit français de façon contradictoire. A peine attribue-t-on aux Français tel ou tel trait caractéristique que des exceptions se présentent à l’esprit. Lorsque l’on lit les auteurs classiques, on n’en voit pas moins les mêmes mots revenir avec une belle régularité. Les adjectifs les plus employés sont : gais, polis, élégants, spirituels. Les Français sont des « gens d’esprit », ils savent pratiquer l’« art délicat de la louange », ils ont à l’extrême l’« esprit de conversation », ils prisent par-dessus tout la « clarté » et la « précision ». Au XVIIIe siècle, l’élégance et l’esprit de conversation, qui triomphent dans les salons, souvent dirigés par des femmes, retiennent l’attention de l’Europe entière, qui ne manque pas de citer les “bons mots” qu’on y entend. Kant lui-même affirme que « la nation française se caractérise entre toutes par son goût de la conversation ».
« Je ne fay rien sans gayeté », écrivait Montaigne. Bien après lui, Montesquieu, parlant des Anglais, écrit que « leurs poètes auraient plus souvent cette rudesse originale de l’invention qu’une certaine délicatesse que donne le goût ». Rivarol oppose Molière à Shakespeare : « L’Anglais, sec et taciturne, joint à l’embarras et à la timidité de l’homme du Nord une impatience, un dégoût de toute chose, qui va souvent jusqu’à celui de la vie – le Français a une saillie de gaieté qui ne l’abandonne pas. »
Au XIXe siècle, madame de Staël (la Littérature comparée dans ses rapports avec les institutions sociales) affirme que la nation française est en Europe celle qui a « le plus de grâce, de goût et de gaieté ». Elle assure que les Français, de tout temps, « ont excellé dans l’art de ce qu’il faut dire, et même de ce qu’il faut taire », qu’ils « parlent toujours légèrement de leurs malheurs, dans la crainte d’ennuyer leurs amis ». Dans ses Origines de la France contemporaine, Hippolyte Taine, qui dit préférer le « rire gaulois » au rationalisme latin, déclare que « le besoin de rire est le trait national » et que ce besoin est une « manière de philosopher à la dérobée ». Il ajoute que le Français est « capable d’atteindre les idées, toutes les idées, et les plus hautes, à travers le badinage et la gaieté ».
Victor Considérant, disciple de Fourier, écrit de son côté que le peuple français est « le plus sociable, le plus actif, le plus intrépide, le plus gai, le plus audacieux, le plus passionné » de la Terre, ce qui s’explique par son « amour pour le mouvement, pour la gloire, pour les grandes choses, sa capacité pour l’honneur et pour l’enthousiasme, son esprit de corps, la disposition naturelle de l’individu à prendre le ton de la masse, la facilité chevaleresque avec laquelle il se plaît à s’exposer au danger ».
C’est le thème du “panache”, qui porte si souvent les Français à admirer les grands hommes, surtout quand ils se posent seuls contre tous, aussi bien qu’à soutenir les causes perdues d’avance, mais d’autant plus sublimes, de Cyrano de Bergerac au général de Gaulle, voire à Dominique de Villepin ! « L’esprit français, disait Paul Deschanel, c’est la raison en étincelles ! » Jolie formule. Il n’a cessé de susciter quantité de propos lyriques, souvent teintés d’essentialisme naïf, sur la “France éternelle”.
Ils ont aussi parfois tourné à la caricature. Durant la Première Guerre mondiale, époque à laquelle la “psychologie des peuples” est à la mode, tout une série de libelles opposent avec force la « civilisation française » à la « Kultur » allemande. Passionnément admirée en France au XIXe siècle sous le triple rapport de la philosophie, de l’histoire et du droit, la pensée allemande est dénoncée en 1914 comme un mélange de brutalité et de « barbarie » primitive. C’est l’époque où, avec Ernest Lavisse, chacun s’emploie à montrer l’âme française en tout point opposée à l’âme allemande, ou bien, avec Alfred Croiset, à opposer l’idéal français de « vérité et justice, raison et liberté » au « Moloch barbare » des Teutons ! 
On a en fait toujours les défauts de ses qualités. De même que la galanterie, fusionnée avec l’esprit rabelaisien, vire aisément à la gaillardise, l’ironie peut devenir dérision systématique, le bon mot laborieux calembour, et l’esprit de conversation simple goût du verbiage. La politesse peut être interprétée comme de la superficialité, la valorisation de l’élégance comme une preuve de futilité. « Les Français prennent les mots pour des faits », disait Moltke. Idée reprise par Alain Peyrefitte qui, dans le Mal français (1976), dénonçait l’« immobilisme convulsionnaire » des Français et leur propension au comportement « verbo-moteur » : « Nous admirons la parole et méprisons les faits. »
« La vérité, écrivait en 1858 le critique littéraire Emile Montégut, est que la France, pays des contradictions, est à la fois novatrice avec audace et conservatrice avec entêtement, révolutionnaire et traditionnelle, utopiste et routinière. » « Une opinion très répandue, ajoutait-il, veut que le Français, être sans profondeur, n’ait aucun penchant aux spéculations abstraites, rêveries bonnes seulement pour les habitants des brouillards allemands. Or, il n’y a pas de peuple chez lequel les idées abstraites aient joué un aussi grand rôle, et où les individus soient aussi insouciants des faits et possédés à un aussi haut degré de la rage des abstractions. » C’est que le goût de l’abstraction n’est pas la philosophie.
La France n’a eu au fond qu’un seul grand philosophe, René Descartes. Violemment dénoncée par Taine, la philosophie cartésienne, réduite à la simple faculté de distinguer le vrai du faux par un appel exclusif à la raison, n’en a pas moins été constamment instrumentalisée pour faire ressortir son caractère “français”, notamment lors de son annexion par l’école de l’éclectisme libéral, au moment de la monarchie de Juillet. Victor Cousin, dans ses Fragments de philosophie cartésienne, se dit ainsi convaincu que la méthode cartésienne est la bonne, tant du fait de « la grandeur et [de] la beauté morale de ses principes » que « parce qu’elle est française et a répandu sur la nation une gloire immense ».
Au lendemain de la défaite de 1871, Renan écrit la Réforme intellectuelle et morale. S’interrogeant sur les causes du désastre, il ne s’en prend pas seulement aux « idées de 1789 », qui l’avaient séduit à l’époque où il écrivait l’Avenir de la science, mais aussi à l’« état moral de la France ». Il critique le goût des Français pour la guerre civile, leur désir de grandeur rarement assorti de l’acceptation des contraintes qu’il faut exercer sur soi pour y parvenir, le caractère superficiel de trop de leurs préoccupations : « Présomption, vanité puérile, indiscipline, manque de sérieux, d’application, d’honnêteté, faiblesse de tête, incapacité de tenir à la fois beaucoup d’idées sous le regard », etc. On retrouve des propos assez semblables chez Tocqueville ou Gobineau.
L’hétérogénéité de la France explique peut-être aussi bien les divisions des Français que le caractère si contradictoire des traits qui leur ont été attribués. Comment pourrait-il en aller autrement, dans un pays qui, cas unique en Europe, possède à la fois des composantes méditerranéennes, alpines, celtiques et germaniques ?
La thématique de « nos ancêtres les Gaulois », on l’a trop oublié aujourd’hui, est née d’abord de la volonté de contredire tous ceux pour qui les Français étaient d’abord les descendants des conquérants francs. Nombreux furent d’ailleurs les auteurs, depuis Boulainvilliers et Montlosier jusqu’à Taine, Flaubert et Gobineau, qui caractériseront l’histoire nationale par une lutte séculaire entre l’esprit “gaulois” ou “gallo-romain”, représenté par le tiers état et la bourgeoisie, et l’esprit “franc” ou “germanique”, incarné par la noblesse. Sous la IIIe République, le mythe de Vercingétorix prolonge les arguments hostiles aux Francs développés dès avant la Révolution par l’abbé Jean-Baptiste Dubos et l’abbé de Mably.
Tandis que Michelet célèbre l’« unité organique » de la France, fondée sur la « fusion des races », d’autres au contraire ne se sentent vraiment solidaires que de l’une de ses composantes.
A ceux qui, comme Maurras, proclament que la France est d’abord une nation latine, répondent ceux qui, de Gustave Le Bon à Céline et Alain Peyrefitte, n’ont que peu de sympathie pour les Méridionaux.
Renan, pour qui la nation est un « plébiscite de tous les jours », écrit dans la Réforme intellectuelle et morale : « La France du Moyen Age est une construction germanique, élevée par une aristocratie militaire germanique avec des éléments gallo-romains. Le travail séculaire de la France a consisté à expulser de son sein tous les éléments déposés par l’invasion germanique, jusqu’à la Révolution, qui a été la dernière convulsion de cet effort […] Pourquoi le Languedoc est-il réuni à la France du Nord, union que ni la langue, ni la race, ni l’histoire, ni le caractère des populations n’appelaient ? […] Notre étourderie vient du Midi, et si la France n’avait pas entraîné le Languedoc et la Provence dans son cercle d’activités, nous serions sérieux, actifs, protestants et parlementaires ! »
D’autres auteurs, tels André Chénier, Paul Vidal de La Blache (Tableau de la géographie de la France) ou Taine, insistent au contraire sur le caractère géographiquement “intermédiaire” de la France pour expliquer que l’esprit français se tient à égale distance de ce que Rivarol appelait les « opinions exagérées du Nord et du Midi ». Et Renan, tout opposé qu’il soit à la culture latine, n’en affirme pas moins que « la grandeur de la France est de renfermer les pôles opposés » et de pouvoir en proposer une synthèse. Vieille dialectique de l’unité et de la diversité.
Mais en réalité, ce sont sans doute les grands traits de l’histoire politique des Français qui ont le plus contribué à former l’esprit français. A commencer par la centralisation administrative. L’unité française s’est en effet accomplie grâce à une forte centralisation : fille de l’identité de la loi, elle résulte de l’action obstinée des politiques et des juristes (ou des légistes). C’est ce que dénonceront Tocqueville et Renan, comme après eux Georges Sorel. Sous l’Ancien Régime, comme sous la République, le pouvoir a son siège à Paris et s’exerce de haut en bas. Les citoyens se sentent de ce fait éloignés des centres de décision. A une organisation autoritaire répond une résistance passive, qui peut prendre la forme du repli sur la vie privée, de la critique systématique, de la fronde, voire de la révolte. La méfiance et l’aversion vis-à-vis de l’ordre sont la règle. C’est peut-être pourquoi l’histoire de France abonde en révoltes populaires et en jacqueries.
Plus encore que le peuple anglais ou le peuple espagnol, le peuple français est né de l’existence d’une nation elle-même créée par l’action volontaire de l’Etat (l’agrandissement du « pré carré »), tandis que dans les terres d’Empire, c’est bien plutôt le peuple qui a créé la nation, laquelle a fini par se doter d’un Etat. Il en résulte qu’en France, citoyenneté et nationalité sont synonymes.
Au XVIIIe siècle, se répand en France l’idée d’une origine contractuelle des nations : un jour, des hommes se sont rassemblés pour former une nation. C’est l’idée commune à Locke, Montesquieu et Rousseau. Il n’y a donc pas de naturalité du fait collectif et l’homme n’est pas naturellement un être politique (l’« état de nature » était prépolitique et présocial). Les nations ont une origine juridique et datée et la nation est coextensive à l’Etat. C’est ce que soutenaient aussi les jacobins, pour qui la volonté d’homogénéiser la société constitue un élément tout naturel de l’idéologie républicaine.
En Allemagne, à la même époque, la nation allemande existe en dehors de tout Etat unitaire, et c’est à partir de la langue, de la culture et de l’“âme populaire” (Volksseele ou Volksgeist) que l’on en donne une définition. Herder et Fichte opposent alors leur nation, posée comme naturelle et organique (Kulturnation), à celle, jugée artificielle et mécanique, que propage la Révolution. Cette distinction entre la nation et l’Etat a des conséquences anthropologiques. Elle se prolonge dans l’opposition entre la “communauté” (Gemeinschaft) et la “société” (Gesellschaft), voire entre la culture, toujours particulière, et la civilisation, qui vise à l’universalité.
Est-ce l’individualisme qui explique la centralisation, nécessaire pour faire tenir ensemble des provinces et des peuples qui n’étaient pas naturellement portés à vivre ensemble, ou bien cet individualisme représente-t-il a contrario une réaction à ce que la centralisation a pu avoir d’excessif ?
Dans un livre paru en 1957, le duc de Lévis-Mirepoix décrivait l’individualisme comme le trait principal des Français : l’initiative personnelle plutôt que l’esprit d’équipe, la chanson individuelle plutôt que le chant choral – ce qui n’empêche pas les élans de solidarité. Il observait aussi, à propos de la liberté : « Les Latins la conçoivent au sens strict, comme une prééminence de la personne sur la société, tandis que, très différemment, les Anglo-Saxons l’envisagent comme une défense de la vie privée et des droits naturels sans aucun empiétement sur ce qui est dû à l’Etat. » La conception française de la liberté tirerait donc vers l’individualisme, qui a lui-même partie liée avec l’égalité. Depuis Montaigne et Descartes (« Je pense, donc je suis ») jusqu’à Auguste Comte, Bergson et même Sartre, la philosophie française ne s’est-elle d’ailleurs pas toujours occupée à célébrer le “moi” plutôt que le “nous” ? L’individualisme n’empêche pas l’étatisme, bien au contraire. Seul l’Etat peut en effet remédier à la dissolution des relations organiques et des réseaux naturels de solidarité dont il est historiquement responsable.
Au coeur de l’esprit français, disait récemment Dominique de Villepin, il y a un « rêve d’universalisme ». Historiquement associé à l’individualisme, l’universalisme français est adossé à la conviction que les traits de caractère des Français sont tellement excellents qu’on doit du même coup les regarder comme exemplaires pour tous les autres peuples, et donc qu’ils ont une valeur universelle. On retrouvera semblable penchant aux Etats-Unis.
Alors que Montesquieu, dans De l’esprit de lois, affirme avec force que tous les régimes ne conviennent pas à tous les pays, soulignant au passage « combien il faut être attentif à ne pas changer l’esprit d’une nation », d’innombrables auteurs assurent au contraire que l’esprit français est « universel » par définition. C’est par exemple ce que proclame Rivarol dans son célèbre Mémoire sur l’universalité de la langue française, couronné en 1784 par l’académie de Berlin. Après avoir démontré la supériorité absolue de la langue française sur toutes les autres, il en déduit que ses qualités la rendent du même coup universelle : « Sûre, sociable et raisonnable, ce n’est plus la langue française, c’est la langue humaine. »
Volontiers xénophobes mais absolument pas racistes, les Français sont portés par l’idée qu’ils font les choses mieux que les autres. Friedrich Sieburg disait avec humour que, pour eux, les langues étrangères ne sont jamais que du « français traduit ». Loin d’avoir une valeur locale, la devise Liberté, Egalité, Fraternité est censée valoir pour tous les peuples.
Ainsi, au XIXe siècle, la colonisation est constamment justifiée par l’idée qu’en apportant aux peuples “primitifs” les éléments du “progrès”, la nation colonisatrice travaille pour le bien de l’humanité. « Autant les conquêtes entre races égales doivent être blâmées, va jusqu’à écrire Ernest Renan, autant la régénération des races inférieures ou abâtardies par les races supérieures est dans l’ordre providentiel de l’humanité ! »
A la même époque, les socialistes français ne tarissent pas d’éloge sur la façon dont leurs concitoyens s’enflamment pour la liberté des peuples opprimés, tel Victor Considérant, qui en conclut que « la politique de l’humanité est certainement la vraie politique nationale de la France ». De même, aux yeux de Jules Michelet, la France, « instituteur du genre humain », se définit par son « amour de l’humanité ». Et Edgar Quinet célèbre « la nation au service de l’humanité », tandis qu’à l’autre extrémité de l’éventail politique, le contre-révolutionnaire Joseph de Maistre assure que la France est investie d’une véritable « magistrature dans l’univers ».
Toute identité est évidemment dialogique, en ce sens qu’il ne peut y avoir de “nous” sans un “eux”. C’est pourquoi l’étude de l’esprit français s’appuie souvent sur une démarche comparative. En septembre 1870, Ernest Renan écrivait dans le Journal des débats : « Le grand malheur du monde est que la France ne comprend pas l’Allemagne, et que l’Allemagne ne comprend pas la France. » Mais pourquoi ne se comprennent-elles pas ?
La meilleure réponse à cette question a sans doute été donnée par le sociologue Louis Dumont qui, dans ses Essais sur l’individualisme (1983), puis dans Homo aequalis II. L’idéologie allemande, France-Allemagne et retour (1991), constate qu’en Allemagne, l’individu existe avant tout par son appartenance au groupe, tirant de celui-ci l’essentiel de son identité. S’efforçant d’identifier les paradigmes socio-anthropologiques de notre culture, Louis Dumont met la modernité en relation directe avec la montée de l’individualisme, qu’il définit comme une « catégorie mentale » liée à l’universalisme, au rationalisme et à l’égalitarisme. C’est dans cet « individuo-universalisme », dont la montée est historiquement allée de pair avec l’avènement de la classe bourgeoise et de l’« idéologie économique », qu’il voit le fondement de l’idéologie politique française.
Dans toute son oeuvre, Dumont oppose les sociétés individualistes aux sociétés « holistes » (la plupart des sociétés traditionnelles). Dans les sociétés individualistes, on pose d’abord l’individu et seulement ensuite la société, c’est-à-dire que l’on dissocie identité personnelle et identité collective, en considérant chaque individu comme une incarnation de l’humanité, tandis que dans les sociétés holistes, l’homme est conçu d’emblée comme un être social qui doit regarder en amont de lui-même pour savoir qui il est. Et selon Dumont, la société française relève plutôt de la première catégorie, et l’allemande de la seconde. « Dans sa propre idée de lui-même, écrit-il, le Français est homme par nature et français par accident, tandis que l’Allemand se sent d’abord allemand, et homme à travers sa qualité d’Allemand. » C’est sans doute l’une des clés de l’esprit français.
Alain de Benoist (article paru dans le Spectacle du Monde, janvier 2010)


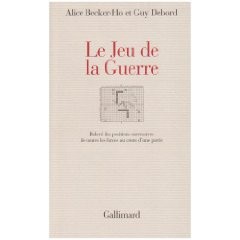




 Expression récurrente du discours sur la France, l’“esprit français” renvoie à une construction de l’imaginaire liée à certaines valeurs jugées fondatrices de l’identité nationale et assumant une fonction à la fois narrative, idéologique et symbolique. En 1920, le sociologue Célestin Bouglé voyait dans l’esprit français le « ressort intérieur » et la « force profonde de notre civilisation ». Il a même paru à Paris, de 1929 à 1933, un hebdomadaire littéraire intitulé l’Esprit français. Depuis la Renaissance jusqu’au général de Gaulle, c’est au nom d’une « certaine idée de la France » que les Français ont réclamé une place dans le monde. Mais quelle idée ?
Expression récurrente du discours sur la France, l’“esprit français” renvoie à une construction de l’imaginaire liée à certaines valeurs jugées fondatrices de l’identité nationale et assumant une fonction à la fois narrative, idéologique et symbolique. En 1920, le sociologue Célestin Bouglé voyait dans l’esprit français le « ressort intérieur » et la « force profonde de notre civilisation ». Il a même paru à Paris, de 1929 à 1933, un hebdomadaire littéraire intitulé l’Esprit français. Depuis la Renaissance jusqu’au général de Gaulle, c’est au nom d’une « certaine idée de la France » que les Français ont réclamé une place dans le monde. Mais quelle idée ?
