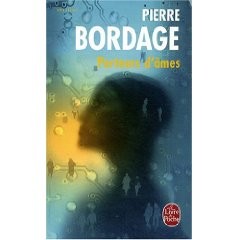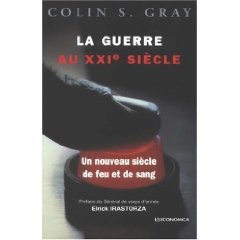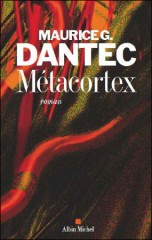Le monde moderne est régi par la politique des émotions. Elles sont devenues des instruments majeurs de la politique. Dans le même temps, plus personne ne se réclame d’une idéologie. Il est loin le temps où Chirac fut reagano-thatchérien en 1986, après avoir été travailliste « à la française ». Aujourd’hui, Nicolas Sarkozy se réclame avant tout du pragmatisme et de la… capacité d’écoute.
L’essentiel, c’est de voir « ce qui marche » disent nos politiques. Après les idéologies du XXe siècle ce sont maintenant les « émotions » qui justifient les politiques qui, bien entendu, sont pourtant d’abord toujours des politiques de pouvoir. La peur, l’envie, la compassion, l’espoir, l’orgueil mènent le monde. Exemple : avec Obama, l’Amérique a choisi une image lui permettant de s’aimer à nouveau et de se faire aimer, les deux étant liés. Même s’il y a de fortes chances pour que les constantes de la politique américaine restent inchangées, comme les premières initiatives diplomatiques d’Obama le laissent prévoir tout comme son entourage pouvait permettre de le supposer.
De même, quand la Russie de Poutine et Medvedev « inquiète » à nouveau les professionnels de l’atlantisme, c’est une autre émotion, – la peur – qui joue. Ou, pour être plus précis, c’est la peur qui est mobilisée. On mobilise les émotions, et ensuite on mobilise les forces réelles, économiques, politiques et militaires. On l’a vu avec les nombreuses fables inventées de toute pièce contre l’Irak de Saddam Hussein (à tel point qu’on en oublierait presque les crimes bien réels du dictateur). Parfois, c’est tout simplement la puissance qui inspire le respect. Encore une émotion. « Quand les types de 100 kg disent certaines choses, les types de 60 kg les écoutent. » disait Michel Audiard.
Emotions ? C’est ce qui met en mouvement, dit l’étymologie. La politique, c’est justement de mettre en mouvement. Platon, Hobbes, Kant, Hegel parlaient des passions. La passion est proche de l’émotion. La principale des passions qui mènent le monde est maintenant celle de l’identité. C’est un sujet sur lequel Todorov a écrit Nous et les autres (Seuil, 1989), et de Benoist, Nous et les autres. Problématique de l’identité (Krisis, 2006). L’identité, c’est le problème. Lévinas disait que l’on emploie le mot quand la chose n’est plus. Dominique Moïsi, de l’Institut Français des Relations Internationales, écrit : « Si le XXe siècle fut tout à la fois le siècle de l’Amérique et de l’idéologie, tout porte à croire (…) que le XXI e siècle sera celui de l’Asie et de l’identité. » (La géopolitique de l’émotion, Flammarion).
Petit tour d’horizon. L’Asie, - et la Chine bien plus que l’Inde – est dans la culture de l’espoir : l’espoir de se faire une place au soleil. Coute que coute. De son coté, le monde arabe est dans une culture de l’humiliation. Un traumatisme qui date, pour n’envisager que la période récente, de la guerre des Six Jours en 1967. Et un traumatisme qui a été aggravé par les deux « guerres « du Golfe : en vérité la liquidation d’une armée irakienne hors d’état de résister et l’anéantissement de toute l’armature d‘une nation.
Une autre émotion est la culture de peur. Certains Européens, marqués par l’histoire des années trente et quarante (« les Allemands, sur leur terrain, faut jamais les sous-estimer.- Parfois même sur le notre. » disait encore Audiard), eurent peur de la réunification allemande, comprenant mal qu’à tous points de vue, les temps avaient changé. Plus récemment, les néoconservateurs ont peur de ce qu’ils appellent parfois l’ « islamo-fascisme », devant lequel il ne faudrait pas « reculer », comme à Munich en 1938, rajoutent certains – la référence à Munich étant devenu un poncif incontournable.
Il y a encore la peur de la Turquie en Europe. Ou la peur du futur. Et des peurs très concrètes, comme la peur de ce que Serge Paugam appelle la « disqualification sociale » (PUF, 2002), une peur qu’analyse encore Camille Peugny dans « le déclassement » (Grasset, 2009). Toutes choses qui nous renvoient à la panne de l’ascenseur social (et au caractère vermoulu et branlant de l’escalier). C’est dire que la peur ne correspond pas à de faux problèmes mais bien souvent à des dangers réels. Reprenons l’exemple de l’entrée de la Turquie en Europe – entendons : dans ses structures politiques. Elle n’est pas souhaitable actuellement mais ne changerait pas grand-chose au fait que l’Europe actuelle, celle de Bruxelles, ne protège pas les peuples européens de la mondialisation, de la perte de leur identité, de la domination du grand capital.
En outre, l’exemple de la Turquie montre la difficulté de saisir les enjeux. On peut voir la Turquie comme l’instrument des USA en Europe. On peut la voir tout au contraire comme une puissance qui pèsera, tout au moins à long terme, dans le sens d’un non alignement de l’Europe sur Israël et sur les USA. En fonction des prédictions que chacun fera, on peut donc, avec des systèmes de valeurs opposés, faire le même choix (par exemple être pour la Turquie en Europe parce qu’on est pour une Europe pro-américaine ou pour la Turquie en Europe parce qu’on est pour une Europe libre vis-à-vis de l’Amérique). On peut aussi au contraire, avec le même système de valeurs, faire des choix opposés, comme en 1942, deux patriotes français pouvaient s’engager dans deux camps différents au nom d’une conception différente des urgences mais d’un même amour de la patrie.
Ce qui est assuré, c’est que moins les enjeux réels sont analysés, plus les émotions prédominent. « Je ne peux plus saisir ou comprendre – sans parler de le maîtriser – le monde dans lequel je vis. Je dois donc exalter ma différence et donner priorité à mes émotions. » résume Dominique Moïsi quant à ce qu’est devenu le sentiment dominant.
Emotions et illusions
Le problème des émotions est qu’elles se nourrissent beaucoup trop des illusions. C’est le cas des illusions de tout concilier : la croissance et l’écologie, le flicage anti-automobiliste et l’envie d’acheter des voitures, la qualité et la quantité, la vitesse et la sécurité, l’amour et le libertinage, moins d’impôts et plus de services publics, l’ouverture totale aux autres et la préservation de l’identité de soi, l’immigration de masse et l’intégration, etc.
C’est ce que Bertrand Méheust appelle, dans son essai sur les rapports entre l’écologie et les injonctions contradictoires de notre société, « la politique de l’oxymore » (Comment ceux qui nous gouvernent nous masquent la réalité du monde, La Découverte, 2009). La Révolution française voulait apporter le bonheur aux Français, et au genre humain : elle a plongé l’Europe dans la guerre et a inventé le concept de guerre totale par idéologie. C’est l’hétérotélie : on vise un but et on en atteint un autre, comme l’avait vu Jules Monnerot (Intelligence de la politique, Gauthier-Villars, 1978). S’il y a tant d’hétérotélie, c’est que l’histoire est faite d’oxymores. L’un des plus massifs parmi les oxymores contemporains est celui-ci : le volontarisme technologique ou la volonté de maitrise technologique est un oxymore car la biosphère restera toujours en partie imprévisible et que ses mécanismes – ou plus exactement sa vie – excèdent toute intelligence humaine.
Prenons comme cas la géo-ingénierie. C’est par exemple l’idée de larguer des tonnes de souffre dans la stratosphère pour modifier le climat, en l’occurrence le refroidir. C’est encore l’idée de créer une banquise artificielle pour relancer le Gulf Stream. Ces idées peuvent être excitantes. Elles sont surtout très incertaines. Il y a des expériences que l’homme risque de ne pouvoir faire qu’une fois. La question que pose l’écologie à l’homme est celle-ci : l’homme peut-il exister sans cesser d’inventer ? Ou plutôt : peut-il vivre sans l’obsession d’inventions qui soient toutes de l’ordre de la puissance technologique ?
Car il n’y a pas de société sans horizon commun, sans ambition commune. L’idéologie de la transparence a fait perdre à la société son épaisseur. Des philosophes l’ont vu et l’ont dit mais c’est peut-être un Alphonse Boudard qui le mieux exprimé cette perte de l’épaisseur du monde dans Mourir d’enfance (1995). Notre société impose dans le même temps, sous le signe de l’équivalence des valeurs, un devoir-être parfaitement totalitaire : interdiction de toute polémique un peu soutenue, tri sélectif des ordures obligatoire, criminalisation des automobilistes à la moindre infraction, pro-féminisme idéologique obligatoire, larmoysme pro Ingrid Bettancourt obligatoire jusqu’il y a sa libération, niaiserie de la repentance obligatoire, etc.
Les distances sociales implicites s’effacent au moment où un devoir-être identique s’impose à tous. Et dans le même mouvement, la « pipolisation » de la politique enlève toute sacralité au pouvoir. Les filiations identitaires, quelles soient politiques, professionnelles, religieuses, se perdent, ce qui rend plus problématiques les nécessaires affiliations qui permettent l’évolution même des identités. En conséquence, les crispations identitaires tiennent lieu, bien souvent, - et bien mal -, d’appartenances. Exemple : le CRAN, conseil « représentatif » (sic) des associations noires, ou le fantomatique CRAB, conseil représentatif des associations blanches (même pas drôle). Ces incertitudes identitaires sont la marque de ce que Georges Balandier appelle « le dépaysement contemporain » (PUF, 2009). « La souffrance c’est la douleur plus autre chose » écrit-il. Cette autre chose c’est la perte d’une perspective commune.
La fin de l’idéal d’une société bonne
L’idéal d’une « société bonne » disparait au profit d’une politique de compensations des aigreurs des uns et des autres. La justice sociale cesse d’être un objectif. A sa place, on installe des politiques « anti discriminations ». Nul ne conteste qu’il y ait parfois matière à rétablir une égalité des chances. Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit – cela qui aurait un nom très simple : la République et la méritocratie républicaine. La politique de promotion des minorités visibles a pour objectif de diviser le monde du travail, de désarmorcer les conflits sociaux en les faisant dériver vers des revendications « racialistes ».
Walter Benn Michaels écrit justement : « Une France où un plus grand nombre de Noirs seraient riches, ne serait pas économiquement plus égalitaire, ce serait juste une France où le fossé entre les Noirs pauvres et les Noirs riches serait plus large. » (La diversité contre l’égalité, Raisons d’agir, 2007). C’est toute l’histoire, depuis 1983, de l’abandon du projet de transformer la société par les « socialistes » qui aboutit à cet exutoire : racialiser les problèmes sociaux, donner des satisfactions d’amour propre identitaire à une minorité (de Noirs, d’handicapés, de gens « issus de l’immigration », « issus de la diversité » dit-on maintenant, etc) pour calmer la masse des travailleurs et surtout la diviser, de surcroit en accentuant les arrivées d’étrangers et en jouant ainsi des exaspérations des français « de souche » par le choc des modes de vie et les barrières ethniques et culturelles.
La diversité, la représentation des minorités visibles, c’est ce qui reste de la justice en milieu libéral et c’est surtout le contraire de la justice. Comme l’écrit encore W-B Michaels, « la conception de la justice sociale qui sous-tend le combat pour la diversité repose sur une conception néolibérale ». Ce qu’il résume fort bien par la formule : « La diversité n’est pas un moyen d’instaurer l’égalité; c’est une méthode de gestion de l’inégalité. » La diversité est ainsi une politique de diversion. Elle participe de la pensée unique. « Au lieu de débattre sur l’inégalité, nous débattons sur les préjugés et le respect ; or, étant donné la rareté des défenseurs des préjugés et des détracteurs du respect, nous nous retrouvons à ne plus débattre du tout. » note encore W-B Michaels. La politique de la « diversité » est de la posture, de l’imposture et de l’instrumentalisation des émotions.
Pour compléter le brouillage des identités sociales, certaines caractéristiques traditionnelles du service public, – telles la rigueur professionnelle, le sens du devoir, la priorité du service rendu sur le gain, l’écoute – sont mises en avant comme la nouvelle idéologie du secteur privé. Tandis que le secteur public intègre les exigences de performance, de compétitivité, de ratios qui sont issues du secteur privé. L’esprit d’équipe s’efface, même dans le public, au profit de la mesure des performances individuelles, comme le relève Danièle Linhart dans Travailler sans les autres (Seuil, 2009), où elle montre les ravages de la méfiance réciproque sur l’esprit d’équipe. De quoi rendre les salariés fous ! C’est d’ailleurs en partie le cas comme le montre la remarquable enquête de Philippe Petit sur « la France qui souffre » (Flammarion, 2008).
Déstabilisation du monde du travail et « émotionalisation » de la société – ou « sentimentalisation » de celle-ci –, telles sont les deux armes de distraction (au sens propre : distraire de) massive (selon l’expression de Matthew Fraser) du néolibéralisme face aux espoirs d’émancipation nationale et sociale du peuple travailleur et producteur. Décidément, cela donne une juste envie de faire la révolution.
Pierre le Vigan