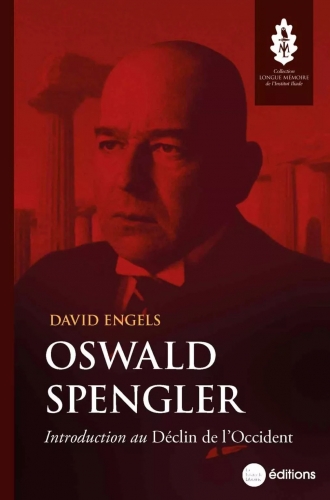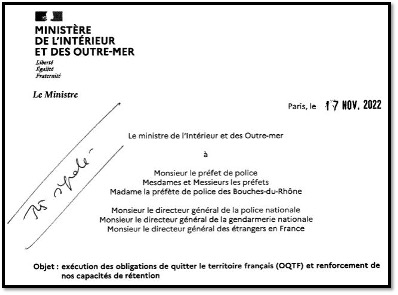Vive l’Allemagne secrète !
Lorsque le comte Claus von Stauffenberg est fusillé le 21 juillet 1944 à Berlin, après avoir placé, le jour précédent, une bombe au quartier général d’Adolf Hitler à Rastenbourg en Prusse-Orientale, il crie, en référence à son mentor le poète symboliste rhénan Stefan George, « Vive l’Allemagne secrète ! »1 Celle-ci est un mythe plongeant ses racines dans le monde impérial des Hohenstaufen de Frédéric Ier Barberousse et de Frédéric II et introduit dans la poésie, sous une forme codée, dans les hymnes de Friedrich Hölderlin2 et dans les écrits de Friedrich Schiller, de Heinrich Heine, de Paul de Lagarde, de Julius Langbehn, ainsi que dans la légende de Frédéric Ier Barberousse endormi dans un château souterrain au fond du massif de moyenne montagne du Kyffhäuser.3
Karl Wolfskehl, membre du cercle constitué autour du poète Stefan George, utilise, dans un texte paru dans le Jahrbuch für die geistige Bewegung de 19104 et intitulé « Die Blätter für die Kunst und die neueste Literatur » (Les Feuilles pour l’art et la littérature la plus récente), le terme « Allemagne secrète ».
Stefan George et les trois frères Stauffenberg – les jumeaux Alexander et Berthold, ainsi que Claus – font connaissance à Marbourg au printemps 1923.
Ernst Kantorowicz, autre membre du cercle Stefan George et futur auteur de l’ouvrage Les Deux Corps du roi, se rend à Rome, durant le printemps 1924, avec des amis historiens et les jumeaux Alexander et Berthold von Stauffenberg. Certains d’entre eux voyagent en mai 1924, durant la semaine de Pâques, vers Naples, Paestum et poursuivent vers Ségeste et Palerme en Sicile. Parmi eux figurent plusieurs membres du Cercle Stefan George, dont Ernst Kantorowicz et Berthold von Stauffenberg. Ils déposent, alors que les autorités italiennes fêtent les 700 ans de la fondation de l’université par Frédéric II de Hohenstaufen, sur le sarcophage de ce dernier, une couronne portant la mention « À son empereur et héros, l’Allemagne secrète. »
À l’automne 1924, Claus von Stauffenberg écrit à Stefan George afin de lui faire part du fait que l’œuvre de ce dernier l’a secoué et réveillé et qu’il est prêt à l’action au service de « L’Allemagne secrète ».
« Geheimes Deutschland » (L’Allemagne secrète) est le titre d’un poème de Stefan George écrit au début de la décennie 1920 et paru5 dans le recueil de poèmes Das neue Reich (Le nouveau règne ou Le nouvel Empire) en 1928.
L’Allemagne secrète, à partir de laquelle le « Nouveau Reich » doit se développer, est le cercle, ayant surgi organiquement, de personnes rassemblées autour de Stefan George. L’Allemagne de Stefan George, sensée représenter la vraie Allemagne, est vitale, forte et pure. Elle est une Allemagne parallèle à celle de la société de l’époque, la fausse Allemagne de l’individualisme de la société bourgeoise de la république de Weimar, et doit, à terme, la remplacer. La question est de savoir comment se débarrasser de la seconde. Les idées de Stefan George sont élitistes, hiérarchiques, anti-démocratiques et antirationalistes.
Le nouveau régime
Après l’arrivée d’Adolf Hitler au poste de chancelier, le 30 janvier 1933, le clivage au sein du cercle des adeptes de Stefan George s’accentue. Le comte Woldemar von Uxkull-Gyllenband6, professeur d’histoire à Tübingen, compte parmi ceux qui voient dans le IIIe Reich la réalisation du « nouveau Reich » prophétisé par le maître et donne, le 12 juillet 1933, pour le 65è anniversaire de ce dernier, une conférence dans laquelle il le présente en tant que prédécesseur intellectuel de la révolution nationale-socialiste.
Lorsqu’Ernst Kantorowicz reçoit, à l’instar de Stefan George, le texte de cette conférence, il est horrifié par celui-ci car, à cette époque, des mesures politiques prises par les nouveaux dirigeants de l’Allemagne visent les juifs, alors qu’il en est un. En conséquence, il décide de s’opposer publiquement à la tentative de récupération des idées de Stefan George par le nouveau régime.7 Ernst Kantorowicz tient un discours8, véritable acte de résistance, le 14 novembre 1933, à l’occasion du départ de sa chaire universitaire de Francfort-sur-le-Main, intitulé l’« Allemagne secrète » et au sein duquel il affirme l’incompatibilité entre le Reich d’Adolf Hitler et celui de Stefan George. Ernst Kantorowicz prétend que Karl Wolfskehl a transformé, dans son texte paru dans le Jahrbuch für die geistige Bewegung de 1910, le sens du terme « Allemagne secrète » qui avait été façonné par Paul de Lagarde et repris par Julius Langbehn qui lui a donné l’acceptation dont Rembrandt, Ludwig van Beethoven et Johann Wolfgang von Goethe parlent en tant que « Le vrai empereur de l’Allemagne secrète ». Selon Kantorowicz, Wolfskehl se réfère, dans cette expression, « à des individus, porteurs de certaines forces allemandes encore endormies dans lesquelles l’être futur le plus sublime de la nation est préfiguré ou déjà incarné. » Il voit dans « l’Allemagne secrète » « les récipiendaires d’une force immuable, éternellement la même, qui reste secrète comme un courant sous-jacent sous l’Allemagne visible et qui ne peut être saisie qu’à travers des images ». Cette « Allemagne secrète », réveillée par la nouvelle poésie, n’existe que dans l’environnement de Stefan George et ne doit jamais être identifiée à un régime politique existant car elle relève du domaine spirituel, du choix, de l’âme et de l’esprit et pas de la naissance, ni du sang et n’a ni un caractère national, ni un caractère racial : « L’Allemagne secrète est toujours proche, voire présente, comme un jugement dernier et une révolte des morts. […] Un règne à la fois de ce monde et pas de ce monde, un règne qui est là et pas là, un règne à la fois des vivants et des morts, qui se transforme et est cependant éternel et immortel. » Il la définit en tant que « communauté secrète des poètes et des sages, des héros et des saints, des sacrifiants et des sacrifiés, que l’Allemagne a engendrés et qui se sont offerts à l’Allemagne. »9
Au printemps 1933, Stefan George rejette la demande du ministre de la Propagande du IIIe Reich Joseph Goebbels lui proposant la présidence d’une nouvelle Académie allemande de poésie purgée d’écrivains considérés par le nouveau régime comme indésirables, tout en saluant le fait que celle-ci soit « sous un signe national », en ne niant absolument pas être l’ancêtre du nouveau mouvement national, en ne mettant pas de côté sa collaboration spirituelle, en précisant que les lois des domaines spirituel et politique sont très différentes et que leur rencontre constitue un processus extrêmement compliqué.10
Stefan George part s’installer en Suisse, dans le Tessin, où il passe depuis plusieurs années l’hiver. Les frères Stauffenberg l’accompagnent en cours de route. Ces derniers réagissent différemment à l’avènement du IIIe Reich : Berthold et Alexander de manière réservée, Claus, qui aurait pris part à des manifestations publiques en faveur d’Adolf Hitler, avec approbation.
Alors que son disciple Karl Wolfskehl, juif, attendait, en l’implorant par des lettres, de lui une prise de position par rapport au national-socialisme et un soutien envers les juifs, ou, au moins envers ceux membres de son cercle, Stefan George se tait. Klaus Mann écrit : « Nous espérons que le fait qu’il se taise signifie un rejet. » et « Hitler et Stefan George, ce sont deux mondes qui ne pourront jamais couler un vers l’autre. Ce sont deux sortes d’Allemagne. »11 Pour Stefan George, les mesures prises contre les juifs par le IIIe Reich apparaissent probablement secondaires par rapport au destin futur de l’Allemagne, ce pays devant, selon lui, affronter de graves difficultés au cours des décennies à venir.
La mort du maître
Alors que Stefan George est mourant, les trois frères Stauffenberg sont autorisés à lui rendre visite. Ernst Kantorowicz en est, cependant, dissuadé, par l’entourage du poète qui compte en son sein Robert Boehringer, l’exécuteur testamentaire de Stefan George, afin d’éviter de froisser les autorités nationales-socialistes allemandes par la présence d’une personne juive et de ne pas, ainsi, troubler la réception en Allemagne de l’œuvre.12
Stefan George meurt à l’hôpital de Locarno, le 4 décembre 1933, après avoir eu la prudence de ne pas se prononcer de manière décisive sur le nouveau régime, dont il n’a pu voir que les premières articulations.13
Lors de la cérémonie funèbre de Stefan George, qui se déroule en petit cercle, un fossé apparaît entre les personnes favorables et opposées au national-socialisme. L’envoi par le gouvernement allemand d’une couronne de lauriers avec un ruban portant une croix gammée entraîne une dispute entre ceux qui désirent cacher ou enlever cette dernière et ceux qui veulent la laisser apparaître. Parmi les participants figurent Hanna et Karl Wolfskehl, ainsi que les trois frères Stauffenberg et Ernst Kantorowicz.
Robert Boehringer est désigné par Stefan George, peu avant le décès de ce dernier, en tant que légataire universel. Boehringer vivant en Suisse, cela complique les actions en Allemagne et Claus von Stauffenberg devient héritier de remplacement de Stefan George.
Durant l’été 1934, Claus von Stauffenberg prête serment, comme ses camarades de régiment, au Führer de l’Empire et du peuple allemand et le reconnaît en tant que dirigeant de l’armée.
Claus von Stauffenberg négocie, à la fin des années 1930, avec le Conseil municipal de Bingen am Rhein, l’aménagement de la maison familiale de Stefan George en tant que monument.
Chaque année, les frères Stauffenberg et Robert Boehringer se réunissent à Minusio à l’occasion de l’anniversaire de la mort du maître.
Les conséquences de l’attentat
Claus von Stauffenberg, après avoir placé une bombe au quartier général d’Adolf Hitler, le 20 juillet 1944, à Rastenburg, en Prusse orientale, est fusillé le lendemain à Berlin. Il crie, selon les témoins, « Es lebe das geheime Deutschland! (Vive l’Allemagne secrète !) ou « Es lebe unser heiliges Deutschland! » (Vive notre sainte Allemagne !). La salve terrible retentit lorsqu’il prononce la fin de la phrase.
Dans son livre14 sur Stefan George, l’historien suisse Edgar Salin rapporte les propos tenus oralement par son ancienne élève la comtesse Marion Dönhoff : le cercle des résistants de 1943-1944, auquel elle avait été liée, avait désigné, sous l’influence du comte Claus von Stauffenberg, leur mouvement en tant qu’« Allemagne secrète » (Geheimes Deutschland ou Heimliches Deutschland).
Le 10 août, Berthold von Stauffenberg, frère et proche confident de Claus, est condamné à mort pour avoir pris part au complot, lié à l’attentat, en vue de tenter de renverser le régime national-socialiste. Il est exécuté, le jour même, par pendaison.
Le troisième frère Stauffenberg, Alexander, le jumeau de Berthold, est emprisonné en raison de son lien de parenté avec les deux autres, ainsi que la famille Stauffenberg, y compris les enfants et les parents proches.
Le siège familial des Stauffenberg à Lautlingen dans le Souabe est passé au crible, de fond en comble, par la Gestapo qui y trouve de nombreux documents liés au poète Stefan George, parmi lesquels figure le testament qui désigne Robert Boehringer à Genève en tant qu’héritier principal, ainsi que Berthold comme héritier secondaire.
La conjointe d’Alexander, Melitta Schiller, issue d’une famille judéo-russe d’Odessa, pilote d’essai dans l’industrie, ne doit plus utiliser le nom de famille Stauffenberg, mais est contrainte de s’appeler Schenk. Elle est touchée, lors d’un vol, par la chasse britannique et arrive à réaliser un atterrissage d’urgence. Elle décède, quelques heures plus tard, des suites de ses blessures, le 8 avril 1945. À l’issue de la guerre, Alexander n’a plus de logement car son appartement de Wurtzbourg a été détruit par les bombes et il a perdu son emploi de professeur d’université à Strasbourg. En 1948, les éditions Delfin publient un opuscule de 15 pages comportant de la poésie écrite en 1943 par Alexander Stauffenberg à l’occasion du dixième anniversaire de la mort de Stefan George.
Lionel Baland (Site de la revue Eléments, 24 septembre 2024)
Notes :
1 – Il a crié soit „Es lebe das Geheime Deutschland!“ (Vive l’Allemagne secrète !), soit „Es lebe das heilige Deutschland!“ (Vive la sainte Allemagne !).
2 – Jürgen W., Gansel, « Stefan George. Governor of the Secret Germany. », in : Conservative revolution. Responses to liberalism and modernity. Volume Five, Edited by Troy Southgate / Black front press, s.l., 2022, p. 107 à 112, ici p. 110.
3 – Olena Semenyaka, « Friedrich Nietzsche as the ‘’founder’’ of Conservative revolution. », in : Conservative revolution. Responses to liberalism and modernity. Volume Five, Edited by Troy Southgate / Black front press, s.l., 2022, p. 7 à 33, ici p. 24.
4 – p. 1 à 18
5 – p. 59 à 65
6 – Woldemar von Uxkull-Gyllenband se distancie ensuite rapidement du nouveau régime.
7 – Achim Aurnhammer, Wolfgang Braungart, Stefan Breuer und Ute Oelmann (Hrsg.), Stefan George und sein Kreis. Ein Handbuch, 2. Auflage, in Zusammenarbeit mit Kai Kauffmann. Redaktion: Birgit Wägenbaur, De Gruyter, Berlin/Boston, 2016, p.84-85.
8 – Ernst Kantorowicz, „Das Geheime Deutschland. Vorlesung, gehalten bei Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit am 14. November 1933. Edition von Eckhart Grünewald“, in: Robert L. Benson, Johannes Fried (Hgg.), Ernst Kantorowicz. Erträge der Doppeltagung, Institute for Advanced Study (Princeton) / Johann Wolfgang Goethe-Universität (Frankfurt), Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1997, p. 77 à 93.
9 – Ibid., ici p. 80.
10 – Robert E Norton, Secret Germany. Stefan George and his circle, Cornell University Press, Ithaca & London, 2002, p. 728-729.
11 – Klaus Mann, in : Die Sammlung. Literarische Monatsschrift unter dem Patronat von André Gide, Aldous Huxley, Heinrich Mann, hrsg. von Klaus Mann, Reprint en 2 vol., Rogner und Bernhard bei Zweitausendeins, München, 1986, S. 98ff.
12 – Benjamin Demeslay, Stefan George et son cercle. De la poésie à la Révolution conservatrice, collection Longue Mémoire de l’Institut Iliade, La nouvelle librairie, Paris, 2022, p. 3-4.
13 – Introduction à Stefan George, Poésies complètes. Traduction et édition de Ludwig Lehnen. Nouvelle version, HD Éditions, Villiers St-Josse, 2023, p. 12.
14 – Edgar Salin, Um Stefan George. Erinnerungen und Zeugnisse, Helmut Küpper vormals Georg Bondi, München / Düsseldorf, 1954.