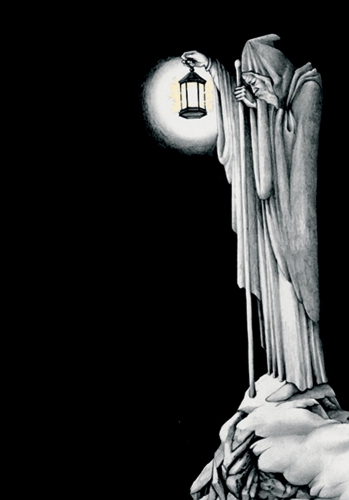Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Caroline Galactéros, cueilli sur son blog Bouger les lignes et consacré à la situation géopolitique du moment qui offre à l'Europe la possibilité de prendre (enfin...) son indépendance stratégique... Docteur en science politique, au diteur de l'IHEDN, Caroline Galactéros est l'auteur de Manières du monde, manières de guerre (Nuvis, 2013) et intervient régulièrement dans les médias. Elle vient de créer, avec Hervé Juvin, Geopragma qui veut être un pôle français de géopolitique réaliste.
Europe : Sortir de l’enfance stratégique
Il était une fois Europe, jeune princesse naïve et capricieuse, enfant gâtée ne voulant grandir à aucun prix. Elle se convainquait chaque jour qu’elle échapperait aux sorcières et autres monstres malfaisants du vaste monde si elle se soumettait gentiment à son Prince charmant. Celui-ci l’isolait dans une tour imprenable, mais, fièrement juché sur son blanc destrier de redresseur de torts universels, maniait aussi vaillamment l’épée autour d’elle. Pour son bien naturellement, il l’empêchait de se faire des amis, décidait de ses fréquentations, de ses projets et même de ses rêves. Son autorité implacable lui faisait si peur qu’elle subissait ce joug avec docilité, le confondant avec une protection sûre et amicale. Le jour de la déception vint lorsqu’elle comprit enfin, à force d’avanies, que son sauveur n’était qu’un rustre égoïste et jaloux qui faisait le vide autour d’elle, se moquait bien de ses rêves de liberté et de grandeur, et l’entraînait dans des impasses dangereuses pour sa vertu comme pour ses intérêts. Elle résolut alors de lui échapper et de grandir enfin, la vue dessillée mais sans rancune, sortant dans un même mouvement de l’enfance et de l’ignorance, déterminée à se faire une place à elle dans le monde des Grands… Elle ne se maria pas, mais eut beaucoup d’enfants.
Nous en sommes là. La dernière « crise » déclenchée par la sortie américaine de l’accord sur le nucléaire iranien est l’occasion pour l’Europe de faire enfin sa crise d’adolescence. Sortir de l’enfance stratégique est urgent. Il nous faut « tuer le père » pour savoir qui nous sommes et pouvons être. Comment faire ? Est-il possible de conquérir notre indépendance sans fracas, sans éclat, d’instaurer et de démontrer la légitimité d’une distanciation douce vis-à-vis de notre flamboyant tuteur américain, premier stade de l’autonomie de pensée et d’action ? Comment s’émanciper sans déclencher un mélodrame et surtout des réactions vengeresses ? L’Amérique a toujours confondu alliance et allégeance, amitié et servilité. Ce qui est bon pour elle s’impose à ses alliés, même si c’est aux antipodes de leurs intérêts propres. Le mythe du ruissellement de la richesse s’applique. Elle prend les meilleurs morceaux, eux les rataillons, et ils doivent encore s’incliner et remercier. Pourquoi ? Nul ne le sait plus. Parce que les États-Unis furent notre allié décisif durant les deux guerres mondiales ? Mais la Russie aussi…
L’Europe fait donc face à un choix qui n’est ni facile ni naturel. La faiblesse est naturelle, le courage l’exception. L’Europe est surtout divisée sur à peu près tous les sujets… C’est donc une révolution culturelle et mentale qu’elle doit oser, en prenant conscience de l’énormité du dernier camouflet que vient de lui infliger Washington qui a joué à quitte ou double… et a, semble-t-il, perdu. L’Amérique cherchait à polariser ses alliés-vassaux autour d’elle dans la désignation d’un nouvel ennemi après avoir connu un succès mitigé dans la diabolisation de Moscou ? Elle n’a pour l’instant réussi qu’à les polariser contre elle.
L’Europe doit donc changer de posture pour changer enfin de stature et de statut dans le concert international et d’abord aux yeux des Américains. La servilité en effet ne suscite que mépris et indifférence. On rétorquera que c’est trop dangereux, que nos entreprises vont se faire de nouveau attaquer et mettre à l’amende si elles osent l’insoumission à l’extraterritorialité du droit américain. Mais le principe actif des sanctions s’est dissous dans leur application outrancière. En Iran comme en Russie, trop de sanctions tue les sanctions et provoque la résistance entêtée du sanctionné et de tous ceux qui subissent de plein fouet les dommages collatéraux de sa mise à l’index. Les États-Unis jouent sur la division des Européens pour semer la peur parmi leurs gouvernements et entreprises. Si Bruxelles protégeait aussi son marché, menaçait de boycott et imposait de très lourdes sanctions aux opérateurs américains en cas de représailles américaines envers des entreprises commerçant avec l’Iran ou la Russie, que ferait-elle de si scandaleux finalement ? Elle imiterait juste le président américain dans sa tactique de mise sous pression maximale du concurrent commercial avant l’entrée en négociation…
Et puis… le cynisme du discours occidental sur Le Bien, Le Mal, la morale, le terrorisme est si patent qu’il a perdu toute crédibilité. Ce n’est pas l’Iran qui commet depuis vingt ans des attentats terroristes en Europe, ce sont bien les groupuscules islamistes sunnites que l’Occident tolère ou appuie dans tout le Moyen-Orient depuis près de quarante ans. C’est bien l’État islamique (EI) qui vient de revendiquer l’attentat en plein Paris de l’un de ses soldats hébétés. C’est l’EI toujours, qui renaît au Yémen de ses prétendues cendres (plutôt des braises encore bien rougeoyantes), et dont la Coalition néglige la réduction définitive, préférant braquer le projecteur sur la Perse qu’il faut estourbir sans attendre pour tenter de renverser un rapport de force régional défavorable à force d’entêtement dans des alliances incohérentes.
L’axe Washington-Tel Aviv-Riyad concentre sa vindicte sur Téhéran, source désignée du mal, qui sert en fait de leurre permettant d’escamoter le véritable scandale : les États-Unis et la Grande-Bretagne ‒ comme la France malheureusement ‒ ont soutenu durant des années les succédanés de l’ogre officiel Al-Qaïda qui pourtant fit tomber les tours jumelles de New York, secoue depuis la planète de centaines d’attentats, l’ensanglante de dizaines de milliers de morts à l’occasion des conflits irakien, libyen et syrien… que l’Occident a déclenchés ou favorisés. On a donc atteint les limites du cynisme. Le « plus c’est gros, plus ça passe » ne marche plus ; d’autant que, dans ce capharnaüm oriental, La Russie a beau jeu d’avancer ses pions en marchant sur les plates-bandes américaines, cherchant notamment avec Riyad des accords commerciaux, militaires et même politiques (dans la perspective du règlement du conflit syrien, puisque l’Arabie saoudite patronne toujours bien des « rebelles »). Quant à la Chine, elle observe avec gourmandise la foire d’empoigne de ces Occidentaux trop pressés, et attend de voir avec qui finalement elle assurera ses intérêts énergétiques et sa pénétration économique de l’Europe, et sur quels points d’appui moyen-orientaux.
La question urgente est désormais celle de la forme optimale du système de gouvernance mondiale. Si ce n’est plus l’ONU, alors quoi ? La loi du plus fort, celle de la jungle, celle du pur argent, celle d’une réalité virtuelle se substituant à celle qui nous dérange ou que l’on ne veut pas comprendre ? Notre entêtement à vouloir à tout prix que les relations internationales obéissent à des principes moraux nous rend incapables d’analyser le réel, d’agir sur lui et de voir le prosaïsme structurel du jeu international. Mais il nous empêche aussi, paradoxalement, de prendre des décisions humaines alors que nous nous targuons de défendre urbi et orbi nos « valeurs ». Or les grandes déclarations de principe sur l’avènement souhaitable de la démocratie au Moyen-Orient, sur les « bouchers » et autres « dictateurs sanguinaires » font le jeu des pires phalanges terroristes et beaucoup, beaucoup de morts, jusque chez nous. Ce discours faussement irénique nourrit la dislocation des États laïcs multiconfessionnels et justifie les régressions politiques dangereuses que sont le communautarisme et la confessionnalisation des antagonismes sociaux, vendus aux masses comme des moteurs d’affirmation identitaire et de liberté, alors que ce sont ceux de leur soumission ultime.
Et l’Europe dans ce magma ? Ne peut-elle enfin apprendre à dire non à Washington et voir qu’il en va de son intérêt politique, économique, culturel et stratégique de mettre à profit sa position médiane entre Washington et Moscou, piliers d’un Occident janusien qui a du mal à se concevoir dans sa globalité. Faut-il rappeler que (même) le Donald Trump de 2016, en businessman réaliste et de bon sens, l’avait compris qui voulait un véritable reset de la relation avec Moscou… avant qu’on ne le remette dans le droit chemin de l’anti-russisme primaire. L’alignement et la servilité ne sont pas une fatalité. Surtout pour la France qui n’a rien à y gagner, mais doit comprendre qu’elle a une place particulière aux yeux du monde. Quand Paris se trompe, se fourvoie, se couche, c’est un peu de l’espoir secret des autres Européens – et de bien des pays du monde qui croient encore en notre singularité et en notre capacité à sortir du rang – qui s’étiole.
Ultimement, si l’Europe veut exister stratégiquement, si elle souhaite enfin compter et être crue quand elle s’engage dans un conflit ou une médiation, elle doit faire sauter le tabou qui brûle toutes les lèvres : celui de l’OTAN. L’Alliance atlantique est-elle à jamais LA structure « naturelle » garantissant la sécurité européenne ? Peut-être est-ce vrai en matière de défense du continent contre une véritable agression (pas contre la construction délirante d’un bellicisme russe justifiant nos propres déploiements menaçants type pays baltes…). Certainement pas en matière de déploiement à l’extérieur, car l’OTAN, de fait dominée et dirigée par Washington depuis toujours et à jamais, est avant tout au service de la politique étrangère des États-Unis.
Tant que l’UE ne sera pas capable d’évaluer le degré d’adéquation des mécanismes et décisions de l’Alliance avec les siens propres, d’affirmer l’obligation d’inscrire ses opérations dans un cadre onusien et surtout la nécessité pour elle de compter en tant qu’acteur stratégique autonome face aux États-Unis, à la Russie et à la Chine, elle demeurera mineure stratégiquement. Pour sauver l’Europe, il faut donc oser éliminer les tares de naissance qui la minent depuis l’origine et ne sont pas que psychologiques. L’esquive interminable de la question pourtant cardinale de la souveraineté collective sous prétexte que l’économie finirait par entraîner la convergence politique n’est plus tenable. Il faut s’y atteler et définir les contours et limites de cette souveraineté complémentaire, dans le respect scrupuleux de celle des États membres.
Certains Européens objecteront que la sujétion atlantique fait leur affaire car ils n’ont pas les moyens militaires de cette indépendance ? Fort bien. Mais nous, oui. C’est donc à nous d’initier le mouvement d’émancipation et nous ferons école progressivement, lorsque l’intérêt d’une position propre deviendra évident pour échapper à la vaste manœuvre américano-chinoise de réalignement du monde autour de leur nouveau duo-pôle. Que nous a d’ailleurs sérieusement apporté depuis dix ans la réintégration du commandement militaire intégré de l’Alliance ? Cette question ne peut plus être éludée par un pays comme le nôtre. Ou alors il faut cesser de prétendre à une influence quelconque en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique et admettre une destinée de supplétif progressivement dissous dans une prétendue « solidarité euro-atlantique » qui n’est que l’autre nom de la soumission et du renoncement.
Partir demande parfois du courage. Rester peut éventuellement se justifier mais requiert une véritable analyse, pas simplement des cris d’orfraie sur « l’impensable » et « l’évident ». Rien n’est plus évident. Les cadres stratégiques de pensée de l’après-« guerre froide » ont tous implosé, et nous rassurer en enfouissant la tête dans le sable ne nous apportera rien d’autre que l’asphyxie. Encore une fois, il ne s’agit nullement d’embrasser la Russie sur la bouche ou de jeter le gant à Washington. Il s’agit d’avoir conscience de soi, de ce que l’on est, de ce que l’on représente, de ce que l’on peut et doit faire pour concourir à un apaisement global des foyers de tension de plus en plus nombreux et à une intelligence du monde et des hommes. Il s’agit de s’en donner les moyens, au risque de l’impopularité immédiate qui est presque toujours la première marque de la grandeur d’une décision. Disruptive indeed !
Caroline Galactéros (Bouger les lignes, 16 mai 2018)