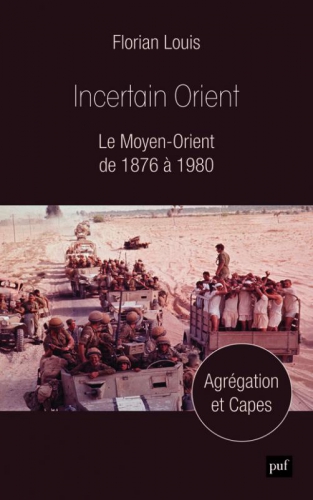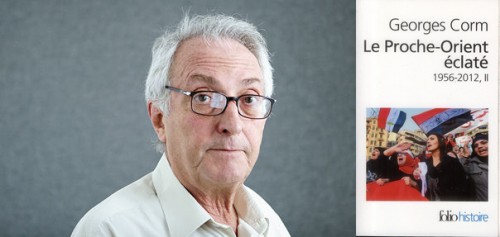Le Moyen-Orient est en pleine recomposition. Comment expliquez-vous cette évolution ? Etait-elle en germe, et depuis quand ?
Il y a beaucoup d’observateurs qui pensent en effet que nous sommes dans l’ère de la fin des accords franco-britanniques dits Sykes-Picot (1916) qui ont balkanisé ce qu’on appelait, au début du siècle passé, les provinces arabes de l’Empire ottoman. Ou d’autres qui parlent de période de transition de régimes autoritaires vers des régimes de type démocratique. Je pense que dans les deux cas, nous sommes loin de tels scénarios. En effet, la remise en cause des Etats existants paraît quand même assez difficile, sauf à généraliser des situations de chaos partout. Si nous prenons le modèle syrien, ou éventuellement le modèle libyen où il y a emploi massif d’armes venues de l’extérieur, à la limite on peut dire qu’il y a des zones d’influences qui se mettent en place sous l’égide des grands acteurs régionaux et internationaux. Mais enfin je ne vois pas d’Etats disparaître de la carte et de nouveaux Etats être créés et reconnus, comme cela a pu être le cas avec l’ex-Yougoslavie. Probablement si nous étions en contact géographique direct avec l’Europe, ceci aurait pu arriver, mais sur l’autre rive de la Méditerranée cela paraît quand même nettement plus difficile. D’un autre côté, pour ce qui est de la transition vers la démocratie, le problème qui se pose aujourd’hui est essentiellement celui de la nature des mouvances islamiques sur lesquelles les milieux européens et américains ont misé depuis bien des années. Ces mouvances, trop souvent idéalisées, ont désormais montré leur vrai visage, celui d’un autoritarisme et d’un désir de contrôle des libertés individuelles.
Nous avons donc un problème aigu, important, qui va déterminer l’avenir : est-ce que les mouvances de type modernistes, laïques ou attachées aux libertés individuelles et qui refusent le référent religieux dans le fonctionnement d’un système politique vont pouvoir s’affirmer face aux mouvances islamiques ? On peut être inquiet si l’on prend en compte le fait que ces dernières jouissent jusqu’ici de l’appui total de l’Occident et qu’elles bénéficient en outre de très importants financements en pétrodollars, en provenance des royautés et émirats pétroliers alliés des Etats-Unis et de l’Europe. Ce sera donc une très longue bataille, très intéressante. C’est cette bataille qui va décider du sort du monde arabe et de la possibilité pour ces pays arabes d’établir non seulement de véritables règles démocratiques, mais aussi une véritable indépendance par rapport aux forces régionales et internationales.
Concernant la crise syrienne, de nombreux acteurs sont impliqués (Qatar, Arabie Saoudite, Turquie, Israël). Pourquoi ?
Mais vous avez oublié dans cette liste la France, l’Angleterre, les Etats-Unis ! J’ai eu l’occasion d’expliquer dans diverses interviews que dès le départ, il y a une différence fondamentale entre la révolte syrienne et ce qui s’est passé en Tunisie, en Egypte et au Yémen. En Syrie, vous aviez un malaise rural important depuis 2007, du fait d’une série d’années de sècheresse, puis du fait que le gouvernement a voulu faire plaisir au Fonds Monétaire International et aux pays occidentaux, et qui s’est mis à supprimer pas mal des subventions dont jouissait l’agriculture. Les observateurs de terrain en Syrie savaient que le monde rural, autrefois très privilégié par le régime et qui avait longtemps constitué sa base essentielle, commençait vraiment à connaître un état de mécontentement grandissant.
Quand vous regardez où ont eu lieu les manifestations en Syrie, quelle était la composition sociale des manifestants et quel était leur nombre, on voit bien qu’ils étaient des ruraux pauvres dans des régions rurales pauvres périphériques, situées aux frontières avec la Jordanie et la Turquie. Les images parlaient d’ailleurs d’elles-mêmes. Elles contrastaient avec les grandioses manifestations de masse, tunisiennes, yéménites ou égyptiennes, où tous les groupes sociaux et toutes les classes d’âge étaient au rendez-vous. On a très vite assisté à l’arrivée d’armes aux mains des groupes d’opposants qui se sont constitués sur le terrain. De plus, il y a eu le déchaînement d’une guerre médiatique absolument spectaculaire contre le régime syrien. Or, les manifestations de masse en Syrie ont eu lieu en faveur du régime et contre l’opposition armée ; dans ces manifestations on a vu toutes les classes sociales, tous les groupes d’âge et de très nombreuses femmes…
C’est donc une différence absolument fondamentale par rapport aux autres situations de révoltes dans le monde arabe. Par ailleurs, l’armée ne s’est nullement effondrée et elle a fait face avec de plus en plus de détermination et de violence à l’arrivée, de l’international, de combattants qu’on appelle à tort Djihadistes, parce que lorsque des musulmans tuent d’autres musulmans, cela n’est pas un djihad. On a donc eu en Syrie un scénario qui s’est mis en place qui est en train d’aboutir à une destruction systématique de la société syrienne et de sa richesse matérielle (infrastructures, habitations, potentiel industriel). C’est une répétition de ce que la communauté internationale a fait subir à l’Irak et demain nous verrons – comme cela s’est passé en Irak ou auparavant au Liban – que sous prétexte de reconstruction, le pays sera pillé par des grosses entreprises de BTP arabes ou turques ou internationales. On a déjà vu cela au Liban où, au sortir des quinze ans de violence entre 1975 et 1990, le pays a été enfoncé dans une dette invraisemblable et où après vingt-deux ans de reconstruction il n’y a toujours pas d’eau ou d’électricité courantes ! Et en Irak, malgré son énorme richesse pétrolière, les grandes infrastructures d’eau et d’électricité ne sont toujours pas complètement reconstruites. Il faut donc s’attendre à un même scénario en Syrie.
Par ailleurs, il faut bien voir que les données internes syriennes sont tout à fait secondaires dans le conflit, car la Syrie est devenue un champ d’affrontement colossal entre, d’un côté les deux grandes puissances montantes, la Chine et la Russie, ainsi que l’Iran, et de l’autre les pays occidentaux, l’OTAN… dont le but est très clairement de faire sauter les derniers verrous anti-israéliens de la région, ces derniers verrous étant essentiellement constitués de l’axe Iran-Syrie-Hezbollah qu’on appelle, pour le dénigrer et pour donner dans le sensationnel, « l’arc chiite ». Beaucoup d’analyses se font à base de sensationnel communautaire qui est instrumentalisé pour faire croire que le conflit est entre chiites et sunnites à l’échelle régionale, alors qu’il s’agit d’un problème de géopolitique très profane. Il y a aussi des considérations pétrolières et gazières qui entrent en jeu.
Pensez-vous qu’un embrasement régional pourrait avoir lieu dans le contexte de la crise syrienne, notamment au Liban ?
Déjà en 2007, dans la revue Futurible, j’avais évoqué un scénario de troisième guerre mondiale éventuelle, déclenchée autour la question du développement de la capacité nucléaire iranienne. Car les passions anti-iraniennes étaient déjà d’une virulence peu commune qui n’a pas baissé de registre. Le reproche fait à l’Iran étant sa rhétorique anti-israélienne et surtout son aide au Hezbollah libanais passant par la Syrie. Aussi, l’axe Iran, Syrie, Hezbollah est-il considéré depuis des années comme à abattre dans les milieux de l’OTAN. Or, il faut bien voir que même si cet axe est réduit ou affaibli ou disparaît, il rebondira ou sera reconstitué différemment, et ceci tant que l’Etat israélien continuera de se comporter comme il se comporte vis-à-vis des Palestiniens qui continuent d’être dépossédés de ce qu’il leur reste de terre, mais aussi vis-à-vis des Libanais qu’ils ont énormément fait souffrir entre 1968 (date du premier bombardement contre le pays) et 2000, lorsque l’armée israélienne est forcée de se retirer du pays après 22 ans d’occupation, puis tente en 2006 de supprimer le Hezbollah par une série de bombardements massifs qui durent 33 jours.
On a déjà assisté, à plusieurs reprises, à l’espoir d’avoir « débarrassé » le Moyen-Orient des forces hostiles à la domination israélo-américaine de la région. Ils ont tous été déçus. Cela a été le cas lors de la seconde invasion du Liban par Israël en 1982, qui a abouti à l’exil de l’OLP en Tunisie et dans d’autres pays loin des frontières israéliennes. Puis, cela a été le cas avec la conférence de Madrid et les accords israélo-palestiniens d’Oslo en 1993. Enfin cela a recommencé avec l’invasion de l’Irak en 2003 qui a fait penser que le Moyen-Orient serait en paix grâce à l’élimination de Saddam Hussein. C’est pour cela que je parle des « passions » américaines et européennes en faveur d’Israël, qui empêchent toute possibilité raisonnable de rendre aux Palestiniens leurs droits. Tant que cette situation n’est pas réglée conformément aux lois internationales, et non pas par la force, le Moyen-Orient va rester en ébullition avec tous ces risques d’affrontements dont nous parlons, et qui peuvent effectivement s’embraser.
Ceci dit, il faut bien voir que dans ces passions, la folie n’est pas totale, c’est-à-dire que les Etats-Unis, après des déploiements militaires qui leur ont coûté énormément (Afghanistan et Irak) et où curieusement ils ne sont pas venus à bout de Al Qaïda, n’ont plus envie d’aventures militaires extérieures. Ce qui est une bonne chose. Maintenant, ils ont trouvé des relais régionaux qui sont notamment la Turquie, qui avait l’air prête à se battre jusqu’au bout contre la Syrie, quatre ans seulement après avoir signé des accords de coopérations, d’amitiés, de fraternité, de libre échange avec ce pays. Ils ont trouvé également les pétrodollars qui financent les armées de combattants venus de l’extérieur.
L’on s’attendait, dans ces Etats intervenants extérieurs, à ce que l’armée syrienne s’effondre rapidement et tout le régime avec. Mais cela n’est pas arrivé, à la surprise générale de tous ceux qui connaissaient très mal le contexte syrien. Et aujourd’hui, l’armée semble reprendre le dessus militairement. Toutefois, tant que le gouvernement syrien ne pourra pas contrôler ses frontières, qui sont très longues avec la Turquie, l’Irak, la Jordanie et le Liban, les combats et la destruction de la Syrie vont continuer. Quant à ce projet de conférence à Genève, ce n’est qu’un mauvais théâtre. Il me rappelle celui d’il y a quarante ans, lorsque les soviétiques réclamaient une conférence internationale sur la Palestine à laquelle ils se seraient associés. Or, il n’y a eu qu’une seule séance orpheline d’apparat, les Américains et les Israéliens ne souhaitant pas accorder de l’influence à l’URSS dans ce conflit. Donc je suis très sceptique face à ce projet de conférence. Jusqu’ici, nous voyons des rencontres américano-russes sur la Syrie pour organiser une conférence entre les parties au conflit, mais sitôt la réunion terminée, les déclarations des parties au conflit contredisent la volonté d’apaisement.
Concernant les retombées sur le Liban, elles sont très intéressantes. Le gouvernement libanais a prétendu sagement vouloir rester neutre dans le conflit syrien. Ceci en application du slogan qui existe depuis des années : « le Liban d’abord ». Il s’agit d’ailleurs d’un slogan que même l’OLP avait adopté après sa sortie de Beyrouth en 1982 en vertu duquel « la Palestine d’abord ». On le trouve aussi en Irak après l’invasion américaine et on l’entend dans les milieux de l’opposition syrienne. Or, l’on a vu combien ce slogan a abouti à affaiblir les dirigeants de l’OLP qui sont impuissants devant la colonisation, mais à affaiblir aussi l’Irak.
Au Liban, ceux qui ont porté ce slogan ne l’appliquent pas, puisqu’ils sont les premiers à s’impliquer militairement par l’envoi de combattants dans la situation syrienne, de même que le Hezbollah le fait, l’arrivée de son armement dépendant largement de la survie du régime syrien, et donc aussi à terme sa propre survie. C’est pourquoi je pense que l’insécurité va demeurer sur toutes les zones géographiques libanaises limitrophes à la Syrie, puisque les combattants vont et viennent. Tout cela alors que l’armée israélienne est toujours surpuissante et a vraisemblablement des velléités d’intervenir à nouveau au Liban dans l’espoir de réussir à faire disparaître le Hezbollah. Cependant, je ne pense pas que l’insécurité va se propager sur tout le territoire. Certes, il y a à Saïda ce cheikh salafiste, radical et anti-Hezbollah qui veut faire le coup de feu contre ce parti. Il est brusquement apparu sur la scène libanaise depuis un an, vraisemblablement financé par les pétrodollars saoudien ou Qatari. La ville de Saïda connaît donc une période troublée, mais dans l’ensemble, la population de la ville est calme, à l’inverse de la ville de Tripoli, qui peut se laisser gagner par le radicalisme islamique. Par contre, plus inquiétant est le délitement des institutions de l’Etat. Mais le Liban sait s’autogérer.
Que pensez-vous de la situation du pouvoir hachémite en Jordanie ?
Je crois que les Israéliens doivent continuer à se gratter la tête : faut-il essayer de faire un Etat palestinien en Transjordanie, ce qui est un vieille idée d’Ariel Sharon pour régler le problème palestinien, et ce qui permettrait du même coup d’expulser les Palestiniens restés dans ce qui est devenu le territoire d’Israël. Ou bien faut-il mieux conserver cet allié fidèle des Etats-Unis qu’est la monarchie jordanienne, qui garantit la sécurité de la frontière avec Israël. Mais comme je ne suis pas dans le secret de la pensée stratégique israélienne, je n’ai pas de réponse.
Après le deuxième mandat de Barack Obama, voit-on un repositionnement de la politique américaine concernant le Moyen-Orient ?
Non, quand on regarde les Etats-Unis et qu’on cherche à déterminer leurs objectifs principaux, on constate ceci : un, la sécurité d’Israël, et donc qu’Israël puisse continuer de coloniser comme elle le fait depuis 1967. Deux, empêcher l’Iran d’avoir l’armement nucléaire. Dans le sillage évidemment, démanteler l’axe Iran-Syrie-Hezbollah, et ce toujours pour la sécurité d’Israël. Et puis, le contrôle des routes d’approvisionnement pétrolier, et le maintien de l’hégémonie que l’Europe a eu puis que les Etats-Unis ont de concert avec l’Europe sur toute cette zone hautement stratégique pour l’économie et la géopolitique mondiales. C’est très simple à décrypter. Quand Barack Obama a fait son célèbre discours au Caire en 2009, il était dans la droite ligne de la politique américaine traditionnelle, il n’en a pas bougé d’un iota. Ce n’est pas le fait d’inclure la citation de deux versets du Coran dans le texte du discours qui exprime un changement de politique, ce que peut être certains ont naïvement pensé ! Mais simplement les Etats-Unis, comme je disais, sont aujourd’hui beaucoup plus prudents, et cet Etat n’a pas envie de nouvelles aventures militaires extérieures, ce qui est le facteur qui calme le jeu. En tous cas, entre la politique du président George W. Bush et celle de Barack Obama, les mêmes constantes sont affirmées. Lors de son récent voyage en Israël, ce dernier a prononcé des paroles inconditionnellement favorables à l’Etat d’Israël et à sa politique, comme l’ont fait tous les présidents successifs, à l’exception d’Eisenhower et plus accessoirement George Bush père et son ministre des Affaires étrangères, James Baker, qui a protesté énergiquement contre la continuation de la colonisation et a même annulé des aides américaines à l’Etat d’Israël.
Georges Corm, propos recueillis par Sixtine de Thé (Les clés du Moyen-Orient, 21 juin 2013)