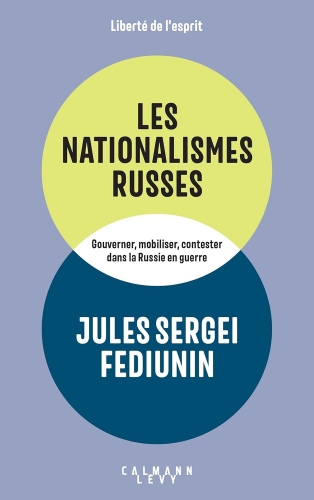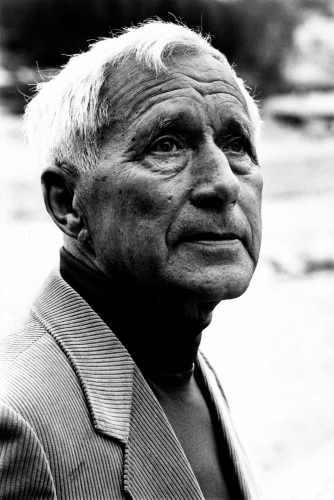La musique de la paix se fait entendre depuis quelques mois au milieu de la guerre en Ukraine. Le sommet organisé en Suisse en juin, sans la Russie, a servi à réaffirmer le soutien de la moitié des pays du monde à l'Ukraine, mais s'est aussi soldé par un appel à négocier avec Moscou, ce qui a ouvert une fenêtre d'opportunité pour une rencontre entre les parties en novembre, alors que le G20 tiendra son grand sommet à Rio, après l'élection présidentielle américaine.
Vladimir Poutine a annoncé de son côté des «conditions de paix» (la souveraineté de la Russie sur la Crimée et sur les quatre oblasts annexés, que Moscou ne contrôle pas entièrement à l'heure actuelle ; la non-adhésion de l'Ukraine à l'Otan ; la levée des sanctions) dont on peut penser qu'elles sont une base de départ pour une négociation.
L'Ukraine semble ouverte à la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien s'est rendu à Pékin, qui avait envoyé un émissaire en 2023 dans plusieurs capitales, y compris Moscou et Kiev, pour parler de la paix. Viktor Orban a commencé sa présidence de l'Union européenne en juillet par une «mission de paix» à Moscou, Kiev et Pékin - très critiquée car effectuée sans aucun mandat de l'Union, alors que la Hongrie n'est pas complètement alignée sur la ligne européenne de ferme soutien à Kiev. Le premier ministre indien s'est lui aussi rendu à Moscou puis Kiev.
Toutes ces évolutions ne sont pas sans lien avec l'impasse du conflit, marqué par une forme de lassitude ukrainienne, et dans la perspective d'un éventuel retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis (devenu cependant moins probable depuis le remplacement de Joe Biden par Kamala Harris). Aucun camp ne paraît aujourd'hui pouvoir l'emporter sur le champ de bataille. Si l'Ukraine a engrangé des succès notables contre la flotte russe en Crimée et dernièrement par son incursion en Russie, celle-ci détruit méthodiquement ses infrastructures énergétiques (c'était le bombardement des infrastructures énergétiques qui avait amené la Serbie à capituler face à l'OTAN en 1999) et profite d'un rapport de force favorable malgré l'aide occidentale à Kiev. Elle représente quatre fois la population et le PIB de l'Ukraine, et les sanctions n'ont pas empêché la mobilisation à plein régime de son industrie d'armement. Elle grignote du terrain sur le front, dans ce qui reste une guerre d'usure et d'attrition, et non une guerre de mouvement et d'offensive qui nécessite une nette supériorité de moyens.
L'opération ukrainienne surprise dans la région de Koursk ne change pas fondamentalement la donne, sinon qu'elle retarde peut-être l'ouverture de négociations. Elle a été contenue (1000 km² sur les 17 millions que compte la Russie, contre 107000 km² contrôlés par Moscou en Ukraine, soit 18 % du territoire de cette dernière). Si l'Ukraine entendait sans doute obtenir un gage et une monnaie d'échange, on peut aussi s'attendre à ce que Vladimir Poutine cherche d'abord à reprendre la totalité du contrôle du territoire russe, tout en poursuivant sa pression dans le Donbass. L'ouverture de contacts russo-ukrainiens secrets, sous l'égide du Qatar, a été rendue publique et interrompue.
À supposer que des négociations réelles puissent s'engager, des obstacles très sérieux hypothèquent un accord de trêve, et encore plus un accord durable.
C'est d'abord évidemment la question territoriale, que complique encore l'affaire de Koursk. Un simple cessez-le-feu reviendrait aujourd'hui à confirmer de facto le gain territorial de Moscou, comme ce fut le cas en Géorgie en 2008, même si l'Ukraine garde son gage en territoire russe, qui oblige la Russie à insister sur le respect de son intégrité territoriale. Une discussion pourrait s'engager sur les frontières, mais elle se heurterait vite à un blocage. Contrairement à la situation en 2014-2015 lorsque l'insurrection du Donbass (soutenue par la Russie) avait conduit aux accords de Minsk sur la réintégration de ces républiques dans l'Ukraine, la Russie a désormais franchi le pas d'une annexion territoriale de territoires et de populations, dans le sud et l'est de l'Ukraine, qu'elle considère comme russes (au-delà de la Crimée, déjà annexée en 2014), et on peut penser qu'elle ne reviendra pas là-dessus volontairement. L'Ukraine de son côté ne peut renoncer à son intégrité territoriale, qui fait partie de l'identité fondamentale des États, et elle trouve d'ailleurs l'appui de la Chine sur ce point, du fait entre autres de la question de Taïwan.
Si aucune des parties n'est en mesure de reprendre l'offensive, la question territoriale a toutes les chances de se solder par un accord de fait pour geler les lignes du front, à travers un armistice (possiblement accompagné d'un dispositif de surveillance et de mesures de confiance), et par l'impossibilité de progresser sur une reconnaissance de droit. Le conflit ukrainien rejoindrait alors un certain nombre d'autres conflits gelés dans le monde, comme le Cachemire, la Corée, Chypre, etc., où une situation de fait n'a pas débouché sur une situation de droit.
Mais la question territoriale n'est qu'une partie du problème. La question plus fondamentale, qui était déjà à l'ordre du jour depuis de nombreuses années, est celle des garanties de sécurité qui pourraient bénéficier à l'Ukraine comme à la Russie. Celles de 1994 (le mémorandum de Budapest confirmant l'intégrité territoriale de l'Ukraine) ont volé en éclat, tout comme l'accord Otan-Russie de 1997 limitant les déploiements de troupes occidentales en Europe orientale. L'Ukraine attend désormais sa sécurité de l'Otan et des Occidentaux, qui ne lui promettent que de continuer à lui livrer des armes et ont gelé le processus d'adhésion. La Russie, si elle n'y est pas forcée par le sort des armes, n'arrêtera pas le conflit pour se retrouver nez à nez avec des troupes de l'Otan de l'autre côté d'une ligne d'armistice (d'où la neutralité demandée par Poutine). Or une neutralité négociée de l'Ukraine par rapport à l'Otan serait une capitulation des Occidentaux par rapport à ce qu'ils ont toujours affirmé sur le droit de l'Ukraine à choisir ses alliances, et n'apporterait aucune garantie de sécurité réelle à l'Ukraine, qui risquerait de subir une nouvelle agression.
Cette question (la sécurité de la Russie par rapport à l'OTAN, la sécurité de l'Ukraine par rapport à la Russie) est en vérité le premier obstacle à l'arrêt des combats. Elle n'avait jamais pu faire l'objet d'une négociation sérieuse, avant la guerre, entre l'Otan et la Russie ou au sein de l'OSCE. Les Occidentaux avaient promis à l'Ukraine (et à la Géorgie) l'entrée dans l'Otan et avaient insisté sur le respect par la Russie des frontières post-soviétiques. Dans l'état d'escalade atteint aujourd'hui par le conflit, entre la Russie et l'Ukraine, et entre les Occidentaux (Otan, UE) et la Russie, on peut craindre qu'une trêve éventuelle ne puisse être qu'une paix armée et fragile, qui ne mette fin ni à l'accumulation des forces ni à la guerre économique.
Il s'ajoute un troisième obstacle de taille sur le chemin d'une normalisation, ou même d'une simple trêve, entre l'Occident et la Russie. C'est le facteur Poutine, qui a franchi le Rubicon en agressant ouvertement l'Ukraine en 2022 (et non plus indirectement, comme en 2014), et qui est désormais inculpé par la Cour pénale internationale pour son rôle présumé dans l'enlèvement d'enfants ukrainiens, sans parler des crimes de guerre commis par l'armée russe. Parler de normalisation, de levée des sanctions, de garanties de sécurité de long terme, de droits des minorités, de retour de la confiance, avec un régime qui a franchi tant de limites, paraît aujourd'hui hors de portée.
Rappelons que dans la guerre de Corée, débutée par l'agression nord-coréenne (encouragée par Staline) en 1950, des pourparlers de paix s'engagèrent entre les parties après la stabilisation du front en 1951, et n'aboutirent qu'après la mort de Staline en 1953. Ils ne débouchèrent que sur un armistice, pas signé à l'époque par la Corée du Sud (qui espérait encore réunifier l'ensemble du pays), qui ne fut jamais transformé en accord de paix.
L'élection présidentielle américaine est évidemment un facteur clé. Kamala Harris se place dans la continuité de Joe Biden sur le soutien à l'Ukraine, mais même si Donald Trump était élu, il n'est pas dit qu'il forcera la main à Kiev pour capituler. Même dans une logique de diplomatie «transactionnelle», quel serait l'intérêt des États-Unis à faire sans contrepartie un cadeau à leurs adversaires : la Russie, mais aussi la Chine qui en sortirait renforcée ? Trump dans son premier mandat n'avait ni normalisé la relation avec la Russie, ni fait la paix avec la Corée du Nord, et il avait durci la politique américaine face à la Chine et à l'Iran.
Malgré ces obstacles, il n'est pas trop tôt pour réfléchir à la fin du conflit et la préparer. Une première étape pourrait être la création d'un format de négociation qui garantirait la place des Européens et de la France. Ce pourrait être, par exemple, le format utilisé dans la négociation nucléaire avec l'Iran, associant les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne (P5 + 1), ou dit autrement les trois grandes puissances européennes avec les États-Unis, la Chine et la Russie (E3 + 3), en ajoutant le Haut Représentant pour l'Union européenne, et bien sûr l'Ukraine. L'Inde pourrait être la voix du «Sud global» dans ces discussions : la création d'un concert mondial, réunissant les 7 principales puissances économiques et militaires du monde, toutes membres du G20, pourrait s'avérer utile dans une perspective beaucoup plus large. En tout état de cause, l'ouverture de discussions sur l'Ukraine ne marquerait pas l'abandon d'une partie de bras de fer qui est engagée depuis longtemps et qui n'est pas terminée.
Maxime Lefebvre (Figaro Vox, 3 septembre 2024)