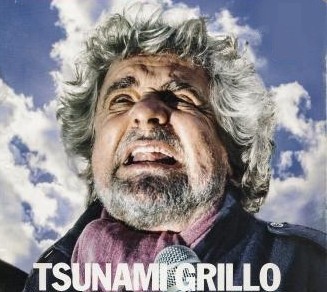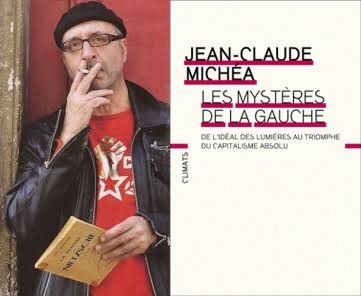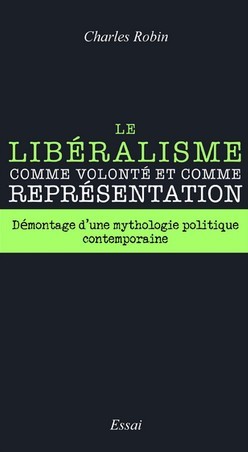Jean-Claude Michéa : « Pourquoi j'ai rompu avec la gauche»
Marianne : Vous estimez urgent d'abandonner le nom de «gauche», de changer de signifiant pour désigner les forces politiques qui prendraient à nouveau en compte les intérêts de la classe ouvrière... Un nom ne peut-il pourtant ressusciter par-delà ses blessures historiques, ses échecs, ses encombrements passés ? Le problème est d'ailleurs exactement le même pour le mot «socialisme», qui après avoir qualifié l'entraide ouvrière chez un Pierre Leroux s'est mis, tout à fait a contrario, à désigner dans les années 80 les turlupinades d'un Jack Lang. Ne pourrait-on voir dans ce désir d'abolir un nom de l'histoire comme un écho déplaisant de cet esprit de la table rase que vous dénoncez sans relâche par ailleurs ?
Jean-Claude Michéa : Si j'en suis venu - à la suite, entre autres, de Cornelius Castoriadis et de Christopher Lasch - à remettre en question le fonctionnement, devenu aujourd'hui mystificateur, du vieux clivage gauche-droite, c'est simplement dans la mesure où le compromis historique forgé, au lendemain de l'affaire Dreyfus, entre le mouvement ouvrier socialiste et la gauche libérale et républicaine (ce «parti du mouvement» dont le parti radical et la franc-maçonnerie voltairienne constituaient, à l'époque, l'aile marchante) me semble désormais avoir épuisé toutes ses vertus positives. A l'origine, en effet, il s'agissait seulement de nouer une alliance défensive contre cet ennemi commun qu'incarnait alors la toute-puissante «réaction». Autrement dit, un ensemble hétéroclite de forces essentiellement précapitalistes qui espéraient encore pouvoir restaurer tout ou partie de l'Ancien Régime et, notamment, la domination sans partage de l'Eglise catholique sur les institutions et les âmes. Or cette droite réactionnaire, cléricale et monarchiste a été définitivement balayée en 1945 et ses derniers vestiges en Mai 68 (ce qu'on appelle de nos jours la «droite» ne désigne généralement plus, en effet, que les partisans du libéralisme économique de Friedrich Hayek et de Milton Friedman). Privé de son ennemi constitutif et des cibles précises qu'il incarnait (comme, la famille patriarcale ou l'«alliance du trône et de l'autel») le «parti du mouvement» se trouvait dès lors condamné, s'il voulait conserver son identité initiale, à prolonger indéfiniment son travail de «modernisation» intégrale du monde d'avant (ce qui explique que, de nos jours, «être de gauche» ne signifie plus que la seule aptitude à devancer fièrement tous les mouvements qui travaillent la société capitaliste moderne, qu'ils soient ou non conformes à l'intérêt du peuple, ou même au simple bon sens). Or, si les premiers socialistes partageaient bien avec cette gauche libérale et républicaine le refus de toutes les institutions oppressives et inégalitaires de l'Ancien Régime, ils n'entendaient nullement abolir l'ensemble des solidarités populaires traditionnelles ni donc s'attaquer aux fondements mêmes du «lien social» (car c'est bien ce qui doit inéluctablement arriver lorsqu'on prétend fonder une «société» moderne - dans l'ignorance de toutes les données de l'anthropologie et de la psychologie - sur la seule base de l'accord privé entre des individus supposés «indépendants par nature»). La critique socialiste des effets atomisants et humainement destructeurs de la croyance libérale selon laquelle le marché et le droit ab-strait pourraient constituer, selon les mots de Jean-Baptiste Say, un «ciment social» suffisant (Engels écrivait, dès 1843, que la conséquence ultime de cette logique serait, un jour, de «dissoudre la famille») devenait dès lors clairement incompatible avec ce culte du «mouvement» comme fin en soi, dont Eduard Bernstein avait formulé le principe dès la fin du XIXe siècle en proclamant que «le but final n'est rien» et que «le mouvement est tout». Pour liquider cette alliance désormais privée d'objet avec les partisans du socialisme et récupérer ainsi son indépendance originelle, il ne manquait donc plus à la «nouvelle» gauche que d'imposer médiatiquement l'idée que toute critique de l'économie de marché ou de l'idéologie des droits de l'homme (ce «pompeux catalogue des droits de l'homme» que Marx opposait, dans le Capital, à l'idée d'une modeste «Magna Carta» susceptible de protéger réellement les seules libertés individuelles et collectives fondamentales) devait nécessairement conduire au «goulag» et au «totalitarisme». Mission accomplie dès la fin des années 70 par cette «nouvelle philosophie» devenue, à présent, la théologie officielle de la société du spectacle. Dans ces conditions, je persiste à penser qu'il est devenu aujourd'hui politiquement inefficace, voire dangereux, de continuer à placer un programme de sortie progressive du capitalisme sous le signe exclusif d'un mouvement idéologique dont la mission émancipatrice a pris fin, pour l'essentiel, le jour où la droite réactionnaire, monarchiste et cléricale a définitivement disparu du paysage politique. Le socialisme est, par définition, incompatible avec l'exploitation capitaliste. La gauche, hélas, non. Et si tant de travailleurs - indépendants ou salariés - votent désormais à droite, ou surtout ne votent plus, c'est bien souvent parce qu'ils ont perçu intuitivement cette triste vérité.
Vous rappelez très bien dans les Mystères de la gauche les nombreux crimes commis par la gauche libérale contre le peuple, et notamment le fait que les deux répressions ouvrières les plus sanglantes du XIXe siècle sont à mettre à son compte. Mais aujourd'hui, tout de même, depuis que l'inventaire critique de la gauche culturelle mitterrandienne s'est banalisé, ne peut-on admettre que les socialistes ont changé ? Un certain nombre de prises de conscience importantes ont eu lieu. Celle, par exemple, du long abandon de la classe ouvrière est récente, mais elle est réelle. Sur les questions de sécurité également, on ne peut pas davantage dire qu'un Manuel Valls incarne une gauche permissive et angéliste. Or on a parfois l'impression à vous lire que la gauche, par principe, ne pourra jamais se réformer... Est-ce votre sentiment définitif ?
J.-C.M. : Ce qui me frappe plutôt, c'est que les choses se passent exactement comme je l'avais prévu. Dès lors, en effet, que la gauche et la droite s'accordent pour considérer l'économie capitaliste comme l'horizon indépassable de notre temps (ce n'est pas un hasard si Christine Lagarde a été nommée à la tête du FMI pour y poursuivre la même politique que DSK), il était inévitable que la gauche - une fois revenue au pouvoir dans le cadre soigneusement verrouillé de l'«alternative unique» - cherche à masquer électoralement cette complicité idéologique sous le rideau fumigène des seules questions «sociétales». De là le désolant spectacle actuel. Alors que le système capitaliste mondial se dirige tranquillement vers l'iceberg, nous assistons à une foire d'empoigne surréaliste entre ceux qui ont pour unique mission de défendre toutes les implications anthropologiques et culturelles de ce système et ceux qui doivent faire semblant de s'y opposer (le postulat philosophique commun à tous ces libéraux étant, bien entendu, le droit absolu pour chacun de faire ce qu'il veut de son corps et de son argent). Mais je n'ai là aucun mérite. C'est Guy Debord qui annonçait, il y a vingt ans déjà, que les développements à venir du capitalisme moderne trouveraient nécessairement leur alibi idéologique majeur dans la lutte contre «le racisme, l'antimodernisme et l'homophobie» (d'où, ajoutait-il, ce «néomoralisme indigné que simulent les actuels moutons de l'intelligentsia»). Quant aux postures martiales d'un Manuel Valls, elles ne constituent qu'un effet de communication. La véritable position de gauche sur ces questions reste bien évidemment celle de cette ancienne groupie de Bernard Tapie et d'Edouard Balladur qu'est Christiane Taubira.
Contrairement à d'autres, ce qui vous tient aujourd'hui encore éloigné de la «gauche de la gauche», des altermondialistes et autres mouvements d'indignés, ce n'est pas l'invocation d'un passé totalitaire dont ces lointains petits cousins des communistes seraient encore comptables... C'est au contraire le fond libéral de ces mouvements : l'individu isolé manifestant pour le droit à rester un individu isolé, c'est ainsi que vous les décrivez. N'y a-t-il cependant aucune de ces luttes, aucun de ces mouvements avec lequel vous vous soyez senti en affinité ces dernières années ?
J.-C.M. : Si l'on admet que le capitalisme est devenu un fait social total - inséparable, à ce titre, d'une culture et d'un mode de vie spécifiques -, il est clair que les critiques les plus lucides et les plus radicales de cette nouvelle civilisation sont à chercher du côté des partisans de la «décroissance». En entendant par là, naturellement, non pas une «croissance négative» ou une austérité généralisée (comme voudraient le faire croire, par exemple, Laurence Parisot ou Najat Vallaud-Belkacem), mais la nécessaire remise en question d'un mode de vie quotidien aliénant, fondé - disait Marx - sur l'unique nécessité de «produire pour produire et d'accumuler pour accumuler». Mode de vie forcément privé de tout sens humain réel, inégalitaire (puisque la logique de l'accumulation du capital conduit inévitablement à concentrer la richesse à un pôle de la société mondiale et l'austérité, voire la misère, à l'autre pôle) et, de toute façon, impossible à universaliser sans contradiction dans un monde dont les ressources naturelles sont, par définition, limitées (on sait, en effet, qu'il faudrait déjà plusieurs planètes pour étendre à l'humanité tout entière le niveau de vie actuel de l'Américain moyen). J'observe avec intérêt que ces idées de bon sens - bien que toujours présentées de façon mensongère et caricaturale par la propagande médiatique et ses économistes à gages - commencent à être comprises par un public toujours plus large. Souhaitons seulement qu'il ne soit pas déjà trop tard. Rien ne garantit, en effet, que l'effondrement, à terme inéluctable, du nouvel Empire romain mondialisé donnera naissance à une société décente plutôt qu'à un monde barbare, policier et mafieux.
Vous réaffirmez dans ce livre votre foi en l'idée que le peuple serait dépositaire d'une common decency [«décence ordinaire», l'expression est de George Orwell] avec lesquelles les «élites» libérales auraient toujours davantage rompu. Mais croyez-vous sincèrement que ce soit aujourd'hui l'attachement aux valeurs morales qui définisse «le petit peuple de droite», ainsi que vous l'écrivez ici ? Le désossage des structures sociales traditionnelles, ajouté à la déchristianisation et à l'impact des flux médiatiques dont vous décrivez ici les effets culturellement catastrophiques, a également touché de plein fouet ces classes-là. N'y a-t-il donc pas là quelque illusion - tout à fait noble, mais bel et bien inopérante - à les envisager ainsi comme le seul vivier possible d'un réarmement moral et politique ?
J.-C.M. : S'il n'y avait pas, parmi les classes populaires qui votent pour les partis de droite, un attachement encore massif à l'idée orwellienne qu'il y a «des choses qui ne se font pas», on ne comprendrait pas pourquoi les dirigeants de ces partis sont en permanence contraints de simuler, voire de surjouer de façon grotesque, leur propre adhésion sans faille aux valeurs de la décence ordinaire. Alors même qu'ils sont intimement convaincus, pour reprendre les propos récents de l'idéologue libéral Philippe Manière, que seul l'«appât du gain» peut soutenir «moralement» la dynamique du capital (sous ce rapport, il est certainement plus dur d'être un politicien de droite qu'un politicien de gauche). C'est d'ailleurs ce qui explique que le petit peuple de droite soit structurellement condamné au désespoir politique (d'où son penchant logique, à partir d'un certain seuil de désillusion, pour le vote d'«extrême droite»). Comme l'écrivait le critique radical américain Thomas Franck, ce petit peuple vote pour le candidat de droite en croyant que lui seul pourra remettre un peu d'ordre et de décence dans cette société sans âme et, au final, il se retrouve toujours avec la seule privatisation de l'électricité ! Cela dit, vous avez raison. La logique de l'individualisme libéral, en sapant continuellement toutes les formes de solidarité populaire encore existantes, détruit forcément du même coup l'ensemble des conditions morales qui rendent possible la révolte anticapitaliste. C'est ce qui explique que le temps joue de plus en plus, à présent, contre la liberté et le bonheur réels des individus et des peuples. Le contraire exact, en somme, de la thèse défendue par les fanatiques de la religion du progrès.
Jean-Claude Michéa, propos recueillis par Aude Ancelin (Marianne, 12 mars 2013)