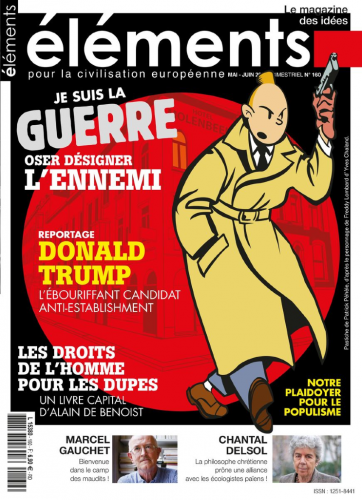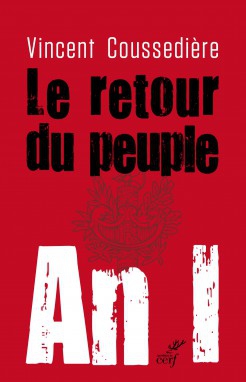Nous reproduisons ci-dessous une analyse impeccable de Michel Geoffroy, cueillie sur Polémia et consacrée à la nécessité pour le populisme, s'il veut triompher, d'articuler la question identitaire à la question sociale...
Le populisme à la croisée des chemins
Pour l’emporter, le populisme doit être social et non pas libéral. Une proposition qui ne plairait pas à tout le monde …
Le moteur du populisme en Europe – et en France du Front national – provient historiquement du refus de l’immigration de peuplement. Ce refus se justifie aujourd’hui plus que jamais alors que le Grand Remplacement et l’Islamisation de l’Europe progressent si rapidement qu’il faut désormais être aveugle ou complice pour ne pas le constater.
L’erreur des mouvements et partis populistes serait évidemment d’abandonner cette ligne identitaire au moment même où une part croissante de nos concitoyens comprend que l’avenir de notre civilisation est en jeu.
Mais une erreur symétrique consisterait aussi à n’en rester qu’à ce niveau, en oubliant l’autre versant de la dissidence identitaire : la société et le social, justement.
Un refus fondateur
Le populisme en Europe est la forme politique prise par le refus de la disparition de leur civilisation et de leur identité par les Européens qui se sentent abandonnés par les pouvoirs publics et trahis par les oligarchies remplacistes (1).
Il s’agit d’un refus politiquement fondateur, comme toutes les grandes alternances politiques et intellectuelles se sont fondées de la sorte : qu’il s’agisse du refus d’une religion, du refus d’un régime, du refus d’une défaite, du refus d’une oppression ou du refus d’une injustice.
Cependant il ne suffit pas de dénoncer le Grand Remplacement : pour le combattre efficacement il faut aussi s’interroger sur ses causes profondes, ce qui ouvre nécessairement d’autres perspectives.
Le moteur du Grand Remplacement est d’abord idéologique
Le Grand Remplacement n’est pas tombé du ciel en effet.
Car il correspond au projet de l’oligarchie occidentale (2) qui a pris le pouvoir à la fin du XXe siècle en Occident et qui a mis en application son idéologie libérale/libertaire et cosmopolite. Même si ce projet a fini par lui échapper en partie sous la forme du djihadisme, l’oligarchie l’a initié, l’a encouragé et l’a entretenu.
Le moteur du Grand Remplacement est donc d’abord idéologique, avant d’être civilisationnel, africain, musulman ou climatique.
C’est au nom de l’idéologie libérale/libertaire que l’Occident croit que les hommes doivent circuler et s’installer librement partout, comme s’il s’agissait de marchandises. C’est pourquoi les oligarques ont détruit les frontières et les douanes qui permettaient de réguler la concurrence, ainsi que les mouvements de populations et de marchandises. Et ils ont fait cela pour le plus grand profit des entreprises mondiales. Car l’immigration permet de faire baisser les salaires et de réduire au silence les salariés autochtones.
Au nom de cette même idéologie, tous les hommes sont désormais réputés avoir les mêmes « droits » politiques et sociaux, qu’ils soient étrangers ou citoyens d’un Etat : ce qui a permis de déconstruire la souveraineté et la démocratie en Europe occidentale et de faire exploser les régimes de protection sociale.
Le Grand Remplacement, une dérégulation civilisationnelle
Le Grand Remplacement n’est que l’effet le plus visible de la catastrophe culturelle, sociale et humaine provoquée partout par les oligarques occidentaux, qui depuis 30 ans exercent un pouvoir sans partage, notamment en Europe. Car le Grand Remplacement est une dérégulation civilisationnelle au même titre que la dérégulation financière, économique et sociale.
La mondialisation n’est heureuse (3) que pour les oligarques, les bobos, les banquiers, les histrions médiatiques et les dirigeants des entreprises transnationales. Pour les autres, c’est-à-dire la majorité de la population, elle signifie désindustrialisation, chômage, précarité du travail, fin de l’ascenseur social, diminution des droits et des protections sociales, réduction des services publics, augmentation des impôts, des charges et des taxes, déflation, dépossession de son identité, inquiétude devant l’avenir.
Car l’oligarchie n’a pas hésité à sacrifier la classe moyenne européenne sur l’autel du mondialisme, annulant en quelques années l’effet des Trente Glorieuses et un siècle de luttes sociales. Dans le même temps elle a cyniquement promu l’immigré/migrant au rang de prolétariat compassionnel de rechange : Big Other permettant de masquer l’étendue de la régression provoquée partout par les oligarques et pas seulement en Europe.
On ne saurait oublier que le développement du mondialisme économique et financier se paye ailleurs aussi de drames sociaux et environnementaux : exode rural massif entraînant la perte de l’autonomie alimentaire, mouvements de populations dans des centres urbains surpeuplés et pollués, exploitation brutale des salariés dans les usines travaillant pour les grandes firmes mondialisées, saccage de l’environnement, etc.
Les tenants du national-libéralisme se trompent
Cela signifie qu’on ne peut pas inverser le processus remplaciste en cours en Europe si on ne remet pas en cause l’idéologie libérale/libertaire qui le sous-tend.
Un populisme conséquent ne peut faire l’impasse sur cette question. Car la question sociale prolonge la question identitaire : l’identité c’est la nation et la nation c’est le peuple. Et à l’âge du mondialisme seuls les peuples souffrent.
C’est pourquoi les tenants d’une nouvelle gauche (4) qui ne se soucierait pas de la question identitaire n’ont aucun avenir.
C’est pourquoi aussi ceux qui, au sein de la droite populiste, préconisent l’adoption d’une ligne libérale et nationale se trompent d’époque.
Le cocktail libéral/national est en effet un oxymore ou, au mieux, un malentendu politique.
Le libéralisme conséquent, comme agent du capitalisme, tend en effet à détruire la nation, en déconstruisant tout ce qui fait obstacle à la liberté du marché. Il ne faut donc pas confondre la liberté économique qui peut effectivement s’appliquer dans l’espace national sous certaines conditions (5) avec le libéralisme, qui est une idéologie de combat contre les identités et les nations.
Le populisme s’affirme sur le registre de la souveraineté politique des nations, toutes choses que les libéraux ont toujours exécrées. Les libéraux ne croient qu’en l’individu et en la providence des marchés. Pour eux, comme le disait Mme Thatcher, « la société n’existe pas ». Alors pourquoi voudraient-ils la sauver ?
On ne peut donc pas être sincèrement populiste et libéral en même temps.
Les ravages du néo-libéralisme : un remake du XIXe siècle
Elargissons la perspective.
La mise en œuvre des préconisations libérales/libertaires a provoqué le chaos partout au XXIe siècle, dont ne profite qu’une infime minorité de la population occidentale. Cette situation n’est pas sans rappeler les ravages sociaux advenus au XIXe siècle lors de la mise en place de l’industrialisation capitaliste en Europe.
Ces ravages ont provoqué par réaction l’apparition du socialisme, puis au XXe siècle, du communisme en Europe. C’est pourquoi on a pu écrire que le socialisme avait été le « cri de douleur » du prolétariat (6).
Que le socialisme et le communisme n’aient pas réussi à abolir « l’exploitation de l’homme par l’homme » ou que le communisme ait été une utopie sanglante ne doit pas faire oublier que ces mouvements ont quand même réussi à forcer le capitalisme à se montrer plus social et à corriger ses excès en Occident (7).
Mais de nos jours le communisme est mort, les syndicats sont marginalisés et la gauche a abandonné l’héritage du socialisme pour devenir l’idiot utile du néo-capitalisme mondialisé. Cela signifie que plus personne n’est en mesure d’obliger les oligarques mondialistes à faire preuve de retenue dans leur course au profit.
On en voit le résultat : le chaos partout.
Le populisme, un socialisme pour notre temps ?
Si le populisme veut s’affirmer comme une véritable réponse aux interrogations de notre temps, il ne peut donc pas faire l’impasse sur la nouvelle question sociale.
Pour le dire autrement, le populisme doit jouer, au plan métapolitique, vis-à-vis du néo-capitalisme mondialisé, le rôle dévolu hier au socialisme vis-à-vis du capitalisme national.
Il doit à son tour devenir le « cri de douleur » des peuples européens et se présenter comme une force alternative aux ravages de la dérégulation néo-libérale, en Europe d’abord, au plan international ensuite.
Le populisme doit pour ce faire promouvoir une nouvelle éthique du Bien Commun et de l’Etat, en réponse à la marchandisation du monde incarnée par les oligarques mondialistes ; en réponse aussi à l’idéologie de l’individualisme absolu, destructeur de tout lien social. Le populisme doit aussi porter le retour des vertus civiques et des bonnes mœurs, conformément aux traditions européennes, contre le laxisme et le cynisme qui sont une arme aux mains de l’oligarchie.
Le populisme : passer du refus à la révolution
Cela implique d’annoncer et d’entreprendre une révolution culturelle et morale qui ébranle les dogmes et les oligarques dominants. Cela implique qu’une nouvelle élite politique, économique et sociale, s’avance. Cette élite existe mais elle est réduite au silence par les oligarques : il faut seulement qu’elle sorte de sa réserve.
La menace de la révolution socialiste a imposé au capitalisme européen la conscience sociale qui lui manquait.
La perspective d’une révolution populiste doit produire le même effet vis-à-vis du néo-capitalisme mondialisé.
C’est à cette condition que le populisme deviendra vraiment populaire. C’est à cette condition qu’il deviendra majoritaire.
Michel Geoffroy (Polémia, 10 mai 2016)
Notes :
1/ Selon l’expression de l’écrivain Renaud Camus.
2/ Voir le livre de Jean-Yves Le Gallou : Immigration : la catastrophe/ Que faire ? Via Romana, 2016.
3/ Selon l’expression de Dominique Strauss-Kahn.
4/ Genre Mélenchon.
5/ Comme cela a été le cas dans le passé européen.
6/ Jaurès, Histoire socialiste.
7/ Ce qui d’ailleurs explique l’envolée occidentale après la seconde guerre mondiale : la loi du profit étant associée à une politique sociale dynamique (social-démocratie ou sécurité sociale) ou par des salaires élevés (fordisme).