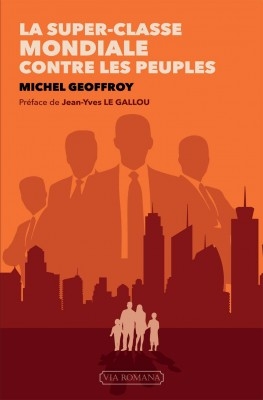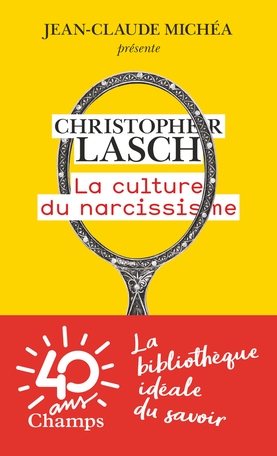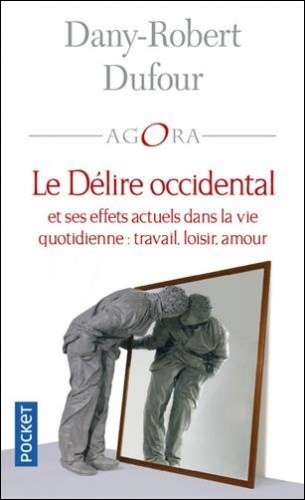Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Richard Dessens, cueilli sur Eurolibertés et consacré à la nouvelle victoire de Vladimir Poutine aux élections présidentielles en Russie et aux réactions qu'elle a suscitées en Occident.

Sus à la Russie !
Le 18 mars, la Russie a réélu Vladimir Poutine pour la quatrième fois, non consécutive, à la Présidence de la Fédération de Russie. Avec plus de 75 % des voix et une participation de près de 70 %.
Si son élection était prévisible, un faible taux de participation était attendu comme le symbole espéré d’un désaveu. Les commentateurs ont été encore déçus.
Vladimir Poutine s’adresse à ses partisans à l’extérieur du Kremlin.
D’ailleurs que n’a-t-on pas entendu de la part de l’ensemble de ces commentateurs français unanimes : candidats « fantoches » d’après le Huffington Post, élections truquées, méthodes « à la soviétique », dictature grossièrement camouflée, tous nos intellectuels, officines de politologues, professeurs à Sciences Po, chercheurs au CNRS, autant d’opinions objectives comme chacun sait, se sont déchaînés sur toutes les ondes radios et les chaînes d’information, BFM en tête. Aucune analyse même un peu différente n’a été exprimée. Liberté d’expression donc.
D’autant que cette élection s’est déroulée sur le fond de l’affaire de l’empoisonnement au Novitchok, substance mystérieuse, de l’ancien agent russe Serguei Skripal à Londres. Et de nous rappeler qu’il est le quatorzième en dix ans éliminé de manière suspecte à Londres, après entre autres Alexander Litvinenko, un autre transfuge du KGB, empoisonné, lui, au polonium.
Cette affaire opportune a permis de relancer une nouvelle campagne anti-Poutine. Cet environnement de retour à une guerre froide larvée n’a certainement pas été étranger à la mobilisation des électeurs pro-Poutine, exaspérés par les attaques incessantes de l’Occident contre la Russie. Réflexe national et identitaire somme toute bien compréhensible. Notons que le vote des Russes à l’étranger, et notamment en France, a été encore plus massivement favorable à Poutine. De quoi inquiéter les esprits chagrins !
Après la Géorgie, la Tchétchénie, la lutte des russophones d’Ukraine, la réintégration de la Crimée dans le giron russe – dont c’était d’ailleurs l’anniversaire le 18 mars – le soutien à la Syrie, la Russie est mise au ban de la bonne conscience démocratique occidentale.
La Russie lutte contre l’islamisme, tente de retrouver son rôle de nation majeure dans le monde en rééquilibrant les rapports de force jusqu’alors au bénéfice exclusif de l’Occident, autant de positions inadmissibles pour les bonnes consciences. Les mêmes bonnes consciences qui ont mis à feu et à sang l’Irak, la Libye, la Tunisie, fait ou laissé assassiner leurs chefs d’État, relancer la poudrière israélo-palestinienne, pour des raisons bien peu glorieuses et bien peu… démocratiques. Mais, là, en toute impunité. Finalement l’Occident n’a rien à envier à la Russie…
Quant au mépris du score de Poutine, de « république bananière » a-t-on pu entendre de la part de nos grands intellectuels, Macron a bien été élu avec 66 % des voix face aussi à des candidats « fantoches » ! Quant à la dénonciation des médias russes totalement inféodés à Poutine, non crédibles et diffuseurs de fake news permanentes, on pourrait sourire de parallèles avec la France par exemple et ses médias dont le pluralisme des opinions saute aux yeux et la « compréhension » pour Macron est la ligne de conduite.
Il n’y a qu’à voir ou écouter l’unanimisme des commentaires sur tous les sujets. Mais rien à voir avec la Russie bien sûr. Chez nous tout est plus « nuancé » dans la forme. Démocratique quoi…
Alors on évoque les vieux démons de l’URSS, du parapluie bulgare aux empoisonnements d’agents qui ont trahi leur pays. On imagine que les « services » de l’Occident, CIA en tête, n’ont jamais procédé à des éliminations physiques de traîtres, d’opposants ou de transfuges. C’est évidemment impensable dans nos démocraties.
Tout cela est d’une hypocrisie sans limite mais à la finalité politique et surtout géopolitique bien claire. Alors l’Occident sanctionne avec des accents de moralité indignée.
Emmanuel Macron a boudé jeudi 15 le pavillon officiel de la Russie, pays invité d’honneur du Salon du livre à Paris. Sanction symbolique infantile. De minimis non curat praetor semble sourire Poutine.
Les États-Unis ont annoncé ce même jeudi 15 mars une série de sanctions contre la Russie mais en réponse à l’ingérence de Moscou dans l’élection présidentielle américaine de 2016 et plusieurs cyberattaques. Comme par hasard. On évoque d’autres sanctions financières. Mais dimanche 18, Trump et Poutine échangent par téléphone pendant 45 minutes. Pour dire quoi ? Va-t-on vers un nouvel équilibre mondial, une redistribution du jeu international, avec une Chine de plus en plus conquérante, exigeante et inquiétante ?
Le Kremlin annonce préparer « des mesures de représailles » proportionnelles. Quoi de plus normal dans un contexte d’agressions permanentes contre sa politique qui décidément dérange le monopole européo-américain. Mais Trump, entre rodomontades anti-Poutine et discussions discrètes parallèles, a-t-il autre chose en tête ?… À suivre.
Et dans cela, quid de notre « Union » européenne ? Une sorte de silence attentiste et relativement prudent finalement de la part des États qui tranche avec les cocoricos de l’UE et les déchaînements agités de Theresa May. Les relations Russie (ou Union soviétique) Grande Bretagne ont toujours été sulfureuses et Londres le champ des règlements de compte entre agents secrets et de toutes les trahisons dans les deux sens (souvenons-nous des affaires Burgess, Mac Lean, Philby, Fuchs aux USA et combien d’autres moins connues…). Rappelons enfin plus récemment l’affaire Snowden, réfugié à Moscou et dans la ligne de mire de la CIA. Mais là, c’est normal. C’est démocratique…
Richard Dessens (Eurolibertés, 26 mars 2018)