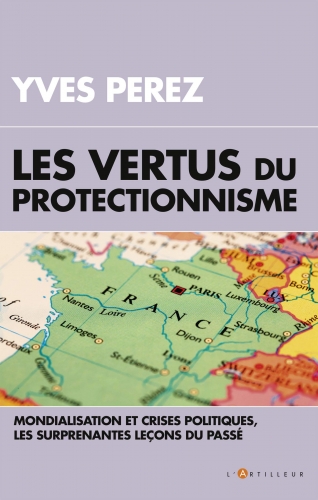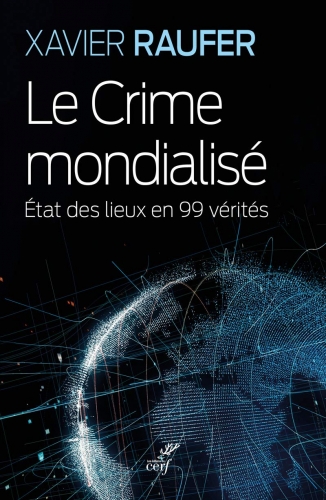Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Lionel Rondouin à l'Institut Iliade et consacré à la fragilité de l'économie mondialisée face aux aléas, notamment sanitaires. Normalien, enseignant en classe préparatoire, Lionel Rondouin est spécialiste des questions de sécurité économique et a travaillé dans l'industrie.

Le coronavirus, révélateur de la faillite à venir du mondialisme ?
Institut Iliade : Tout d’abord, et avant de parler de l’actualité, essayons de comprendre votre démarche. Comment et pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette question du SRAS et aux perturbations que des catastrophes naturelles ou sanitaires peuvent causer à l’économie du monde ?
Lionel Rondouin : En réalité, je ne me suis pas intéressé au SRAS en 2003, c’est le SRAS qui est venu à moi…
J’ai séjourné plus d’un mois en déplacement professionnel à Toronto puis à New-York pendant l’épidémie. Il y avait des malades au Canada et sur la côte Ouest des Etats-Unis, au sein des communautés chinoises.
Le SRAS était en définitive moins grave que le coronavirus. Il était moins contagieux et — je vous le dis sans aucun cynisme, croyez-le bien — il était moins contagieux parce qu’il tuait plus vite. Mais ça, bien sûr, on ne peut le dire qu’avec le recul du temps.
Toujours est-il que tout le monde paniquait parce qu’il y avait des morts sur le sol nord-américain.
Et, surtout, j’ai constaté en lisant la presse quotidienne et en suivant les chaînes de télévision locales qu’une question revenait en boucle, l’approvisionnement en biens de consommation. En Amérique, on n’a plus d’industrie de jeans, de tee-shirts, de chemises, de baskets, on va se retrouver nus et pieds nus. Les grands centres de consommation populaires, les chaînes d’articles de décoration et d’équipement de la maison, vont se retrouver vides de marchandises,
Les porte-conteneurs chargés de marchandises restaient bloqués dans les ports de Chine. Les voyages professionnels étaient annulés entre les fournisseurs chinois et les donneurs d’ordre nord-américains. Cela a duré quelques semaines, puis on s’est rendu compte que le virus ne résistait pas à l’air libre plus de trois heures. On a fait partir les bateaux vers l’Amérique, en sachant que la marchandise n’était pas contagieuse arrivée à Vancouver ou Los Angeles. L’épidémie elle-même s’est éteinte en Chine et on est revenu à « business as usual ».
Et cela a suffi à attirer votre attention sur toute cette problématique…
Non. Il a fallu deux autres expériences professionnelles.
En 2011, je travaillais dans une société qui, entre autres, importait des marchandises du Japon. J’ai vécu à distance le tsunami et la catastrophe industrielle de Fukushima, et cela a retenti sur mes propres affaires en Europe. Au-delà des conséquences humaines, au-delà de l’anarchie totale et des conséquences sur l’économie locale, rupture des communications physiques et des télécommunications, mise à l’arrêt de toutes les centrales nucléaires, rupture de certains approvisionnements des clients étrangers, etc… je me suis interrogé sur la fragilité du système global de l’économie mondialisée.
Il faut bien voir que le Japon et le monde ont eu de la chance en 2011. Fukushima est située très au Nord de Tokyo. Les routes qui passent près de la centrale nucléaire desservent des régions qui n’ont pas d’importance stratégique pour l’industrie japonaise et ses clients. Si le tsunami s’était déclenché quelque part au Sud entre Tokyo et Osaka devant une autre centrale nucléaire de bord de mer, le Japon ne serait plus une grande puissance économique.
Et puis, autre expérience, j’ai travaillé dans l’industrie automobile chez un équipementier qui fournissait des pièces et des composants à tous les grands constructeurs de voitures et de camions, en Europe mais aussi au Japon. C’était dans les années 2000, l’époque de la grande délocalisation vers l’Europe de l’Est, la Turquie, l’Inde, la Chine. Et là, comme fournisseur, j’ai appris à connaître la logique contemporaine des achats industriels dans une économie globalisée, les circuits logistiques et leurs contraintes, leur efficacité et leur fragilité.
Nous avons tous en tête les images de l’épidémie de coronavirus, les millions de personnes confinées chez elles, les rues désertes, les usines fermées. Pensez-vous vraiment que le coronavirus va affecter durablement l’économie de la Chine et va-t-il y avoir des conséquences sur l’économie du monde ?
Oui, en 10, 20, 100 fois plus grand, en termes de retombées économiques locales et mondiales.
En 2003, la Chine ne représentait que de 5 à 6% du PIB mondial. Aujourd’hui, trois fois plus.
Et nous en sommes plus dépendants de la Chine qu’en 2003.
Quelle est la situation en Chine qui justifie votre pessimisme ?
Les ports de porte-conteneurs chinois sont à l’arrêt. Rien ne part de Shanghai, premier port du monde avec 120.000 équivalents/conteneurs de 20 pieds par jour en temps normal. Plus rien non plus de Shenzhen, troisième port du monde, avec 80.000 équivalents/conteneurs/jour.
Et, en amont des ports, les usines d’assemblage (automobile, électro-ménager, électronique et télécom, etc.) et de fabrication (textile-habillement, chaussures, etc…) sont fermées sur une très vaste zone qui comprend en particulier Wuhan et Shenzhen.
Les conséquences sur l’économie locale sont énormes. Si les usines de Ford, General Motors, Volkswagen, de tous les constructeurs étrangers et chinois, sont fermées, cela veut dire aussi que celles de leur sous-traitants et fournisseurs sont à l’arrêt.
Le problème va être pire pour l’électronique et les matériels de téléphonie et d’informatique.. Apple a fermé ses sites de production en Chine.
En amont et en aval des usines, l’industrie du transport, routier, ferroviaire, fluvial, maritime est dans le coma.
Pas de production, mais pas de commercialisation non plus. Qui va acheter aujourd’hui une voiture en prenant le risque d’attraper la maladie dans une concession automobile ? Une robe dans un magasin ? On ne sort de chez soi que tous les deux jours, pour acheter de la nourriture et de l’eau en bouteilles à la supérette du coin.
Oubliez les achats sur Internet, Ali Baba ne livre plus…
Pour en venir aux conséquences sur nos économies occidentales, cela va donc affecter la rentabilité des filiales chinoises des groupes étrangers. Apple, Volkswagen, PSA, mais aussi des groupes de distribution comme LVMH vont devoir consolider dans leurs comptes mondiaux les pertes subies en Chine.
Mais ce n’est que le commencement du problème…
En quoi le « commencement » ?
C’est là qu’on en arrive à la perturbation des chaînes logistiques internationales.
Déjà, certaines chaînes de fabrication sont arrêtées à l’étranger, par manque de pièces et de composants qui ne sortent plus de Chine : à ce jour, Hyundai en Corée, Fiat-Chrysler en Europe, Honda au Japon. Je vais être gentil et ne pas donner de noms mais, à mon avis, cela va affecter un constructeur français, très, très vite…
Cela paraît bête, mais il est difficile de commercialiser une voiture sans serrures de portières ou avec des serrures incomplètes s’il y manque une petite pièce métallique de trente grammes qu’on va chercher en Chine parce qu’elle coûte un centime de moins qu’en France ou en Roumanie.
Et, pas de chance, entre-temps, en Europe, les fournisseurs alternatifs possibles de la petite pièce en question ont peut-être tous fermé à force d’être étranglés par leurs clients.
Même s’il reste un fournisseur alternatif en Europe, si la pièce est une pièce de sécurité (soumise à des tests réglementaires ou contractuels), par exemple un cliquet de serrure ou un crochet de retenue de banquette arrière, il faut compter trois mois au moins entre la commande d’un prototype et l’homologation de sécurité de la pièce…
Et puis, s’il existe encore un fournisseur alternatif en Europe, vous pensez bien que tous les constructeurs et équipementiers font en ce moment la queue devant son usine pour se disputer les rares capacités de production qu’il lui reste…
Certaines sociétés sont moins suicidaires que les autres. Elles gèrent la sécurité de leurs approvisionnements. Pour la même pièce, elles ont deux fournisseurs, un extra-européen, un européen. Mais elles répartissent les quantités à produire entre les deux fournisseurs à raison de, par exemple, 70 % pour le non-européen, moins cher, et 30 % pour l’européen, qui est plus cher. La différence de prix de revient, c’est le prix de la sécurité. C’est bien vu en soi, mais le problème, c’est que si le Chinois ou l’Hindou ne livre plus, il n’est pas dit que l’européen ait la capacité de production, les machines et les hommes, pour faire la soudure. Donc il y aura quand même des problèmes.
On n’est toujours pas sorti de l’auberge.
Vous évoquez surtout l’industrie automobile. Avez-vous d’autres exemples ?
Bien sûr ! Regardons l’industrie pharmaceutique. En ce moment, avec le coronavirus, c’est important, l’industrie pharmaceutique, n’est-ce pas ?
Je n’ai pas trouvé les chiffres pour la France, mais, si on prend le cas des États-Unis, l’industrie pharmaceutique est dépendante des approvisionnements de la Chine à hauteur de 80 % en général, et cela monte à 97 % dans le domaine des antibiotiques.
Cela veut dire que les États-Unis importent 80 %, soit des médicaments, des gélules, des pilules, des ampoules injectables déjà fabriquées et conditionnées en Chine, soit des molécules actives et des excipients en vrac qui sont utilisés pour fabriquer localement aux Etats-Unis les médicaments. Et 97 % pour les antibiotiques.
Et, en ce moment-même, rien ne sort de Chine.
Mais les antibiotiques n’ont pas d’utilité contre les maladies virales comme la grippe ou le coronavirus. Donc, ce n’est peut-être pas si grave que ça dans l’immédiat.
Vous oubliez que le problème sanitaire majeur des États-Unis, c’est l’obésité et les maladies associées (maladies cardio-vasculaires, diabète, etc.), sans compter l’aspect sanitaire de ce que les Américains appellent « opiodemic », l’épidémie massive d’addiction aux drogues les plus variées, et qui supposent d’avoir des molécules de substitution. Et les États-Unis ne sont auto-suffisants qu’à hauteur de 20 % de leurs besoins dans ces domaines.
En plus, admettons qu’il y ait localement, dans le Missouri ou le Nevada, une épidémie d’une maladie non pas virale mais bactérienne, comme la méningite. Qu’est-ce qui se passe si les hôpitaux sont en rupture d’antibiotiques ?
Les gens vont mourir dans les hôpitaux.
Et, du point de vue purement économique, une société pharmaceutique comme Merck ne va pas facturer de produits à partir des usines de sa filiale en Chine puisque les usines et les transports sont bloqués et, ne va pas facturer à partir de ses usines aux États-Unis par manque de matières premières pour fabriquer localement.
C’est quand même ballot, dans les affaires, de ne pas pouvoir servir un marché affamé de produits…
Pourquoi les États-Unis, et peut-être l’Europe, dépendent-ils à ce point de la Chine ?
Parce que l’industrie pharmaceutique, dans sa phase finale, est une industrie très automatisée, mais les phases initiales sont consommatrices de main d’œuvre, donc très sensibles au coût horaire du travail. Pour ça, la Chine, c’est mieux.
Bienvenue dans le monde moderne…
Mais il y a des stocks, que ce soit dans l’industrie pharmaceutique comme dans l’industrie automobile.
Arrêtez d’écouter BFM-Business, c’est mauvais pour les neurones. Il n’y a pas de stocks, nous sommes dans un monde du « zéro stock » et du « juste à temps ».
Pourtant, on n’entend pas dire que les usines françaises soient perturbées ou que les magasins de vêtements ou de chaussures soient vides.
C’est vrai. En ce moment, on vit sur les stocks.
Mais vous venez de dire qu’il n’y a pas de stocks…
Il y a des stocks, mais il n’y en aura peut-être plus d’ici quelques jours dans l’industrie et d’ici quelques semaines dans la distribution. Je m’explique.
Une usine a toujours des stocks minimaux de pièces, de composants dans ses magasins. Selon les cas et le type de pièces, de deux jours à deux semaines. C’est là qu’on puise quotidiennement pour la fabrication.
Le reste, ce sont les « stocks en transit » ou « stocks à la mer », programmés pour arriver progressivement, par petites pulsations. Ce sont les pièces ou les produits qui ont été fabriqués en Chine ou ailleurs, et qui ont été chargés sur les bateaux. Les bateaux ont appareillé et sont quelque part entre le port de départ et Le Havre ou Marseille. Tous les jours, il arrive encore des porte-conteneurs en provenance de Chine. Ce sont ceux qui ont quitté les ports chinois avant la fermeture du trafic. Cette mécanique est parfaitement huilée.
En ajoutant les 18 jours – minimum – du trajet entre Shanghai et Le Havre, plus les 2 à 3 jours de dédouanement et de transport entre Le Havre et les entrepôts français, on a encore des pièces qui alimentent la production. Elles arrivent parce que ces bateaux ont quitté la Chine avant le blocage de Shanghai et de Shenzhen.
Et après, qu’est-ce qu’on fait ?
Et cela fait longtemps que les bateaux ne partent plus ?
Aujourd’hui 10 février, cela fait, en gros, 10 jours pour Shanghai et 5 jours pour Shenzhen… Le compte à rebours est lancé.
Mais l’épidémie de coronavirus finira bien par cesser. C’est le cas de toutes les épidémies, on le sait. Combien de temps faut-il pour revenir à la normale ?
Bien sûr, toutes les épidémies disparaissent d’elles-mêmes, Dieu merci !
Mais entre-temps, il y a des coûts, qui vont dépendre de la durée du phénomène en Chine. Or, nous n’avons pas encore d’estimation sur cette durée.
Admettons que, par miracle, le nombre de contaminations s’arrête de croître et que, d’ici 15 jours, on ne constate plus de nouveaux cas.
Mais on sait que certaines personnes apparemment « saines », asymptomatiques, peuvent être contagieuses.
On laisse donc passer 15 jours supplémentaires, par mesure de précaution, avant de reprendre une vie économique à peu près normale et de rouvrir les usines, les transports locaux, les ports, les aéroports.etc. C’est un strict minimum.
Donc, les usines rouvrent dans 15+15=30 jours.
Le temps de trier les retards et les urgences industrielles (« urgences », sans jeu de mot), il faut au moins 3 à 4 jours pour relancer la production et expédier les premières pièces, en petites quantités, aux clients en arrêt de chaîne.
Vu l’urgence, on décide de s’approvisionner par avion, en dépannage. Comptez 4 jours, d’usine chinoise à usine européenne, en transport local départ, transport avion (un jour), dédouanement et transport local à l’arrivée. On est à 30+4+4=38 jours d’arrêt.
Et cela au prix de surcoûts de transport par rapport au coût normal du transport maritime. Donc, les clients européens perdent en productivité.
Par transport maritime, en allant vite, on retrouve la situation normale à au moins 30+4+18 =52 jours plus les opérations d’embarquement, de dédouanement et de transport du Havre à l’usine. Disons 55 jours. Deux mois.
Admettons encore qu’une chaîne de fabrication de voitures s’arrête aujourd’hui en France, faute d’une pièce « critique ». Encore une fois, pièce « critique » ne veut pas dire la boîte de vitesse ou le train avant ; ce peut être une petite pièce de sécurité cachée dans une serrure.
Combien ça coûte au constructeur d’avoir une chaîne à l’arrêt ?
Excusez-moi, mais je n’en ai aucune idée…
Mes chiffres datent un peu, mais il faut compter 25.000 euros par heure. Cela a dû augmenter…
C’est fou !
Je ne vous le fait pas dire… Faites le calcul : 25.000 euros /heure x 2 x 8 = 400.000 euros/jour quand on travaille normalement en 2 x 8.
Et ça, ce n’est que pour une seule chaîne de production, à un seul endroit sur un seul modèle.
Imaginez le manque à gagner si cela touche 5 usines pendant 38 jours !
D’accord, pour l’industrie européenne, cela peut-être grave mais tout à l’heure vous mentionnez les biens de consommation courante, les vêtements, les chaussures, l’électro-ménager. Qu’en est-il ?
Honnêtement, je me soucie peu de l’avenir de Kiabi, de Darty et de la Halle aux Chaussures (pure méchanceté de ma part). Mais, si la crise sanitaire dure, le secteur de la distribution grand public risque être impacté lourdement par, tout simplement, manque de produits à la vente.
Dans la distribution comme dans l’industrie, il faut plusieurs mois et des surcoûts considérables pour réformer en profondeur une stratégie d’approvisionnement.
Les magasins se rattraperont plus tard, une fois réapprovisionnés.
C’est vrai pour les achats raisonnés : un lave-linge, une paire de bottes de jardin. C’est faux pour les achats d’impulsion. On n’achète pas une petite robe ou une paire de ballerines parce qu’on en a besoin, mais parce qu’on les voit en rayon. Ces ventes-là, ça ne se « rattrape » pas.
Donc les sociétés qui dépendent des approvisionnements chinois vont souffrir, d’accord. Mais ce sont les aléas des affaires et, d’après ce que vous nous dites, ce sera la conséquence de leurs décisions libres d’acteurs économiques. Si on n’a pas d’actions de ces sociétés en portefeuille, ça ne nous touche pas.
Oh si ! Si la crise se prolonge, il y aura chômage partiel, fermetures de magasins, licenciements, etc.… Donc, in fine, ça va coûter de l’argent à la collectivité : soutiens financiers directs ou prêts aux secteurs affectés (cela a déjà été le cas pour le secteur automobile en 2008/2009) ; reports d’échéances fiscales et sociales pour les entreprises en difficulté de trésorerie ; coûts sociaux dus à la compensation du chômage partiel ou coût d’indemnisation des personnes licenciées ; etc. La liste est longue.
Donc, c’est nous qui allons payer. Vous connaissez le dicton : privatisation des profits, socialisation des pertes.
Tout va dépendre du degré de dépendance de tel ou tel secteur et de telle ou telle entreprise en particulier. Et bien entendu, l’alea majeur, c’est la durée de l’épidémie en Chine. Je ne fais que vous exposer le risque dans son principe. Et puis, même si l’épidémie de coronavirus s’apaise, la prochaine sera peut-être pire… Le problème de fond demeurera.
Si ce risque se réalise, pensez-vous que cela amènera des changements de mentalité dans les entreprises ou des réflexions politiques sur cette dépendance ?
Théoriquement, oui. Pratiquement, j’en doute, dans les circonstances présentes.
Au niveau politique, quelques économistes et politiques vont bien poser publiquement le problème de notre dépendance stratégique au commerce international lointain. Mais, comme je l’évoquais au colloque, il faudrait accepter de remettre en cause la Bible : la théorie de Ricardo sur le caractère bienfaisant de la spécialisation croissante des économies nationales, et par voie de conséquence le libre-échangisme intégral des biens et des capitaux, la globalisation des échanges, le système financier.Cela supposerait aussi de rendre à l’État des prérogatives dans la définition de stratégies industrielles nationales, avec de vraies règles du jeu économique et surtout fiscal. Avec une vraie politique d’aménagement du territoire, avec des infrastructures et la ré-implantation d’industries sur l’ensemble du territoire, avec des PMI et ETI.
Mais, quand on voit l’idéologie mondialiste de nos gouvernants français et européens, quand on se rappelle le traitement par Emmanuel Macron des ouvriers de GM&S, c’est mal parti… Vous vous souvenez de GM&S, cette usine d’équipement automobile de la Souterraine dans la Creuse, qui étaient en grève parce que l’actionnaire voulait fermer l’usine pour délocaliser la production ? On a besoin de centaines de GM&S en France.
Macron a traité ces ouvriers de fainéants qui feraient mieux de chercher du boulot que d’ouvrir leur g…
En effet, vu de Bercy, de l’Élysée, du siège de la Commission de Bruxelles, un emploi, c’est un emploi. C’est quantitatif, c’est interchangeable. Travailler au profit d’une filière industrielle, avec un savoir-faire, dans la ville où on a une maison et sa famille, ou travailler dans des services en faisant 150 km par jour en voiture pour faire le ménage dans les bureaux de la Préfecture en touchant un salaire de misère, c’est toujours travailler.
Il n’y a aucune vision industrielle d’ensemble chez nos « élites » françaises. Ils ne savent pas ce qu’est l’industrie.
Donc, en l’état actuel des forces politiques, je ne suis pas optimiste.
Mais les entreprises n’ont pas forcément les mêmes « œillères » C’est peut-être d’elles que viendra une prise de conscience et une réaction.
Théoriquement, oui, là aussi, mais… Si on prend du recul, et à grands traits, le capitalisme naît avec les grandes sociétés de commerce puis se développe avec la révolution industrielle. Ce sont des principalement des aventures personnelles ou familiales. Elles s’inscrivent dans la durée. On profite de son aisance, mais on réinvestit en permanence dans ce qui devient un patrimoine qui se transmet et fructifie, si Dieu veut, de génération en génération.
Puis apparaît le modèle de la firme, industrielle ou commerciale. C’est encore souvent un modèle familial, mais ce peut être plus moderne sous la forme de sociétés par actions dont la souscription est publique. Mais la gestion de la firme reste encore régie par le long terme. C’est le modèle de Michelin ou du Bon Marché.
C’est à ce moment-là que la science économique pose un principe fondamental que l’économie contemporaine a oublié.
On dit souvent que le but ultime d’une entreprise et du capitalisme en général, c’est de faire du profit.
C’est faux !
La vocation d’une entreprise est de faire du profit, but intermédiaire, mais le but ultime, c’est de garantir la pérennité de l’entreprise. Le profit, c’est le moyen de garantir la pérennité.
Et c’est ce principe que le capitalisme financiarisé actuel, ou capitalisme de troisième type, a détruit. C’est pour cela que le taux d’investissement baisse, par exemple.
Selon vous, quel est le rapport avec notre problème de dépendance aux fournisseurs chinois et à la crise actuelle du coronavirus ?
Le rapport est évident. L’entreprise contemporaine est régie par le court-terme le plus immédiat. Les sociétés cotées doivent verser des dividendes aux actionnaires, une fois par an en Europe, quatre fois par an aux États-Unis.
Les dirigeants mercenaires sont donc tenus de dégager du cash, sans quoi ils sont révoqués par leurs actionnaires.
En plus, ces dirigeants sont intéressés au cours de Bourse, à travers les primes et les stock-options. Au lieu d’arbitrer la répartition « raisonnable » des profits entre ce qui doit revenir à l’actionnaire (dividendes) et ce qui doit revenir à l’entreprise pour garantir sa pérennité (investissements), les dirigeants sacrifient la pérennité de l’entreprise à l’intérêt immédiat de l’actionnaire. La gestion des entreprises cotées, c’est le match de football truqué entre Valenciennes et l’Olympique de Marseille. L’actionnaire a acheté l’arbitre avec des stock-options…
Non seulement on investit moins, mais il faut en permanence rogner sur les prix de revient des marchandises et des services, donc on délocalise à tout-va, quitte à prendre des risques stratégiques sur l’organisation des achats et donc des approvisionnements. D’où le recours à la Chine, même si on prend le risque de « planter » la boîte…
Ce n’est pas grave puisque, généralement, les dirigeants ne restent pas plus de cinq ans à la tête d’une entreprise.
D’où aussi la pression énorme de la hiérarchie sur la Direction des Achats. Faites baisser les coûts ! On se moque de a sécurité des approvisionnements (que pourtant on enseigne en Ecole de Commerce aux futurs acheteurs).
J’ai connu un acheteur industriel qui a pris des risques sur l’approvisionnement d’une pièce en quittant un fournisseur français très fiable pour un fournisseur d’Europe de l’Est, et ce pour gagner quatre centimes à la pièce, avec une quantité d’environ 400.000 pièces à l’année. Bénéfice théorique de l’opération : 0,04 x 400.000 = 16.000 euros par an. L’acheteur a eu une prime.
La deuxième année, il y a eu un petit problème. Les défauts de qualité ont occasionné une perte pour sa société de plus de 50.000 euros. Ce n’est pas grave, c’est la règle du jeu. L’acheteur n’a pas été sanctionné.
En réalité, à travers les aléas possibles d’une crise sanitaire, nous assistons à la manifestation d’une crise systémique du modèle économique mondial contemporain et de la gouvernance des entreprises.
Pour ce qui concerne la stratégie des approvisionnements, on n’a pas voulu tirer les leçons de la petite crise causée par le SRAS en 2003, ou de l’alerte du tsunami et de la catastrophe nucléaire de Fukushima.
De toute façon, ce qui caractérise le capitalisme financiarisé global, c’est son incapacité à apprendre. Il n’y a pas de courbe d’expérience. Dans le domaine financier et bancaire, on n’a tiré aucune conséquence pratique de la crise de 2008. Pourquoi voulez-vous qu’il en aille autrement dans l’industrie et le commerce ?
Au-delà de ce constat, quelle solution proposez vous pour l’Europe aujourd’hui ?
La révolution ! Révolution politique d’abord, avec un État-stratège.
Avec des règles draconiennes qui pénalisent les plus-values sur les stock-options. Par exemple, un impôt confiscatoire de 90 % sur les plus-values de stock options détenues depuis moins de cinq ans.
Avec des droits de douanes élevés, non remboursables en cas de réexportation des marchandises, intégrées ou non.
Avec des pénalités fiscales élevées sur les entreprises qui ne feraient pas évoluer en faveur des salariés la répartition de la valeur ajoutée. La part des salaires dans la VA diminue depuis trente ans. Ce qui fait la force d’une économie, c’est sa diversité, comme je l’avais mentionné au colloque. C’est aussi la, robustesse de son marché intérieur. Vous préférez le modèle allemand avec des millions de travailleurs pauvres ‑et de retraités pauvres – et un marché intérieur atone, parce que, ce qui compte, c’est l’excédent de la balance commerciale ?
Révolution aussi, dans la gouvernance des entreprises. C’est un problème politique, en réalité. Les entreprises, qu’elles soient industrielles ou commerciales, se permettent des prises de risque énormes parce qu’elles se disent qu’in fine, en cas de problème, il y aura un « bail out », un sauvetage par le contribuable. Non ! Si une société fait faillite parce qu’elle s’est mise sous la dépendance de fournisseurs étrangers lointains, sans gérer le risque, sans le répartir dans l’espace, elle doit assumer. Cela suppose un changement de paradigme politique. Les entreprises suivront.
Essayons cependant d’être optimiste… Si cette crise dure, ou si une autre crise plus grave se déclenche, est-ce que cela ne représente pas malgré tout des opportunités pour notre économie ?
Oui, à court terme et moyen terme pour les industries qui ont survécu malgré et contre leurs clients. À plus long terme, il y a des opportunité énormes dans la relocalisation industrielle.
Mais cela supposera des financements, et chacun sait que le système bancaire sait faire beaucoup de choses, à l’exception bien sûr de prêter aux entreprises. Il faudra un système nationalisé de financement des entreprises à naître ou existantes. C’est donc un problème politique.
Cela supposera aussi une politique d’aménagement du territoire autre que celle que nous connaissons, un changement de paradigme fiscal, etc.
Et puis, il faudrait qu’arrive au pouvoir une nouvelle classe politique et managériale qui connaisse la géographie. Les distances, c’est du temps de transport. Le temps et les distances, ce sont des coûts et des arbitrages entre rapidité (avion) et économie (bateau).
Quand vous avez une prétendue élite qui ignore que le trajet Le Havre-Vancouver, c’est 45 jours de bateau, vous ne pouvez pas gérer le commerce international.
Tout est donc affaire de culture générale, de compétences et de volonté politique. Au vu de nos dirigeants actuels, vous voyez bien que cela suppose une révolution.
Lionel Rondouin (Institut Iliade, 11 février 2020)