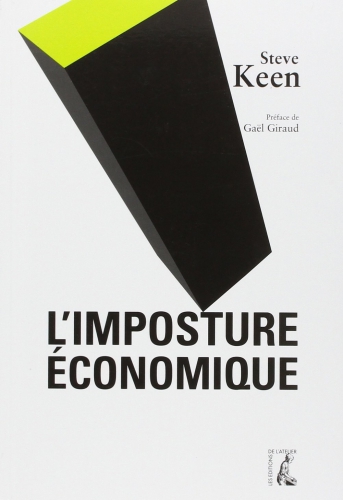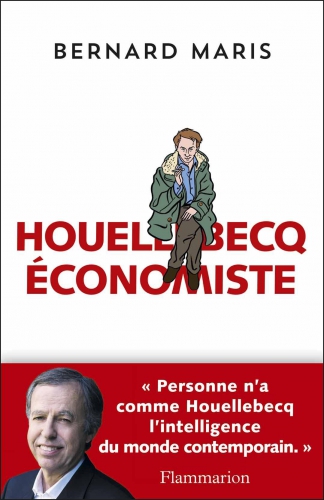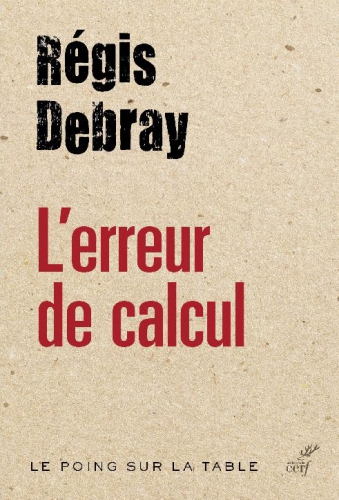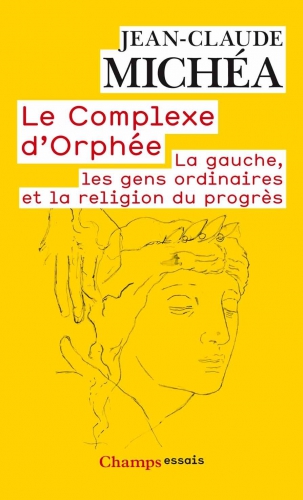Le coût du travail ? Oui, mais celui du capital ?
On parle toujours beaucoup du fameux pacte de responsabilité annoncé par François Hollande le 14 janvier dernier. Demander au grand patronat de se porter garant de la solidarité nationale, n’était-ce pas faire preuve d’une certaine naïveté ?
La France mène depuis plus de vingt ans une politique de baisse des charges sociales qui n’a jamais empêché le chômage de monter. Souvenez-vous des 22 milliards d’exonérations de cotisations employeurs, des 6 milliards du crédit impôt-recherche, des 6 milliards de baisse de la taxe professionnelle, des 20 milliards du crédit d’impôt compétitivité-emploi, etc. Le pacte de responsabilité est le dernier avatar en date de cette politique. Il consiste à offrir sans contrepartie 40 milliards d’euros de baisses de charges aux employeurs en espérant, en bonne logique libérale, voir se multiplier les créations d’emplois. Le patronat empoche, mais le chômage augmente toujours, tandis que la croissance est nulle, que la dette s’alourdit et que la déflation menace. Échanger des mesures concrètes contre des promesses vagues, cela s’appelle conclure un marché de dupes, doublé d’une mise en scène destinée à faire accepter la politique de l’offre adoptée par le gouvernement.
Le MEDEF, qui ne cache pas sa joie devant le ralliement du tandem Valls-Macron à la logique du marché, en profite pour pousser encore plus loin son avantage, puisqu’il réclame maintenant 50 milliards supplémentaires, la remise en cause du droit du travail et des acquis sociaux, la suppression des normes et réglementations des marchés, la baisse des seuils sociaux, etc. S’il n’exige pas qu’on renvoie les enfants travailler dans les mines, c’est sans doute que les mines n’existent plus !
Pour justifier sa position, le MEDEF met régulièrement en cause l’insupportable « coût du travail », qui serait en France plus élevé qu’ailleurs, ce qui pèserait à la fois sur l’emploi et sur la compétitivité. Intox ou réalité ?
Le grand patronat se plaint depuis toujours que les travailleurs coûtent trop cher. Son rêve serait évidemment que les gens travaillent pour rien, ce qui augmenterait d’autant les bénéfices (mais poserait quand même la question de savoir avec quels moyens les gens pourraient ensuite consommer ce qu’on a produit !). Au XIXe siècle, quand on a supprimé le travail des enfants, le MEDEF de l’époque assurait déjà qu’on allait ainsi faire s’effondrer toute l’économie nationale. Aujourd’hui, ce sont les dépenses liées à l’utilisation de main-d’œuvre qui sont dans le collimateur, bonne excuse pour justifier les délocalisations vers des pays qui ne connaissent que des salaires de misère.
Le coût du travail se définit comme la somme des salaires bruts et des cotisations sociales patronales. Le coût moyen de l’heure de travail est en France de 35,6 euros, plus qu’en Allemagne (32,8 euros), mais beaucoup moins qu’en Suède (43 euros). Alléguer dans l’abstrait le coût du travail n’a cependant pas beaucoup de sens, aussi longtemps que ce coût n’est pas rapporté à la fois à l’indice des prix et à la productivité. Un coût salarial élevé n’est en effet pas nécessairement un frein à la compétitivité si le coût par unité produite reste faible. C’est la raison pour laquelle, pour effectuer des comparaisons internationales, on parle de coût salarial unitaire réel. Le coût du travail est plus élevé en France qu’en Allemagne, mais nous avons une productivité supérieure de 20 % à celle des Allemands. En proportion de la productivité horaire moyenne, le coût horaire du salaire minimum se situe aujourd’hui à son plus bas niveau depuis soixante ans.
La vérité est qu’il est très difficile d’établir une relation directe entre le montant des coûts salariaux et le niveau du taux de chômage (il n’est, en Suède, que de 7,7 %, alors qu’il est de 10,3 % en France). On peut certes diminuer les cotisations sociales, mais cela implique de trouver d’autres modes de financement de la protection sociale (l’impôt ? les prélèvements privés ?). Et si l’on diminue le salaire minimum, on diminue du même coup le pouvoir d’achat minimum, donc la demande, donc la production, donc l’emploi.
Si l’on parle beaucoup du coût du travail, on ne parle d’ailleurs jamais du coût du capital, qui n’est sans doute pas moins pesant.
C’est le moins qu’on puisse dire. Il faut bien distinguer ici capital productif et capital financier. Le capital productif, nécessaire à la production des biens et des services, a besoin de faire des dépenses à la fois pour son entretien et pour ses investissements. Si, pour ce faire, il ne dispose pas de ressources propres, il doit solliciter un financement externe auprès de ses actionnaires, qu’il rémunère en dividendes, ou de prêteurs, qu’il rémunère en intérêts. Ce sont ces versements qui correspondent au coût du capital financier. Or, celui-ci compte aujourd’hui pour 50 % du coût économique du capital, contre seulement 20 % dans les années 1960-1970. Résultat : les entreprises dépensent désormais deux fois plus en dividendes nets, versés à des actionnaires-rentiers qui veulent se goinfrer le plus vite possible, qu’en investissements nets. Les dividendes des actionnaires des entreprises du CAC 40 sont eux-mêmes en hausse de 30 % sur un an, alors que l’investissement reste désespérément plat. C’est une des conséquences de la financiarisation de ces trois dernières décennies, qui n’a cessé de privilégier les détenteurs du capital financier par rapport aux entrepreneurs. Une captation qui n’est évidemment pas étrangère au manque de compétitivité de ces derniers.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 27 octobre 2014)