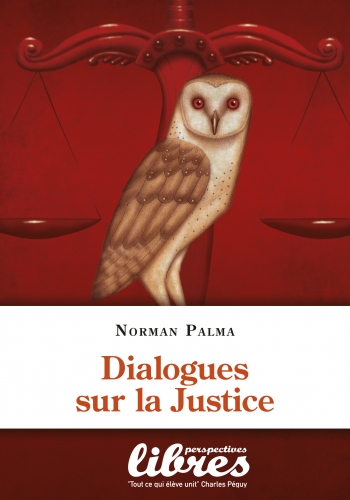Justice, ruine et délires : quand le système judiciaire français coule à pic
Tribunaux surchargés, gardiens de prison débordés, laxisme généralisé : l'institution judiciaire, clé de voûte de la République française, est aujourd'hui dans un triste et inquiétant état.
• A l'intention des persécuteurs stipendiés "Décryptage", "Décodeurs" & co., membres du Taubira-fan-club : tous les faits et chiffres ici mentionnés sont dûment sourcés et bien sûr, à leur entière et inquisitrice disposition.
1) La ruine
Une justice de qualité est-elle encore rendue dans la France de l'automne 2016 ? On peut en douter car le (fort pâle) garde des Sceaux lui-même parle d'une justice "exsangue". Situation d'autant plus grave que, bien sûr, la justice est la clé de voûte de tout Etat de droit.
Commençons par une - affligeante - visite du domaine judiciaire. Déjà, il est bien sous-dimensionné : par rapport à la moyenne de l'Union européenne, la France compte quatre fois moins de procureurs et deux fois moins de juges.
En France même et à l'automne 2015, le président de la conférence des procureurs dénonce "la faillite du service public de la justice" et - fait rarissime - les forts mutiques procureurs généraux élèvent désormais la voix. Tous dénoncent "des retards persistants d'exécution des décisions" et des "difficultés croissantes à faire fonctionner les chambres et fixer les audiences". Ainsi, en juin 2016 "au tribunal de Bobigny, 7 300 peines attendent d'être appliquées".
Avocats d'un côté, syndicalistes de la pénitentiaire de l'autre, tous dénoncent des "juridictions françaises en ruine". Bobigny, on l'a vu, mais aussi Créteil, Nanterre, Brest, Agen, Nantes : postes vacants, exécrables conditions de travail, piètres qualités des jugements ; encore et toujours, énormes délais d'audiencement.
Côté syndical, on constate que les détenus deviennent maîtres des prisons - bandits, islamistes, hybrides (les deux ensemble, type Kouachi-Abdeslam-Coulibaly). Résultat : mutineries et émeutes à répétition, gardiens agressés dans des maisons (d'arrêt ou centrales), où la discipline se perd. Le patron du principal syndicat pénitentiaire parle de "déliquescence du système" et d'"autorité en fuite". Dans les prisons, désormais, "presque chaque détenu possède un portable. Certains en ont plusieurs" - quand c'est bien sûr formellement interdit.
Autre symptôme d'effondrement, les cafouillages dans l'appareil judiciaire ; d'abord, les "libérations intempestives". "Toujours plus de détenus relâchés devant l'impossibilité de s'expliquer devant un juge". Faute d'escortes, des multirécidivistes sont ainsi purement et simplement libérés. Au-delà, des couacs judiciaires en rafales (parmi vingt autres ces derniers mois) :
"Le receleur remis en liberté après une erreur du tribunal"... "Prison : une faute d'orthographe lui permet de sortir et de s'évader"... "Une figure du milieu marseillais libéré pour délai judiciaire dépassé", ainsi de suite.
Autre couac, financier celui-ci. "Victime" d'un premier imbroglio judiciaire, un islamiste de gros calibre reçoit du ministère de la Justice... un chèque de 20 000 euros de dédommagement. L'Obs' - qui n'est pas exactement un brûlot sécuritaire - dénonce une "erreur judiciaire grossière".
A Montargis, des documents de justice confidentiels sont mis à la poubelle et jonchent le trottoir.
Bien sûr, il y a eu les ravages-Taubira, ses expériences libertaires conclues par un bide intégral. Son diaphane successeur finit ainsi par reconnaître l'échec de la "contrainte pénale" (seul acte notable de l'ère Taubira), un "outil peu utilisé par les juridictions". Dit en clair : les magistrats se tapent des inventions de la camarilla-Taubira. S'ajoute à cela le foutoir qui règne depuis lors dans le (pourtant crucial) suivi des condamnés. Dispositif que la Cour des comptes, qui peut avoir la litote cruelle, dénonce en mai 2016 comme "empilement de nombreux acteurs qui peinent à s'organiser et coopérer".
L'idéologie libertaire est bien sûr en cause, mais aussi, une vaste incompétence. Ici, le récent et triste exemple donné par Mme Adeline Hazan, "contrôleuse générale des lieux de privation de liberté" (Inspecteur des prisons, en novlangue socialo). A l'été 2016, la "contrôleuse" déclare ainsi que "plus on construira de places de prison, plus elles seront occupées" - pathétique ânerie sur un banal effet d'optique-statistique, que l'on explique, pour le corriger, aux étudiants en criminologie de première année, vers le deuxième ou troisième cours...
Bazar, idéologie, incompétence... Là-dessus, les bobards de journalistes naïfs ou complices. Après un braquage, combien de fois lit-on dans le journal que "le vol avec usage ou menace d'une arme est puni, au maximum, de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende". Bon, se dit le lecteur : au moins, un malfaiteur paiera pour ses crimes. Tu parles.
Car sous Taubira & succession, voici comment passe la justice, la vraie, celle du quotidien. Août 2016 : lisons "Le Phare dunkerquois", de ces petits hebdos de province où affleure encore le réel criminel. Omar B. est toxicomane. 27 inscriptions au casier judiciaire. Enième affaire de vol en flagrant délit. Tribunal et sentence : "Le condamné n'est pas maintenu en détention (il sort donc libre)... Sa peine de neuf mois fermes est aménagée (en français, annulée) pour qu'il puisse entrer en post-cure et être opéré du genou". Vous avez bien lu. La justice Taubira & co., désormais appendice de la Sécu.
De telles affaires, chaque semaine.
2) Les délires
Dans les décombres de notre justice, les aberrations se succèdent, le burlesque un jour, l'effrayant le lendemain - le scandaleux, toujours - sur un rythme accéléré.
De ces aberrations, voici la dernière (à ce jour) : Nancy, un criminel incarcéré, en prime, proche d'un "dangereux détenu radicalisé", reçoit par erreur (on l'espère...) les noms des agents pénitentiaires ayant rédigé un rapport sur lui.
Peu auparavant, un autre bandit incarcéré profite d'une "sortie à vélo" pour s'évader et sauter dans la voiture où l'attend son frère, un islamiste fiché.
Et Reda B.
(17 condamnations dont 7 pour braquage) dont on lit qu'il s'est évadé (en 2012) de la prison du Pontet (Vaucluse) "à l'occasion d'un tournoi d'échecs".
Et ces évasions de la prison d'Amiens - deux en quelques mois ! - où des détenus scient les barreaux de leur cellule... Les draps de lit le long de la façade... Le complice dehors qui jette la corde... A l'ancienne, façon Fanfan la Tulipe ! La direction du lieu-dit, par antiphrase, "de privation de liberté", se demande "comment des lames de scie ont pu parvenir jusqu'à eux" - judicieuse question, vraiment.
Et ce tribunal de Grenoble qui, d'abord, prend comme caution d'un caïd de la drogue 500 000 euros en espèces, 1 000 billets de 500 euros "dégageant une forte odeur d'alcool... pour dissiper les traces suspectes".
Parfois, ces foirades confinent au burlesque : "Oise : un cours d'art martial pour les détenus, les surveillants indignés"... "Haute-Garonne : le détenu cachait une piscine gonflable dans sa cellule"... Registre happening, toujours : "Un styliste sans-papiers organise un défilé [de mode] clandestin au Palais de justice de Paris".
Les sportifs maintenant : "Nantes : à peine condamné, un détenu s'évade du tribunal en pleine audience". Le multirécidiviste "bondit hors du box et s'échappe". Les magistrats, bras ballants. Sans doute, ce bondissant "nantais" a-t-il été inspiré par un "collègue" de Colmar qui, plus balèze encore, "A peine condamné, s'évade par la fenêtre du tribunal".
Telle est aujourd'hui la justice, Taubira ou post-Taubira. Car, cette dernière partie jouer les idoles pour médias subventionnés - elle dont, à l'automne 2015, l'action était rejetée par 71% des Français - ça ne va pas mieux.
Un exemple, là encore pris entre dix autres analogues. Février 2016, gare de Lyon : un policier est massacré (triple fracture de la mâchoire, etc.) par un colosse de 110 kilos connu pour trafic de stupéfiants, vols de voiture, rébellion, etc. Arrêtée, la brute épaisse est laissée libre "sous contrôle judiciaire".
A chaque désastre, le transparent garde des Sceaux promet - que faire d'autre ? Tout va s'arranger... Les contrôles seront renforcés... Puis attend, résigné, que le suffrage universel abrège son calvaire.
Voici les dernières convulsions. Au gouvernement, incompétents, idéologues et pragmatiques-largués se déchirent. Suite à une pique du Premier ministre sur la modestie de son bilan effectif, Mme Taubira montre les dents et déclare "Je peux devenir méchante".
Enfin ! Un point sur lequel on peut lui faire pleinement confiance.
Xavier Raufer (Atlantico, 28 septembre 2016)