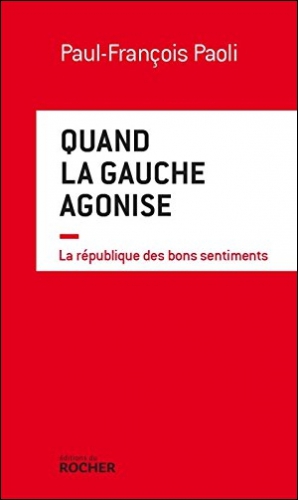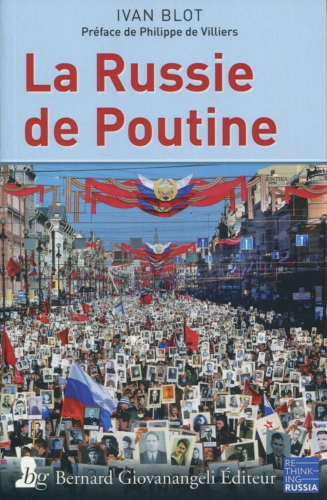La crise de l'identité culturelle européenne
Déjà en soi difficile à définir, l'identité culturelle propre à l'Europe est aujourd'hui battue en brèche par un multiculturalisme de confection récente dont la richesse supposée, issue de sa seule diversité, masque tant bien que mal la déculturation massive imposée par l'existence désormais planétaire d'un courant unique et dominant (mainstream), fabriqué pour être influent mais sans plus aucun rapport avec la formation de l'être humain (Bildung) nommée en Europe « culture » ─ et sans davantage de rapport, il faut préciser, avec l'héritage que les cultures non européennes demeurées « traditionnelles » entendent elles aussi préserver. Aussi nombres des questions relative à cette identité problématique risquent-elles de rester pour l'heure sans réponses claires et précises, rassurantes au regard de l'inquiétude légitime que peut susciter l'état actuel de l'Europe, durablement marquée par les deux guerres mondiales dont elle a été l'épicentre, et depuis lors minée par une défiance envers soi-même allant parfois jusqu'au reniement. On a le sentiment qu'à force de s'entendre dire qu'elle est « vieille », l'Europe a fini par y croire et par se comporter comme telle : « C'est une absence de sol abyssale [...] qui a pris possession des Européens, une absence qui s'exprime dans l'obsession de faire bonne figure en chute libre et de maintenir, avant une fin que l'on ressent comme imminente, l'apparence de la belle vie », constate Peter Sloterdijk. Devrait-on dès lors considérer qu'un film aussi dérangeant que celui de Lars von Trier, Europa (1991), est révélateur du profond malaise né dans l'immédiat après-guerre, et qu'éprouveraient plus que jamais les Européens sans être pour autant capables d'en cerner les contours et d'en identifier clairement les causes ?
Au vu des nombreux films, émissions et débats consacrés à ces deux guerres, on est en effet en droit de se demander si le « devoir de mémoire » ─ en soi respectable, il va sans dire ─ ne contribue pas paradoxalement à entretenir une plaie plus profonde, et donc plus difficilement guérissable : l'Europe se remettra-t-elle jamais de ces deux cataclysmes, et surtout de l'effondrement des valeurs qui les ont rendus possibles ? S'il y a là tous les ingrédients d'une tragédie moderne, le ressort n'en serait plus l’innocence coupable, comme chez les Grecs, mais le fait que la parole soit devenue « plus effectivement meurtrissante que brutalement meurtrière », tant il est vrai que certaines des causes majeures de cette corrosion insidieuse des esprits et des cœurs ne furent jamais que l'envers, la face sombre et inavouée de l'idéologie du progrès dont l'Europe s'enorgueillissait, comme le rappela dès 1936 Thomas Mann dans son Avertissement à l'Europe : « Ce n'est pas la guerre qui a commencé de déchaîner cette vague immense de barbarie et de brutalité qui submerge actuellement le monde. Elle a seulement précipité cet élan. L'homme moderne a été façonné par des impressions violentes qui le troublaient et l'enivraient tout ensemble, et il est la victime de leurs assauts sans cesse renouvelés. L'évolution vertigineuse de la technique, ses triomphes et ses échecs, le sport, les records sensationnels et bruyants, l'importance excessive accordée aux vedettes qui fascinent les foules, les champions de boxe couverts d'or que vient applaudir une assistance innombrable ─ tels sont les traits les plus saillants de notre temps ».
Comment ne pas reconnaître dans cette accélération et cette excitation la marque de fabrique d'une modernité conquérante venue essentiellement d'Europe, encensée par elle et exportée un peu partout dans le monde ? Tant qu'aux « traits » énumérés par Thomas Mann, comment ne pas voir que, loin de s'être atténués ou harmonisés, ils se sont depuis lors amplifiés au point de couvrir de leurs voix discordantes le souci de culture qui fut durant des siècles la préoccupation majeure et le bien le plus précieux des Européens.
Du bon usage des crises
Mais peut-on véritablement parler de « culture européenne » comme si cela allait de soi, alors qu’indépendamment du multiculturalisme ─ avatar du mainstream qui n'ose dire son nom ─ l'Europe est de fait composée d'une mosaïque de cultures en qui s'expriment l'histoire, la sensibilité et la créativité propres à chacun des pays européens ? Quelles sont par ailleurs aujourd'hui les limites ─ géographiques, politiques, culturelles ─ d'une Europe dont la physionomie semble à la fois de plus en plus rigide, si l'on se réfère aux diktats de Bruxelles, et de plus en plus floue, indécise, incertaine dès qu'on tente de saisir quelle « identité » est encore ou sera dans le futur la sienne face aux autres continents et puissances ? C'est donc en deçà de ces différences qu'il faut tenter de restituer à l'Europe ce qu'elle possède en fait déjà, mais dont elle semble avoir perdu la mémoire : une unité fondée, non pas sur des intérêts économiques communs ou des peurs partagées, mais sur une certaine idée de la culture et des comportements qu'elle implique dans l'espace public et privée ; espaces qui, pour être distincts, n'en étaient pas moins jusqu'à ces derniers temps reliés par une exigence de cohérence et de continuité propre à l'homme cultivé. Or, un des traits de la crise actuelle est justement de brouiller les limites entre ces deux sphères, et de faire de la « culture » un bien de consommation à part entière, délesté de toute référence identitaire.
De plus, toute réflexion sur l'identité est aujourd'hui suspectée, non seulement de figer une réalité éminemment malléable, et donc évolutive, mais plus encore de favoriser le rejet de l'Autre, devenu une sorte de surmoi rappelant en permanence à l'homme européen ses devoirs en matière d'altérité, au cas où il serait tenté de les oublier. Telle est en effet devenue, depuis la fin de la dernière guerre et la liquidation des possessions coloniales, la hantise des Européens traumatisés par l'impuissance de leur culture, parmi les plus évoluée du monde, à repousser la barbarie nazie. Un raisonnement simpliste voudrait alors qu'en débarrassent la culture européenne de toute référence identitaire et de toute attache ressemblant de près ou de loin à un enracinement ; en la simplifiant à l'extrême et en la rendant consommable par n'importe quel être humain, on se prémunit contre une possible rechute de la civilisation dans l'inhumain ─ personne ne sachant pour autant comment ce double déficit, en matière d'identité et de culture, pourrait se transformer en garde-fou. Je rejoins donc sur ce point Jean-François Mattéi, dont je salue la lucidité en même temps que la mémoire : « Il faut bien qu'il y ait dans la vie des cultures comme dans la vie des homme, sauf à se perdre dans une totale confusion, des identités vécues qui prennent conscience de ce qu'elles sont et par rapport auxquelles des altérités se définissent [...] On aura beau exalter l'Altérité aux dépens de l'Identité, on ne réussira qu'à renforcer, en inversant les rôles, l'identité de la première au détriment de l'altérité de la seconde ».
On ne se prive pas, par contre, d'attirer l'attention des peuples européens sur leur identité économique de consommateurs, ou sur leur identité d'écocitoyens appelés, pour un oui ou pour un non, à prendre conscience de leurs responsabilités à l'égard de la planète à l'heure même où ce sont des pays entiers qui la mettent impunément en danger. Et que dire des revendications identitaires en matière de sexualité ! Certaines seraient-elles donc plus respectables que d'autres ? Parler d'identité culturelle ne serait-il qu'un dangereux archaïsme, ou l'expression d'une incurable nostalgie risquant à tout moment de réveiller le spectre du nationalisme ? Je n'en crois rien, évidemment, sauf si l'on dévalue la culture au point de n'y voir qu'une forme de conditionnement servile, mais je constate qu'il y a bel et bien là un blocage et un clivage des esprits, entretenus par les médias et face auxquels nombre d'intellectuels se montrent finalement très consensuels. A qui fera-t-on pourtant croire quand perdant son identité culturelle, l'Europe ne perdra pas aussi son immunité et ses réflexes de survie face aux formes nouvelles de barbarie qui pourraient se manifester sur son sol, et qui remettraient radicalement en cause l'idée qu'elle s'était jusqu'alors faite de l'homme et des rapports humains ? Non pas que cette idée soit nécessairement meilleure que toutes les autres, mais au nom du droit imprescriptible reconnu à toute communauté humaine de décider, au regard de son histoire et de la vision qu'elle se fait de son futur, du « cours » des valeurs donnant sens à son destin.
Qu'est-ce d'ailleurs qu'une crise ? Une situation critique, à n'en pas douter, comme on le dit couramment de l'état d'un malade entre la vie et la mort. Mais si la crise où nous sommes englués paraît si difficile à juguler, c'est qu'elle présente un double visage, particulièrement déroutant pour les Européens qui y sont confrontés : une lente érosion, un épuisement sans réel espoir de guérison ─ une décadence, en somme ─, et dans le même temps la menace d'un effondrement subit, dramatique mais conjoncturel, comparable au fameux krach boursier de 1929, qui hante d'ailleurs les esprits. Aussi les Européens se sentent-ils tiraillés entre un sentiment d'usure et de fatalité lié à leur longue histoire, et un constat d'impuissance face à une catastrophe annoncée qui n'atteindra certes pas qu'eux, mais conforte d'ores et déjà leur résignation : si la crise est mondiale, comment une culture aussi fatiguée que la nôtre n'en ressortirait-elle pas encore plus amoindrie, encore plus ébranlée dans ses fondements déjà bien vacillants ?
Les Européens que nous sommes tendent donc à oublier qu'une crise ─ du verbe grec krino, signifiant « juger », « comparer », « choisir » ─ est une suspension temporaire d'activité permettant un discernement plus aiguisé, plus avisé. Aussi ne peut-on dissocier krisis et skepsis (examen, observation) sans courir le risque de voir cette suspension du jugement favoriser le scepticisme ; non pas en tant que rétention salutaire d'une opinion insuffisamment éclairée, mais sous forme de soumission désenchantée aux faits au nom d'un réalisme avoisinant le fatalisme, car étrangement déconnecté de la réalité. Tandis qu'une crise, vécue comme telle, permet un contact plus direct avec le réel, celle où prédomine l'indécision sceptique engendre une servilité aux faits, allégés du poids de la réalité et donc de cette gravité face à laquelle l'homme cultivé, par l'étude autant que par l'expérience, gagne lui-même en densité : « L'avoir vu de la skepsis est ce vidi (j'ai vu et vois maintenant) qui a en vue la réalité du réel », rappelle Martin Heidegger. Une situation de crise réunit donc en principe les conditions favorables à l'exercice d'une pensée authentiquement critique, et non vainement polémique. Or, il semble bien qu'il n'en soit rien en ce qui concerne la question de l'identité d'une part, et celle d'une Europe « culturelle » de l'autre, et c'est parce que les Européens manquent aujourd'hui cruellement de discernement quant à l'horizon culturel qui pourrait leur être commun que l'idée même d'Europe est en crise ; une crise du jugement, de la faculté de juger, pour parler comme Kant. Il n'en est pour preuve que la surenchère médiatique associant désormais communément jugement et discrimination, au sens le plus injurieux du terme ; et glissant ensuite directement de la discrimination à la « stigmatisation » : un terme si fort, si chargé de réminiscences religieuses aussi, qu'il bloque immédiatement toute tentative pour tenter de juger, aussi sainement que possible il s'entend, certaines attitudes individuelles ou situations collectives auxquelles personne ne trouve au demeurant de solution.
Que cette crise du jugement concerne en tout premier lieu l'identité semble logique dans la mesure où la référence identitaire est partie intrinsèque de la faculté de juger, qui ne saurait s'exercer sans une référence, fût-elle minimale, au fameux « principe d'identité » formulé par Aristote et sous-tendant depuis depuis toute la logique et la métaphysique occidentales. En accord plus ou moins étroit avec ce principe, on peut dire que l'identité induit d'abord un rapport de soi à soi permettant de répondre, même de manière approximative, à la question « Qui suis-je ? », et donc d'assumer ses actes. De ce fait, l'identité est aussi un signe de reconnaissance offert au monde extérieur permettant aux êtres humains de se situer les uns par rapport aux autres, et donc aussi de s'évaluer mutuellement. Le fait d'offrir une image de soi à peu près identifiable répond ainsi à des exigences sociales très pragmatiques tout en fondant les relations entre individus sur une civilité élémentaire, même si les relations humaines sont toujours infiniment plus complexes que cela. Enfin, l'existence d'une identité relativement stable et reconnaissable suppose qu'elle va pour l'essentiel perdurer dans le temps et fonde donc la possibilité de la transmission, autant dire la survie même de la culture tant du point de vue collectif (modes de vie, croyances) qu'en tant que processus de « formation » individuelle. N'en déplaise à ses détracteurs, l'identité ainsi comprise est partie prenante de tout processus de culture, auquel revient en bloquent le processus de culture, auquel revient en retour le devoir de déverrouiller les crispations identitaires s'il advient qu'elles bloquent le processus d'identification réfléchie, constitutif de l'humanisation. Ce que résume à mon sens la belle formule de Pindare : « Deviens qui tu es » (Pythiques, II) reprise par Goethe, puis par Nietzsche.
On se doit donc de récuser la logique simpliste, inspirée par l'idéologie mondialiste, selon laquelle le noyau identitaire d'une personne ou d'un peuple forgé par sa propre histoire, serait un obstacle à son dialogue avec autrui. Raisonner ainsi revient à méconnaître le fait qu'aucune identité n'a pu survivre sans devoir composer, s'adapter, tout en cherchant à préserver ce qui la différencie et fait qu'elle n'est pas absorbée par plus puissant qu'elle. C'est aussi pourquoi tout être enfermé dans une identité supposée immuable se révèle tout aussi vulnérable, par excès de protectionnisme cette fois-ci. Assumée dans sa plasticité et sa complexité par contre, l'identité est justement ce qui permet d'être suffisamment sûr de soi pour s'aventurer vers ce qui n'est pas soi, sans esprit de soumission ni de conquête ; ce qui autorise à trouver sa voie entre les extrêmes et permet de se construire soi-même sur un pied d'égalité avec les autres et pas forcément contre eux, ni dans un rapport de dépendance aveugle à ces grands Autres que sont l'État, la Société, et maintenant l'Humanité qui tend à s'y substituer. Une première difficulté réside certes dans le fait d'appliquer à une culture des critères définis en fonction de l'individu, cet indivisible à l'aune duquel l'identité devient pour la première fois perceptible. L'histoire nous a également appris qu'une identité collective fonctionnant comme celle d'une individu entraîne immanquablement une perte du discernement personnel et favorise les comportements grégaires. Tel fut justement en Europe le rôle dissuasif de la culture, négociant au plus juste ce passage toujours risqué entre le dehors et le dedans, le propre et l'étranger.
Ce qui ne laisse d'être surprenant, et constitue la seconde difficulté, est que les raisons pour lesquelles on pense aujourd'hui devoir procéder à une déconstruction de l'identité culturelle européenne ─ ou en dénoncer les prétentions à s'imposer comme telle ─ n'ont pas grand-chose à voir avec celles énoncées depuis plus d'un siècle par les philosophes, préoccupés par une redéfinition du « sujet » dans son rapport au monde ; cette tâche ardue supposant certes qu'on en finisse avec les prétentions d'un sujet abusivement autocentré, mais afin de découvrir une posture nouvelle ─ celle du philosophe-artiste chez Nietzsche, ou du Dasein chez Heidegger par exemple ─ susceptible de répondre adéquatement à la crise d'identité sans précédent qui secoue l'Occident. Autant dire que ce travail authentiquement critique effectué par la philosophie passe le plus souvent à la trappe ou est dénaturé en sous-produits libertaires aisément négociables, comme si le fait d'en finir avec toutes les formes de « centrisme » (logocentrisme, ethnocentrisme, phallocentrisme) allait à soi seul promouvoir le seul idéal humain désormais respectable. Ainsi fait-on le jeu du nihilisme, dont le travail de sape ne peut dès lors même plus être formulé en termes de crise puisque les faits confirment chaque jour davantage la prophétie de Nietzsche : voir l'Europe glorifier l'auto-torture qui est en train de la détruire.
La juste mesure européenne
Ces questions préliminaires une fois posées, encore faut-il tenter de leur découvrir un premier dénominateur commun qui nous serve de repère comme le ferait une balise de détresse en pleine mer. Quand nous parlons de l'Europe et quand nous évoquons les dangers qui la menacent, de l'intérieur comme de l'extérieur, à quoi refusons-nous implicitement de renoncer ? Qu'est-ce qui, dans la vision que nous nous faisons de l'Europe, est pour nous de l'ordre de l'irrenonçable ? J'emprunte ce mot peu usité à la philosophe Maria Zambrano, auteur d'un bel essai intitulé L'agonie de l'Europe, écrit en 1945 lors de son exil à La Havane où elle trouva refuge après avoir fui la dictature franquiste. Il est d'ailleurs probable que toute situation d'exil, surtout si elle est déterminée par le refus de l'intolérable, offre l'occasion de mieux percevoir cet « irrenonçable », et de circonscrire par là même le noyau identitaire auquel on s'est identifié de manière consciente ou inconsciente, et qui finit par devenir un point aveugle lorsqu'on vit au quotidien dans sa proximité.
Ainsi est-ce en regagnant l'Europe après son exil américain que le héros d'Europa de Lars von Trier l'ampleur de la confusion qui s'est emparée des esprits durant la période nazie, et qui s'est perpétuée depuis lors indépendamment du rejet du nazisme en tant qu'idéologie. C'est également lors de son exil en Suisse, où il a trouvé refuge après avoir été déchu de la nationalité allemande, que Thomas Mann affirma son refus de voir l'Europe s'identifier au projet nazi : « La crise qui menace de nous faire retourner à la barbarie a ses racines dans la générosité aveugle de ce siècle », écrit-il en parlant du XIXe siècle. Prononcé par un ardent défenseur de la culture, et de l'humanité partout où elle est menacée, ce constat vaut d'être médité. C'est à Londres enfin, où elle a rejoint la France Libre, que la philosophe Simone Weil écrit en 1943, peu avant sa mort, ce livre inclassable qu'est L'enracinement, sous-titré « Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain », dont Albert Camus dira : « Il me paraît impossible en tout cas d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Weil a définies dans L'enracinement ».
Osons donc nous poser la question : où en sommes-nous aujourd'hui quant au droit imprescriptible des Européens à s'enraciner dans autre chose qu'un idéal consumériste désormais mondialisé, ou qu'un humanitarisme de bon ton mais déconnecté de la réalité ? Si tout penseur digne de ce nom doit être prêt à endurer l'expatriation, comme le montrent les exemples précités, cet exil semble en train de devenir intérieur pour nombre d'Européens en pertes de repères, vacillant entre une « identité nationale » devenue obsolète ou frappée de suspicion, et une identité supranationale qui n'est pour l'heure qu'un cache-misère abstrait, puisque c'est sous la bannière de la société marchande que s'étend à l'échelle planétaire un déracinement humain généralisé, abusivement nommé « cosmopolitisme » au regard de ce que ce terme signifiait pour les Grecs : être le citoyen d'un monde qui soit à la fois un cosmos et une polis ! Jamais autant qu'aujourd'hui ne s'est donc imposée la nécessité de dépasser, par la culture justement, l'alternative stérile entre cosmopolitisme et enracinement, dont les peuples sentent d'ailleurs d'instinct qu'en la leur imposant sur de telles bases, on leur ment.
A quoi donc ne serions-nous pas prêts à renoncer qui nous paraisse typiquement européen ? Et quand je dis « européen », je ne pense pas à la simple extension du sentiment d'appartenance à un pays avec ce que cela peut comporter d'irrationalité affective et de chauvinisme. Je pense à une spécificité plus large, qui nous semble alors si précieuse que nous ne pouvons envisager d'y renoncer sans avoir le sentiment d'un appauvrissement insupportable, non seulement pour nous-mêmes, mais indirectement pour tout le genre humain : ce qui s'est épanoui là ne se trouve pas ailleurs et nous définit en propre, même si nous sommes prêts à le partager avec quiconque en apprécie également la qualité. Car avant d'être l'entité géographique, politique et économique qui a tant de mal à se construire aujourd'hui, l'Europe est devenue, grâce à la culture qu'elle nous a transmise justement, une catégorie de notre sensibilité ; autant dire qu'elle induit, par son existence dans nos esprits, un type de rapport à l'espace et au temps dont nous n'avons plus conscience, sauf en nous exilant, mais qui structure implicitement notre vision du monde, oriente nos activités et nous donne, ou du moins nous donnait jusqu'alors, un horizon commun : une manière particulière de percevoir la relation du proche et du lointain, de l'intimité et de l'étrangeté, de l'intelligence et de la sensibilité. Et si nous savons bien que cette manière est elle-même très diversifiées selon les contrées pouvant toutes se dire « européennes », nous en connaissons les modulations principales et sommes capables de les décliner comme autant de tonalités restituant toutes leurs nuances à l'âme et à l'esprit européens. C'est d'ailleurs ainsi que les visiteurs étrangers perçoivent spontanément l'Europe, que ses proportions géographiques leur permettent d'entrevoir comme un tout magnifiquement proportionné, équilibré jusque dans ses contrastes les plus marqués.
Ce regard porté sur l'Europe ne pourrait être aussi englobant s'il ne renvoyait à la source d'où il tire son unité, en dépit des diversités mentionnées. Aussi pourrait-on tenter d'appliquer à l'Europe ce que Oswald Spengler disait du « symbole primaire » par quoi chaque culture éveille l'homme à lui-même à travers la conscience de son environnement spatial : « La première intuition de la profondeur est un acte de naissance psychique à côté de la naissance corporelle », affirmait-il en effet, qualifiant l'homme européen de « faustien » en raison de sa tension d'esprit « vers le lointain, vers l'au-delà, vers l'avenir », autant dire vers l'infini. L'invention de la perspective géométrique aurait-elle revêtu en Europe une telle importance si l'esprit européen ne s'était reconnu, à partir du XVIe siècle tout au moins, dans cette reconfiguration du proche et du lointain ? Cela dit, il faut aussi rappeler qu'une partie non moins importante des Européens cultivés a refusé de s'identifier à ce regard « faustien », aujourd'hui assumé par une hypermodernité devenue cosmopolite, mais en décalage de plus en plus flagrant avec les préoccupations « de terrain » qui sont celles de la plupart des Européens. Comment construire l'Europe, ou au moins ne pas la détruire, sans devoir changer de regard sur cette tension interne à l'européanité qu'on nous présente depuis au moins deux siècles comme une opposition frontale entre deux visions incompatibles, alors qu'il faudrait apprendre à y reconnaître le moteur même, ou en tout cas la dynamique possible du génie créateur européen de demain ?
Encore faut-il accepter l'idée qu'il n'y a pas d'homme-en-soi, hormis dans le cerveau surmené des idéologues, mais un façonnage culturel de l'humain ; et j'ai montré dans Des héritiers sans passé combien le génie européen semble avoir justement trouvé là une mesure à nulle autre pareille entre formation de la personnalité individuelle et ouverture à l'universel. Quiconque a voyagé dans des contrées surdimensionnées où l'espace et le temps n'ont ni la même qualité ni la même valeur sait, pour en avoir éprouvé le manque, qu'un tel sens de la mesure n'aurait probablement pu exister sous d'autres cieux, d'autres lumières, d'autres espaces que ceux du « petit cap du continent asiatique » (Valéry) nommé Europe. Cet équilibre souverain, l'Europe l'a aussi recherché dans la tension régnant depuis deux millénaires entre mesure grecque et démesure chrétienne s'il est vrai, comme le pensait Rudolf Kassner, que « la conversion est l'unique mesure, l'unique loi, l'unique grandeur de l'homme démesuré, du chrétien ». D'où la question : l'Europe est-elle en train de perdre la « mesure » qui lui était propre, et avec elle l'équilibre que nous enviaient jusqu'alors les habitants des autres continents ? La perdre du fait du nivellement culturel imposé par la mondialisation d'une part, et de la saturation de ses capacités d'adaptation, d'assimilation, d'intégration, d'autre part. C'est donc bien le rapport du Même et de l'Autre qui est en train de se jouer en Europe, mais qu'adviendra-t-il de l'altérité si elle ne trouve plus aucun pôle de référence à peu près stable par rapport à quoi se situer ?
Personne d'un tant soit peu cultivé ne songerait cependant à contester que l'Europe, telle que nous la connaissons aujourd'hui, s'est pour une part façonnée à partir d'éléments étrangers qu'elle a su assimiler, transformer, incorporer à une réalité culturelle nouvelle en constante évolution. Paul Valéry en dénombrait trois principaux ─ grec, romain et chrétien ─ et voyait en eux les repères permettant de distinguer ce qui est européen et ce qui ne l'est pas : « Toute race et toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise, quant à l'esprit, à la discipline des Grecs, est absolument européenne », disait-il. Partageons-nous encore une telle certitude, par ailleurs fondée sur la souveraineté reconnue à l'esprit humain ? Une souveraineté faite d'indépendance, d'insoumission, mais aussi d'inquiétude ; d'une insatisfaction permanente et d'une volonté de puissance pouvant aller jusqu'à la violence : un « idéalisme héroïque », disait Maria Zambrano. quoi qu'il en soit les critères selon lesquels définir l'esprit en ce qu'il a d'européen paraissaient relativement précis à Paul Valéry et à nombre de ses contemporains, car indéniables historiquement et culturellement parlant. C'est aussi pourquoi son analyse de la « crise de l'esprit » pouvait s'adosser à ces certitudes, et nous paraît rétrospectivement d'une lumineuse clarté au regard des verdicts hasardeux et souvent résignés qu'on nous impose aujourd'hui quant au destin européen : l'Europe aurait fait son temps, et serait de surcroît responsable de son propre déclin.
Rupture ou continuité ?
A supposer que nous surmontions tous ces blocages, et parvenions à mettre en évidence l'existence d'une sorte d'invariant culturel plus ou moins commun à la plupart des pays européens - une attitude commune face à la « formation » de l'homme nommée culture, dirais-je plutôt -, en quoi la crise affectant depuis quelques décennies l'identité culturelle de l'Europe diffère-t-elle de celles d'hier ou d'avant-hier ? Car enfin, Nietzsche parlait déjà de crise dans le dernier quart du XIXe siècle, puis d'autres illustres penseurs après lui : Paul Valéry, Thomas Mann, José Ortega y Gasset, Julien Benda, Georges Bernanos... Y a-t-il ou non continuité entre la crise d'hier, telle qu'elle a été décrite avec une belle unanimité par la plupart des grands penseurs européens dans l'entre-deux-guerres, et celle d'aujourd'hui dont on nous dit qu'elle pourrait confirmer le déclin inéluctable de l'Europe ? La continuité est frappante dès qu'on s'intéresse de plus près à certaines des manifestations de la « crise de l'esprit » si remarquablement décrite par Valéry, qui tend d'ailleurs à y voir l'expression même de la modernité : « L'homme moderne s'enivre de dissipation », écrivait-il en 1932, rendant d'ores et déjà perceptible ce qui saute aujourd'hui aux yeux : que l'homme moderne voue en effet un culte idolâtre à l'« énergie », quitte à en être intoxiqué et à bientôt ressentir la très paradoxale « monotonie de la nouveauté ». Entrons plus avant dans les détails, et la continuité devient encore plus parlante : déteriorisation du rapport au langage, dispersion, désordre mental, futilité des préoccupations... Quand Jan Huizinga forge dans les années 1930, pour décrire cette situation nouvelle, le terme de « puérilisme », on croit déjà entendre Philippe Muray décrivant Festivus festivus au cours de ses entretiens avec Élisabeth Lévy. Lorsque Maria Zambrano constate l'émergence d'une nouvelle attitude de l'Européen et parle à ce propos de « servilité devant les faits, les faits atomisés », l'écho est immédiat dans la rengaine fataliste actuelle : Que faire ? On n'y peut rien... et d'ailleurs il en a toujours été ainsi, etc.
Quand Valéry déplore que l'école soit concurrencée par trop de sources de savoir pour conserver son autorité, c'est la situation catastrophique des établissements scolaires français qui nous semble décrite et c'est, plus largement, la débâcle culturelle actuelle qui déjà se profile dans certaines de ses prémisses, telles que les a énoncés Thomas Mann : « Les jeunes ignorent la culture dans son sens le plus élevé, le plus profond. Ils ignorent ce qu'est travailler à soi-même. Ils ne savent plus rien de la responsabilité individuelle, et trouvent toutes leurs commodités dans la vie collective. La vie collective, comparée à la vie individuelle, est la sphère de la facilité. Facilité qui va jusqu'au pire abondons. Cette génération ne désire que prendre congé à jamais de son propre moi. Ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, c'est l'ivresse ». Tout semble donc prêt, dès les années 1930, pour accueillir les « réseaux sociaux » dans les mailles desquels des millions de gens, restés plus ou moins adolescents, dilapident aujourd'hui leur temps, leur concentration d'esprit, leur santé et leur réputation parfois. Mais qu'à cela ne tienne : on nous annonce que des systèmes encore plus performants seront bientôt sur le marché, qui aggraveront encore cette dispersion, rendront peut-être irréversible ce gâchis des intelligences les plus vulnérables à ces nouvelles formes de conditionnement par le « social », devenu si omniprésent qu'on peut difficilement ne pas y déceler une nouvelle forme de totalitarisme.
Que de différences pourtant sous d'indéniables continuités entre hier et aujourd'hui ! On pensait en effet dans l'entre-deux-guerres pouvoir imputer la crise de la conscience et de la culture européennes à la montée en puissance des masses, animés par une aspiration légitime à la culture ne pouvant que fragiliser l'image élitiste qu'on s'en était jusqu'alors faite. On aimerait donc savoir si l'inquiétude des grands penseurs européens face à ce phénomène n'était qu'un préjugé de classe, fort heureusement surmonté par la démocratisation de la culture ─ le terme de « masse », ne faisant alors qu'exprimer un désarroi des élites face à cette onde de choc que fut la « révolte des masses » (Ortega y Gasset), bientôt suivie par ce mouvement correcteur qu'aurait été la « culture de masse ». En bref, s'agit-il là d'une défaite définitive de la culture dont les aspirations les plus ahutes, devenues inaccessibles au plus grand nombre, auraient en retour entraîné la démission des clercs, ou tout au contraire d'une élévation si incontestable du niveau général des esprits que la référence aux masses deviendrait quasiment injurieuse ? Faute de s'être au moins posé ces questions, on est conduit à constater que la manifestation grandissante des esprits va aujourd'hui de pair avec une disparition des masses miraculeusement reconverties en public, en auditoire, à la rigueur en foules les jours de grande affluence dans ces deux hauts lieux, ces lieux saints de la culture que sont devenus à égalité les stades et les musées.
Mais il y a plus grave, plus décisif aussi quant à une éventuelle sortie de crise. Il y a la confiance que l'on mettait encore, au début du XXe siècle, dans les ressources inépuisables de l'esprit alors même qu'on le savait en crise, en Europe tout au moins. Ce qui est manifeste dans les proclamations de Valéry est tout aussi présent, ou au moins sous-jacent, chez les penseurs qui lui sont contemporains : l'esprit ne saurait vraiment décliner, et encore moins mourir. Les convulsions qui sont présentement les siennes attestent d'une vie qui lui est propre et qui inclut cette lutte intestine, ces contradictions intimes, cette mésentente de soi à soi dont le Journal de Gide est l'éclatant témoignage, parmi d'autres documents d'époque. Ni le « désordre de notre époque mentale » sur quoi insista tant Valéry, ni la confusion et la démoralisation qui s'ensuivent ne pouvait à l'époque entamer la certitude que l'esprit régénère et finalement guérit ce qu'il a détruit, comme l'affirmait déjà Hegel dans la Phénoménologie de l'esprit et dans ses cours sur la philosophie de la religion où l'esprit, porteur de cette sorte de péché originel qu'est la volonté de connaître à tout prix, se révèle capable d'auto-guérison et de rédemption. C'est donc l'époque tout entière qui, dira plus tard Thomas Mann, se trouve « prise dans les douleurs de la transition ». Une époque en train d'accoucher du futur, en somme, mais d'un futur qui, étant radicalement nouveau suppose-t-on, aggrave les douleurs ordinaires de l'enfantement.
D'où le recours à des métaphores à première vue surprenantes, et qu'on croyait d'un autre âge : celle du phénix renaissant de ses cendres par exemple, par quoi Husserl clôt sa méditation sur « La crise des sciences européennes et la philosophie » (1936) ; ou celle, plus parlante encore, utilisée par Valéry à propos des pouvoirs quasi miraculeux de l'esprit : « Il est une véritable pierre philosophale, un agent de transmutation de toutes choses matérielles et spirituelles ». Qui oserait encore parler ainsi ? On mesure alors tout ce qui sépare de l'Europe actuelle de cette vision à la fois très lucide et très créatrice de la vie de l'esprit, sous-tendant toutes les autres opérations par quoi se régénère au jour le jour une culture : le travail, les liens sociaux, l'idée qu'une collectivité se fait de son passé comme de son avenir. Pour avoir été le « continent-mère de la modernité », comme dit Sloterdijk, et pour avoir été le laboratoire où la vie de l'esprit a connu ses tourments les plus sombres, l'Europe ne pourrait-elle se montrer capable de vivre son apparent déclin comme le signe avant-coureur d'une nouvelle métamorphose ? En quoi cette vérité d'hier se pourrait-elle être celle de demain, si tant est que les Européens retrouvent confiance en leur destin commun ?
Toute situation de crise a, il est vrai, ceci de dangereux, surtout si elle s'éternise, qu'elle anesthésie, émousse jour après jour le désir d'en sortir. Si la crise actuelle est aussi grave, non seulement d'un point de vue économique mais quant à la passivité désenchantée qu'elle suscite dans les esprits, c'est qu'elle ne peut être perçue comme une difficile mais prometteuse transition, puisque personne n'est capable d'indiquer vers quoi pourrait avoir lieu ce transit. En bref, quand c'est l'idéologie moderniste du progrès qui fait faillite, à qui fera-t-on croire qu'on ne s'achemine pas, de crise en crise, vers une inéluctable régression ? Qui parmi les Européens serait prêt à admettre que la modernité, qui s'était donnée pour projet l'horizon infini de la découverte et de la conquête, est désormais contrainte de revoir à la baisse ses ambitions ? La plus grosse difficulté est pourtant là : dans la capacité des Européens à reconvertir cette relative faillite en transition, non pas vers le même projet, retrouvant comme par miracle un second souffle, mais vers une réappropriation de ce qui, dans l'héritage culturel européen, permettrait la métamorphose envisagée par Nietzsche : « L'Europe est une malade qui doit une suprême reconnaissance à son incurabilité et à l'éternelle métamorphose de sa souffrance : ces situations, ces dangers, ces douleurs et ces expédients par leur renouvellement incessant ont fini par provoquer cette irascibilité intellectuelle qui est presque autant que du génie, et en tout cas la mère de tout génie. ».
Il ne s'agirait plus en tout cas pour l'Europe d'être à tout prix « moderne », puisque d'autres pays ont pris le relais et vivent à leur tour cette crise d'adolescence de l'esprit, de plus en plus risquée d'ailleurs, puisqu'on sait moins que jamais jusqu'où l'appétit de nouveauté propre aux temps modernes va conduire l'humanité enrôlée sous sa bannière. S'agit-il même encore, pour l'Europe actuelle, d'exporter l'universel ? Des instances internationales sont désormais là pour cela, du moins en principe, qui auront tôt ou tard à s'interroger sur la meilleure manière de gérer, à l'échelle planétaire, la remontée des particularismes culturels et le refus, clairement affiché par certains peuples, de vivre sous la loi d'une universalité qui ferait implicitement d'eux des « Européens ». Ce n'est pas non plus d'être anti-moderne à tout prix qu'il s'agit, au risque d'aggraver encore la faille entre les esprits. Mieux vaudrait tenter d'être autrement moderne en renonçant à vénérer les causes d'un échec devenu manifeste ; en apprenant à le devenir de manière moins fanatique et donc à la fois plus inactuelle et plus intempestive, comme le préconisait Nietzsche. Peut-être le temps est-il venu pour l'Europe de prendre au mot ou au moins à demi-mot ceux qui la disent « vieille », et d'assumer la vertu de pondération, de sobriété reconnue par la vox populi à la vieillesse.
Disant cela, je ne pense pas seulement au rôle d'arbitre, de conseillère avisée qu'on pourrait être tenté de lui faire jouer sur la scène mondiale, tant en raison de sa vieillesse présumée que du sens de la mesure caractérisant les périodes les plus florissantes de sa culture. Je pense à une attitude plus exemplaire encore qui concerne son rapport au passé et à ce patrimoine d'une exceptionnelle diversité, et qualité, que tout être humain sur cette terre aurait désormais le droit de s'approprier sauf les Européens eux-mêmes, tout juste promus au rang de gardiens de musée, voire de guides touristiques pour clients étrangers fortunés. Car en « muséifiant » de manière très professionnelle le patrimoine, rendu ainsi accessible à tout un chacun sous une forme scientifique et donc soi-disant neutre, on s'emploie consciemment ou non à en relativiser à tout prix la portée affective, culturelle et plus encore spirituelle susceptible de toucher un public plus spécifiquement européen. Si ce phénomène est perceptible dans la plupart des grands musées du monde gagnés par la volonté d'être résolument modernes, il devient en Europe le signe de la distance séparant désormais les Européens de leur propre culture.
Cherchant à définir l'esprit européen, Paul Claudel disait qu'il se caractérise par un « état général d'alerte et de mobilisation des cœurs et des esprits ». Une telle mobilisation a longtemps répondu à l'appel de la surenchère progressive ─ toujours au-delà, encore davantage ─ exaltant cette vertu moderne par excellence qu'est, selon Hans Blumenberg, la curiosité d'esprit. Il est donc grand temps que les Européens réapprennent, sans forfanterie ni mauvaise conscience, à se réapproprier avec une non moins grande curiosité leur culture, et à redécouvrir qu'elle n'inclut pas seulement les œuvres de grande valeur conservées dans les musées d'Europe, mais un savoir-faire et un savoir-être au quotidien dont la perte ferait de nous à la fois des sauvages et des barbares, pour reprendre une distinction de Schiller dont les Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme (1785) mériteraient à cet égard de devenir le bréviaire de l'Européen cultivé de demain.
Françoise Bonardel (Krisis n°41, septembre 2015)