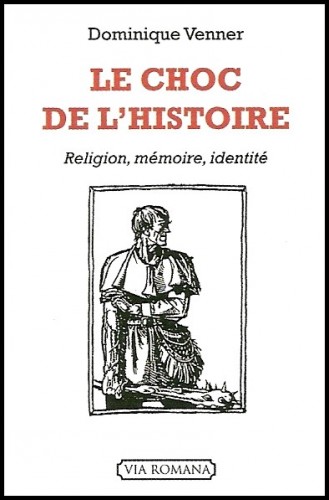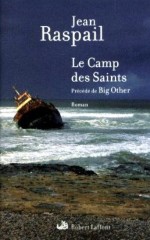Nous reproduisons ci-dessous un excellent point de vue de Philippe Milliau, publié sur le site Novopress (dont nous vous conseillons de découvrir la nouvelle maquette). Une Europe identitaire et puissante, c'est la solution à la crise. Mais il nous manque les hommes d'Etat européens pour la construire...

Crise de la dette : et demain ?...
Le contexte de la crise des dettes dites souveraines, et qui paraît s'emballer, comporte plusieurs causes profondes.
La plus fondamentale est celle de l'habitude de la fuite en avant, celle qui ne permet de réaliser des équilibres budgétaires que dans le cadre d'une double croissance, économique et démographique.
Or, Nolens volens, il faudra bien que le monde s'habitue à une double décroissance ou pour le moins à une double a-croissance. En effet, qui peut sérieusement penser que notre planète continuera à empiler un milliard d'humains de plus tous les treize ans comme elle le fait depuis le milieu du siècle dernier ?
Qui peut sérieusement envisager une croissance continuelle qui mènerait à un mode de vie à l'américaine pour dix milliards d'hommes en 2050 ? Les ressources de quatre planètes y suffiraient à grand peine.....
Il FAUDRA donc bien que les collectivités publiques, comme les ménages, révisent leurs façons de faire, et parlons clair, leur train de vie...... Il FAUDRA bien que les pays (voire les continents entiers, comme l'Afrique) qui n'ont pas achevé leur transition démographique la réalisent au plus vite et par tous moyens utiles.
La seconde cause majeure est celle de la dictature des marchés financiers, qui sont aujourd'hui, bien plus que les puissances politiques, les maîtres de nos destinées. Leur bras armé : les trois agences de notation anglo-saxonnes. Notons au passage que si la Chine vient de créer son agence, l'Europe ne s'est toujours pas résolue à cette nécessité. Deux conséquences pratiques : des taux d'emprunt à long terme qui varient de 3% à 17 % (cas actuel de la Grèce, avec même des pointes à 31 % !). Et comme ce sont les notes décernées par les agences qui dictent le taux... Le taux des USA reste au plus bas, celui de la Grèce au plus haut. Ils sont pourtant, au regard de leurs finances publiques dans une situation quasi identique.... A noter, plus grave encore, que si le reproche fait à la Grèce d'avoir caché voire trafiqué les comptes publics est fondé, les USA qui n'ont pas provisionné des obligations douteuses, ni comptabilisé à plein programmes de relance ou déficits, ont une situation réelle probablement bien pire, et sur une autre échelle !
La troisième est le fait d'une Communauté Européenne qui se trouve dans la situation du milieu du gué ; l'eau monte, et certains crient « retour en arrière toute, revenons sur la rive que nous avons quittée », d'autres « il est plus que temps d'avancer vite vers l'autre rivage ». Oui, il est aberrant d'avoir une monnaie unique dans un continent dépourvu de toute souveraineté politique ; oui il est absurde de laisser des divergences macro-économiques profondes se creuser entre pays européens ; oui, il est ridicule d'avoir un budget communautaire de l'ordre de 1% du PNB, incapable d'assurer les nécessaires convergences économiques, fiscales, stratégiques et sociales entre pays de l'Eurogroupe au moins (ceux qui sont en zone Euro).
La Grèce a été mal gérée ; lorsqu'une collectivité locale est en France dans ce même cas, que fait on ? La puissance publique (le préfet, et non les marchés !) place sous tutelle, restructure la dette à bas taux et restaure, après un audit approfondi, une situation compromise. Rappelons que plus de la moitié de la dette grecque est maintenant causée par les taux d'intérêts exorbitants prélevés par les marchés...
Ne nous le cachons pas : nous sommes sur un baril de poudre. Les intérêts mondialisés sont tellement croisés, l'interdépendance tellement forte que personne ne veut allumer la mèche et faire sauter l'édifice. Alors, il est politiquement correct de dire que tout compte fait, c'est une bonne chose que cette dépendance de chacun vis à vis de tous. Voire : un accident est si vite arrivé, et l'on s'aperçoit alors un peu tard que le bateau qui ne coule pas est celui qui est capable de rendre étanche une partie de ses compartiments, pas celui du mondialisme qui n'en comporte plus qu'un seul. Sans doute est ce la raison pour laquelle la Chine comme les USA ont conservé certains moyens d'indépendance, tout en préconisant aux autres de les abandonner méthodiquement.
Quelles issues possibles ? Première question : où se situera l'épicentre d'un séisme qui est de plus en plus probable. Les Anglo-saxons font tout pour que ce soit en Europe, raison pour laquelle leur presse financière, leurs agences de notation, leur establishment et leurs valets nous balancent des torpilles successives et de plus en plus fortes et rapprochées à mesure que leur situation empire. Grèce, Irlande, Portugal ; et en mode récent et plus redoutable par la dimension, Espagne et Italie.
Un pouvoir médiatique et politique digne de ce nom aurait répliqué Californie, Ohio, New York, et plafond de la dette US relevé 74 fois en 10 ans …... Clairement, ils jouent l'effritement de l'Euroland, jusqu'à la fin de la timide concurrence que l'Euro commence à faire au Dollar. Ils sont aidés par l'impuissance des instances européennes, conséquence prévisible des freins permanents que les gouvernements des états-nations placent devant toute marche en avant d'un véritable empire fédéral européen. Le maintien de ces rétractions nationales, aidées hélas par certaines positions de courants populistes, signifieraient la sortie durable des Européens de l'histoire du monde.
Mais en fait rien n'est joué, il suffit pour s'en convaincre de voir les résultats d'un récent sondage dans lequel nos concitoyens s'exprimaient massivement en faveur d'un protectionnisme à l'échelle continentale.
En symbiose donc avec le peuple, les identitaires français et d'autres pays d'Europe vont intensifier leurs campagnes et propositions en ce sens. Signature d'un nouveau pacte de stabilité en Eurozone et limitation d'adhésion à ceux qui le respectent. Impossibilité constitutionnelle de proposer l'entrée de pays non européens. Ministre des finances européen disposant des outils d'investigation nécessaires. Augmentation significative du fonds de secours financier, et création d'Eurobonds, pour dégager les dettes souveraines des griffes des marchés. Rigueur budgétaire en contrepartie de vastes projets et d'une véritable Europe identitaire et puissante, porteuse de rêves et d'espoirs ; interdiction de vente du patrimoine (par exemple celui qu'incarne l'un des plus grandioses sites sacrés de notre culture, le Parthénon). Détaxation de la proximité et barrières douanières aux frontières de l'Europe. Véritable souveraineté européenne sur la monnaie, les technologies stratégiques et de défense, sécurisation des approvisionnements énergétiques en partenariat Europe / Russie. Et bien évidemment montée en puissance du budget européen par contrepartie de la baisse corrélative des budgets nationaux.
Oui, notre triple identité est locale par notre vie concrète, nationale par l'histoire et la langue, et européenne par la civilisation et la puissance. Pour cette dernière, les incantations ne suffisent pas, il faut aussi s'en donner des moyens. De cette crise les Identitaires proposent de sortir par le haut.
L'histoire ne repasse pas les mêmes plats...
Philippe Milliau (Novopress, 18 juillet 2011)