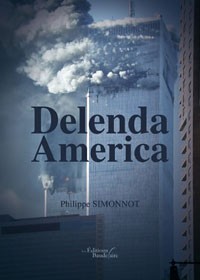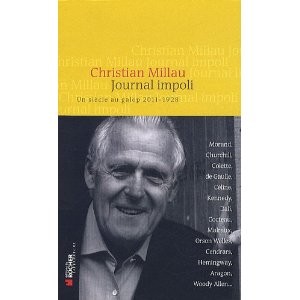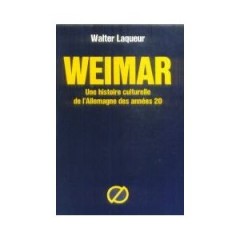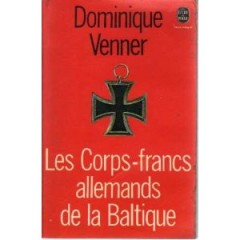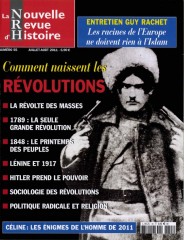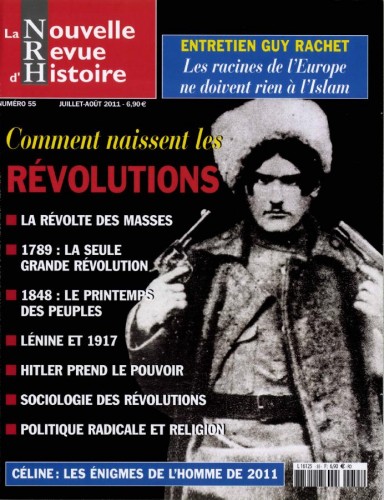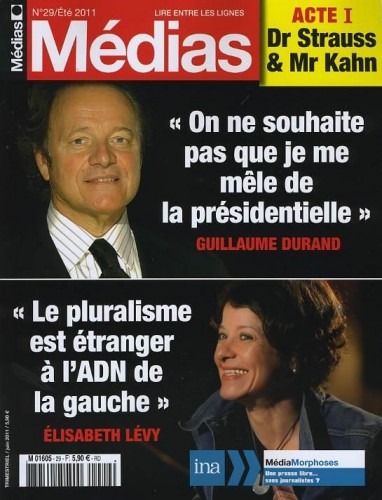L’EUROPE DE WEIMAR
Il y a décidément une fascination pour Weimar ! Une fascination qui emprunte à l'expressionnisme, au Bauhaus, à Bertolt Brecht, à Marlène Dietrich, au Docteur Mabuse et à L’ange bleu. Mais aussi à Stefan George et à Georg Lukács, à Spengler et Rosa Luxemburg, Alfred Weber et Theodor Adorno, au putsch de Berlin et à la Commune de Bavière, au communisme et aux corps-francs. Pourquoi cette fascination ? Walter Laqueur, professeur d'histoire à Tel-Aviv, directeur de l'Institut d'histoire contemporaine et de la Wiener Library, donne peut-être la réponse quand il dit de la culture de Weimar qu'elle fut la « première culture authentiquement moderne ».
C'est en effet dans cette République née de la défaite et de l'humiliation nationale produite par le Diktat de Versailles, qui commence en novembre 1918 avec la mutinerie de la flotte de la Baltique pour s'achever en 1933 avec le défilé des chemises brunes sous la Porte de Brandebourg, c'est dans cette société dominée par les partis, marquée par la violence (354 attentats politiques recensés entre 1919 et 1922), l'inflation et le chômage, c'est dans ce tourbillon politique, dans ce chaos économique, que semblent être apparus la plupart des grands courants de pensée, intellectuels et politiques, artistiques et littéraires, dont se nourrit encore notre époque, qu'il s'agisse de l'existentialisme, de l'écologisme, du néo-nationalisme et du néo-marxisme, des mouvements de jeunesse et de la microphysique, du nietzschéisme et de l'Ecole de Francfort, de l'art abstrait et de la musique atonale.
Mais la République de Weimar n'est pas seulement « moderne » en raison de son extraordinaire densité historique et intellectuelle, qui fait que son nom est désormais associé à ceux, si différents, d'Einstein, Spengler, Brecht, Gropius, Thomas Mann, Moeller Van den Bruck, Fritz Lang, Ernst Jünger, Max Reinhardt, Gottfried Benn, Paul Klee ou Heidegger. Elle l'est aussi, et surtout, par la transformation générale des idées dont elle a été le lieu.
A partir de 1918-20, on assiste en effet, en Allemagne, à des redéfinitions radicales. Une pléthore d'idées nouvelles font leur apparition, aussi bien parmi les intellectuels « de droite » (dont « à très peu d'exceptions près, souligne Laqueur, aucun ne se rallia plus tard au nazisme ») que parmi ceux « de gauche », tandis qu'en l'espace de quelques mois, les mêmes électorats passent massivement d'un bout à l'autre de l'échiquier politique. Le vocabulaire associe alors les termes les plus contradictoires. On parle de « Révolution Conservatrice » et d'athéisme religieux, de néopaganisme et de marxisme mystique, de Règne et d'Empire, de classe et de nation, de pouvoir et d'utopie. Des hommes classés « à droite », comme Jünger et Moeller Van den Bruck, rêvent d'une alliance des « peuples jeunes » : l'Allemagne et la Russie soviétique. Le gouvernement social-démocrate fait appel aux « ultras » des corps-francs pour rétablir l'ordre à Berlin. Leo Schlageter, jeune résistant exécuté par l'occupant (français) de la Ruhr, est tout à la fois célébré par la droite nationaliste et le parti communiste. « Conservateurs » et « progressistes » se disputent l’idée de révolution et critiquent avec la même virulence l'univers plat et banal (entzaubert, « désenchanté ») de la bourgeoisie. Le tonnerre gronde sur fond de « décadence » et d'« avant-garde ». Berlin s'amuse, mais on se bat aux frontières. Tout s'effondre et tout renaît. C'est l'inter-règne.
Les hommes eux-mêmes suivent les itinéraires les plus surprenants. Citons le cas d'Edgar J. Jung (né en 1894), ancien des corps-francs, membre du cercle jeune-conservateur de Munich, auteur d'un vigoureux pamphlet contre le « règne des médiocres » (Die Herrschaft der Minderwertigen, 1927), proche collaborateur de von Papen à partir de 1932, assassiné par les nazis en juillet 1934 au moment de la « nuit des longs couteaux ». Ou celui d'Ernst Niekisch (1889-1967), membre du parti social-démocrate en 1917, directeur à partir de 1926 de la revue « nationale-bolchevique » Widerstand, à laquelle collabore Ernst Jünger, condamné sous Hitler à la détention à vie, communiste orthodoxe après la guerre, professeur à Berlin-Est de 1948 à 1954.
Telle fut la République de Weimar, époque de contrastes et de désespoir, de surenchères et de contradictions, que Georg Lukács, dans sa Théorie du roman, décrira comme le temps de la « culpabilité parfaite » (das Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit), dans laquelle le poète Gottfried Benn verra en 1955 « les plus merveilleuses années de l'Allemagne », et dont Ernst von Salomon, cité par Dominique Venner dans son remarquable ouvrage sur les corps-francs, dira : « Ce que nous voulions, nous ne le savions pas, et ce que nous savions, nous ne le voulions pas. Pourtant, nous étions heureux dans la confusion, car nous avions la sensation de ne faire qu'un avec notre temps… » (Les réprouvés).
Si la République de Weimar reste aujourd’hui encore si mal connue, et surtout si mal comprise, c'est précisément – de pair avec ce que Joseph Rovan appelle « l'ignorance des réalités allemandes qui persiste en France » (L'Allemagne n'est pas ce que vous croyez, Seuil, 1978) – parce que cette période ne laisse pas ramener aux schémas classiques auxquels nous sommes habitués, et que pour apprécier et analyser les hommes, les partis, les idées ou les événements qui l’ont illustrée, ces schémas se révèlent inadaptés.
Mais en même temps, c'est aussi parce qu’elle constitue une sorte d’énigme historique que Weimar reste au cœur de nos préoccupations. Ce n'est pas un hasard si le « culte de Weimar », pour parler comme Laqueur, atteint aujourd’hui son apogée, de Paris à Tokyo et de Rome à New York, au moment où notre univers politique et intellectuel est affecté par de puissants reclassements. Ce n'est pas un hasard non plus si l'on n'en finit plus, en « redécouvrant » Marcuse, Adorno, Rosa Luxemburg ou Wilhelm Reich, de constater que l'essentiel du débat d'idées actuel avait déjà été dit dans le courant des années 1920. Certes, il ne faut pas abuser des analogies historiques. Tout se passe néanmoins comme si Weimar constituait le parfait modèle d’un « entre-deux-temps » à venir. Comme si Weimar était le signe avant-coureur d'un nouvel inter-règne, plus étendu cette fois dans l'espace et dans le temps. Peut-être est-ce le sentiment que l'Europe contemporaine commence à ressembler à une vaste République de Weimar qui crée chez nos contemporains, autour de cette époque, une atmosphère mythique, dépassant de beaucoup les modes et les nostalgies, et qui, séduisant en même temps qu'elle affole, mobilise la sensibilité plus encore que la raison.
Alain de Benoist (Le Figaro magazine, 30 septembre-1er octobre 1978)
Walter Laqueur, Weimar. Une histoire culturelle de l’Allemagne des années vingt, Robert Laffont, 323 p. ; Dominique Venner, Les corps-francs de la Baltique, Livre de poche, 509 p. ; Volker Hentschel, Weimars letzte Monate, Droste, Düsselforf, 180 p.