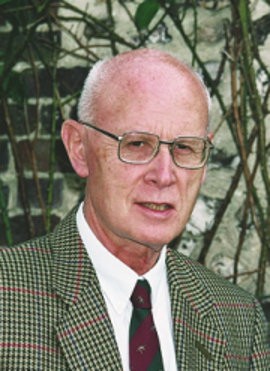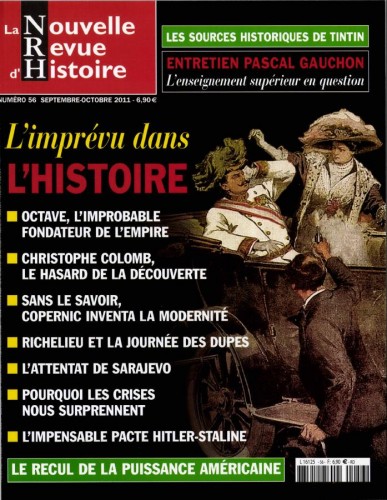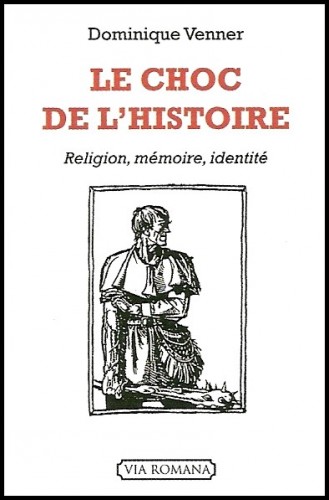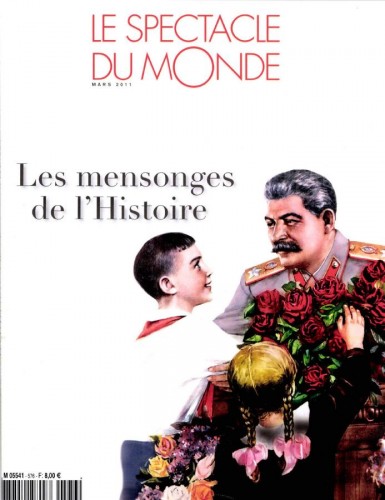Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de l'africaniste Bernard Lugan, cueilli sur son blog, à propos des nouveaux programmes d'histoire au collège.

L’histoire des mondes non européens a toujours figuré dans les programmes scolaires, cependant, elle n’était pas enseignée aux dépens de l’histoire de France. De plus, cette nécessaire ouverture ne se faisait qu’à partir du moment où les fondamentaux de notre histoire étaient acquis par les élèves. Aujourd’hui, il en va tout autrement avec la réforme Darcos qui prépare le délitement de l’imaginaire historique national, ce précieux socle auquel les Français sont encore arrimés.Les ravages commencent désormais dès la classe de 5° qui a subi des amputations insensées et même proprement « ubuesques » de son programme d’histoire. Or, ces amputations ont été rendues nécessaires afin de dégager autant de plages horaires destinées à l’étude des civilisations non européennes, qu’elles soient africaines, asiatiques ou autres. Pour ce qui concerne l’Afrique, seront ainsi étudiés plusieurs royaumes avec un point central, celui du Mali. Pour leur « faire de la place », Louis XIV a donc été relégué en toute fin de programme et il ne sera donc « survolé » que si le Monomotapa (!!!) a été vu. De même que les crédits de l’armée constituent la variable d’ajustement des déficits de l’Etat, l’histoire de France devient quant à elle la variable d’ajustement des apprentis sorciers du ministère de l’Education nationale.Toute éducation supposant l’acquisition de fondamentaux et de connaissances de base sans lesquelles il est impossible ou vain de vouloir aller plus loin, il est donc insensé de vouloir faire apprendre l’histoire du Mali à des enfants qui ne savent pas si Napoléon a vécu avant ou après Louis XIV…Les « docteurs Folamour » du pédagogisme ne l’ignorent pas. Ils en sont même parfaitement conscients, mais ce sont d’abord des militants dont le but est de casser tous les enracinements européens considérés par eux comme susceptibles de déclencher des réactions identitaires.Ne nous cachons pas derrière notre pouce et disons les choses clairement : le premier but de cette aberrante réforme de l’enseignement de l’histoire est de toucher le public de ces établissements mosaïques dans lesquels 30 à 40% d’élèves possédant moins de 350 mots de vocabulaire, ne sachant ni lire, ni écrire, ni même raisonner et encore moins comparer, pourrissent littéralement l’apprentissage de classes entières. Les assassins de notre mémoire espèrent, grâce à cette réforme, capter l’attention de ces auditoires « difficiles » et avant tout peu intéressés par l’histoire de France, en leur proposant une histoire sur mesure, une histoire à la carte, une histoire ethno sectorielle en quelque sorte.Les élèves d’origine mandé-malinké de Tremblay en France seront peut-être attentifs à l’histoire de l’empire du Mali qui fut constitué par leurs ancêtres, mais il risque de ne pas en être de même avec les petits soninké de Garges les Gonesse, héritiers, eux, du royaume de Ghana qui fut détruit par les premiers…De plus, comment vont réagir les rejetons des nombreux autres peuples africains ? N’y a-t-il pas une forme de discrimination à leur égard ? En effet, pourquoi privilégier le Mali ou le Ghana et passer sous silence l’empire Luba et le royaume zulu ?Un autre but de ce programme qui fait naturellement de continuelles références à la traite des esclaves vue comme une sorte de fil conducteur de la matière, est de tenter de faire croire aux élèves que l’histoire du monde est d’abord celle de la confrontation entre les méchants, lire les Européens, et les bons, lire les autres. L’ethno culpabilité est décidément sans limites !De plus, et là est peut-être le plus important, l’histoire de l’Afrique a son propre temps long qui n’est pas celui de l’Europe. Elle s’appréhende avec une méthodologie particulière impliquant une maîtrise de la critique des sources orales, une connaissance approfondie de l’anthropologie, de l’archéologie, de la linguistique, etc., Or, les professeurs qui vont devoir enseigner cette histoire à leurs jeunes élèves n’ont pas été formés pour cela.Un exemple : la connaissance que nous avons de Philippe le Bel repose sur des dizaines de milliers d’études, de thèses, de documents d’archives, de mémoires, de correspondances, de traités etc. Son contemporain, Abu Bakr II empereur du Mali (+- 1310-1312), dont l’existence n’est même pas certaine, n’est connu que par des traditions orales tronquées, des sources arabes de seconde ou même de troisième main et par une chronologie totalement erronée établie par Maurice Delafosse en 1912. L’histoire de son bref règne, s’il a véritablement eu lieu, est pourtant largement enseignée en Afrique où ce souverain est présenté comme une sorte d’explorateur conquistador parti à la tête de 2000 ou même 3000 pirogues pour découvrir les Amériques.Les professeurs des classes de 5° qui vont devoir parler du Mali, cœur du nouveau programme, devront évidemment étudier cet empereur. Or, sont-ils formés pour expliquer à leurs élèves que l’histoire scientifique ne se construit pas sur des légendes? De plus, le seul fait, dans un cours, de consacrer le même temps d’étude à un personnage historique attesté d’une part, et à un autre, largement légendaire d’autre part, conduira automatiquement les élèves à prendre le virtuel pour la réalité, ce qu’ils sont déjà largement enclins à faire avec les jeux électroniques.Mais allons encore au-delà et abordons l’essence même de la question. Face à ces élèves « en difficulté» (traduction en langage politiquement incorrect : enfants dont la langue maternelle n’est pas le français), les enseignants oseront-ils, sans risquer un hourvari, expliquer qu’un tel voyage n’a jamais eu lieu? En effet, si tout est faux dans cette légende c’est parce que les Africains de l’Ouest -à la différence de ceux de l’Est-, ne pouvaient affronter la haute mer car ils ignoraient l’usage de la voile ainsi que celui de la rame et parce que leurs pirogues étaient sans quille.Les mêmes enseignants sont-ils armés pour faire comprendre à leurs classes que pour atteindre l’Amérique, les hommes d’Abu Bakr II auraient été contraints de pagayer durant plus de mille kilomètres à travers l’océan atlantique avant de rencontrer enfin le courant des Canaries, seul susceptible de leur permettre de dériver ensuite vers l’Ouest… et cela sur 6000 km ? Enfin, seront-ils en mesure de mettre en évidence l’incohérence majeure de cette légende que certains considèrent comme une histoire vraie, à travers un exemple clair : comment l’expédition de l’empereur malien aurait-elle pu atteindre l’Amérique alors que les Africains ignoraient l’existence de l’archipel du Cap-Vert situé à 500 km « à peine » de la péninsule du Cap-Vert, point le plus occidental du littoral ouest africain contrôlé par l’Empire du Mali et qui leur barrait la voie du grand large ? En effet, cet archipel était vierge et vide d’habitants en 1450, au moment de sa découverte par le Génois Antonio Noli qui était au service du Portugal...[1]L’enseignement de l’histoire africaine ne s’improvise pas !Hier la méthode d’apprentissage de la lecture dite « globale » fabriqua des générations d’illettrés et de dyslexiques; la réforme des programmes d’histoire donnera quant à elle naissance à des générations de zombies incapables de rattacher des évènements ou des personnages à une chronologie et ayant pour toute culture historique celle du volapük mondialisé.Bernard Lugan (Blog de Bernard Lugan, vendredi 23 septembre 2011)