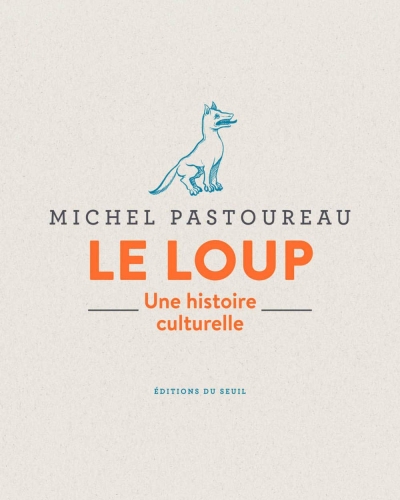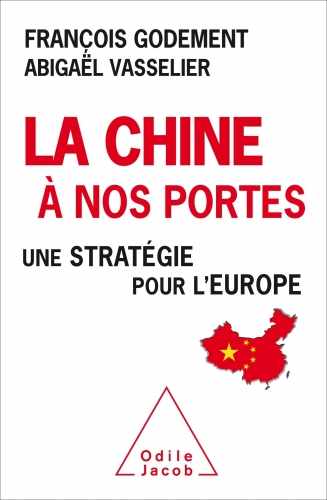Donald Trump, sauveur de l’Europe… malgré lui ?
Il faut bien comprendre, en effet, que l’enjeu international est l’élément le plus déterminant du conflit politique en cours au sein des univers du pouvoir outre-atlantique. Il renvoie aux choix les plus clivants de Donald Trump. Sur le plan extérieur, celui-ci, au même titre que ses prédécesseurs, veut maintenir et affirmer le leadership mondial des Etats-Unis, mais en rompant avec la logique mondialiste d’un multilatéralisme post nationale. Pour lui, la puissance américaine, qui doit rester économiquement et militairement archi-dominante, n’a pas vocation à être la garante d’un ordre mondial qui dépasse et soumet les nations, mais doit assurer sa suprématie dans une approche de nation à nation qui rejette les grandes organisations multinationales ; d’où son aversion pour l’ONU et l’Europe de Bruxelles et sa vigoureuse remise en question de l’OTAN. C’est dans cette logique que Trump souhaite redéfinir les rapports entre les Etats-Unis et la Russie. Il prend acte du fait national russe, de son retour sur le devant de la scène internationale, et souhaite l’appréhender comme un rapport de force objectif à négocier, et non comme une croisade messianique du bien (progressisme libéral) contre le mal (national identitaire).
Cette remise en question de la vision mondialiste qui conduit les politiques occidentales depuis trois décennies, est une mutation idéologique au sein du capitalisme américain qui bouscule la puissance d’un capitalisme financier globalisé qui s’impose aux nations et à leurs agents économiques. Elle s’accompagne d’une volonté de réhabilitation des frontières et de maîtrise des flux migratoires. Elle impacte directement l’avenir de l’Europe.
Une chance pour l’Europe ?
Trump n’est certainement pas un ami de l’Europe dont il méprise visiblement la pusillanimité et la dépendance intéressée à l’égard de la puissance américaine. Toutefois, ses attaques répétées contre Bruxelles, ses initiatives agressives au plan des relations commerciales et son désir de faire payer les européens pour assurer leur protection, pourraient constituer une chance historique pour les peuples du vieux continent de reprendre leur destin en main, et d’échapper enfin à la dilution mondialiste de l’idéologie bruxelloise. La guerre juridique que les Etats-Unis mènent depuis des années contre les intérêts économiques européens à coup de milliards de dollars d’amendes prononcées par leurs tribunaux, a fini par lever le voile sur le cynisme de leurs méthodes de domination économique. Le droit américain, imposé au reste du monde, couplé à l’arme fatale du dollar, forment ensemble un outil de suprématie impériale qu’il n’est plus possible de feindre d’ignorer.
La soumission européenne semble toucher ses limites et les incessantes menaces concernant les liens commerciaux avec l’Iran suscitent désormais des velléités de résistance alors que les pays de l’Union tentent de mettre sur pied des mécanismes d’échange permettant de contourner les sanctions imposées par Washington. Le très lisse Bruno Le Maire, n’hésite plus à déclarer que l’Europe doit se doter d’outils financiers totalement indépendants de l’emprise américaine. L’enjeu est de taille ; il en va de l’avenir du dollar et de sa suprématie mondiale, alors que d’importants pays comme la Chine, la Russie, l’Inde, le Brésil et, désormais la Turquie, se tournent vers une « dédollarisation » de leurs échanges commerciaux. Après l’ère de la domination par la communication souriante et élégante d’un Obama, la brutalité primaire d’un Trump a quelque chose de bénéfique. Elle pourrait susciter un choc salutaire pour une Europe sans repère qui n’a d’autre issue, pour survivre dans un monde hostile et dangereux, que de revenir à ses fondamentaux civilisationnels à partir de ses peuples qui se reconnaissent encore dans leurs nations pluriséculaires.
Puissance et souveraineté
Les européistes les plus convaincus sont pris à contre-pied face au retournement en cours de la politique américaine, alors que leur capacité de domination provenait largement de leur alignement docile sur la puissance des Etats-Unis; cette dernière, désormais, n’est plus leur meilleure alliée. Sur quelle force peuvent-ils s’appuyer pour pérenniser leur système de pouvoir alors que les peuples de l’Union se détournent inexorablement de l’attraction bruxelloise ? Le désir de réhabiliter les souverainetés et les identités des nations au sein d’une Europe unie face à des dangers communs, tend à s’imposer comme l’horizon naturel des peuples européens. Une évolution qui s’inscrirait dans le cadre d’une Europe réconciliée avec elle-même et prête à assumer les défis de la puissance souveraine. Avoir un président des Etats-Unis qui ouvertement appelle à lutter contre l’immigration clandestine et non désirée est un élément capital qui devrait changer l’enjeu migratoire en Europe. Le fantasme mondialiste d’abolition des frontières a perdu son soutien le plus puissant.
La recomposition du monde autour de quelques grands pôles géographiques structurés autour de nations puissantes représente le défi historique de la veille Europe. La technostructure de l’Union européenne, fondée sur la primauté formaliste du droit, de la libre concurrence et d’un humanisme à prétention universaliste, est incapable de répondre aux défis du siècle qui se construit sous nos yeux. Elle a tout simplement oublié l’enjeu de la puissance comme le rappelle inlassablement l’économiste Christian Saint-Etienne. En 2003, déjà, ce dernier écrivait un ouvrage, préfacé par l’ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, dont le titre La Puissance ou la mort : L’Europe face à l’empire américain (Seuil), lançait un cri d’alarme prémonitoire : « Si l’Europe, avertissait Christian Saint Etienne, ne fait pas le choix de la puissance, dans les quinze ans qui viennent elle ne sera plus qu’une proie pour les puissances nationalistes ». Nous y voilà ; et nous sommes bien aujourd’hui placés au pied du mur : « La puissance ou la mort » !
L’Europe actuelle est un ventre mou où, sous le voile de l’union, usé jusqu’à la trame, s’affrontent les égoïsmes les plus sordides et irresponsables. Elle doit se reconstruire sur des bases nouvelles, revitalisées par la volonté des peuples. Le nouvel isolationnisme américain, si la ligne politique de Trump finissait par triompher (ce qui n’est pas encore acquis, en dépit de l’importante victoire symbolique de la nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême), doit représenter une chance pour l’Europe !
Un enjeu de souveraineté que l’institution européenne n’a jamais été capable d’assumer et que son suzerain d’outre atlantique finirait par lui imposer ! Une ruse supplémentaire de l’histoire qui ne doit plus nous étonner. En 1973, déjà, le grand Raymond Aron s’interrogeait sur la dépendance de l’Europe face aux Etats-Unis : « Il m’arrive, écrivait-il alors, de penser que les diplomates américains en suivant les conseils néo-isolationnistes rendraient le même service à l’Europe politique qu’ils ont rendu à l’Europe économique, il y a un quart de siècle ». Les européens, poursuivait-il, s’ils étaient confrontés à la perspective du départ du dernier GI, « trouveraient-ils en eux-mêmes, avec la conscience du danger, le courage et l’initiative nécessaires pour surmonter leur condition d’Etats protégés ? » (1). Nous étions à cette époque en pleine guerre froide. Près de cinquante plus tard, la politique nationaliste de Trump, basée sur le principe « America first », nous contraint à affronter la même question existentielle : « Etre ou ne plus être »…
Denis Bachelot
25/10/2018
(1) Raymond Aron, République impériale, les Etats-Unis dans le monde 1947-1972, Calman-Levy