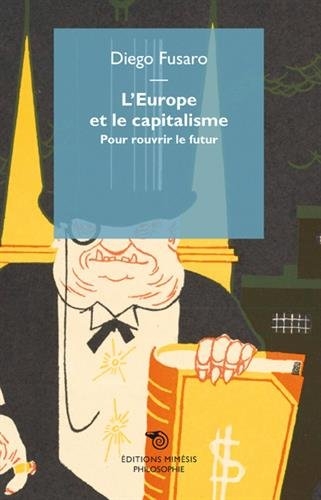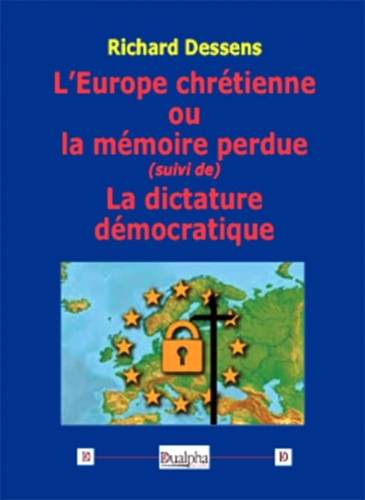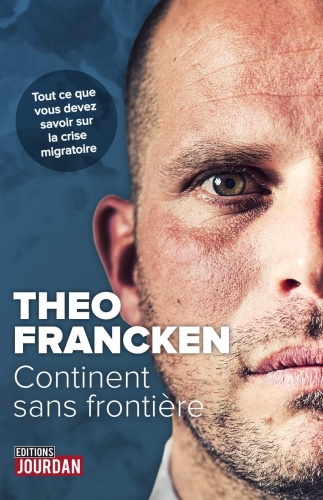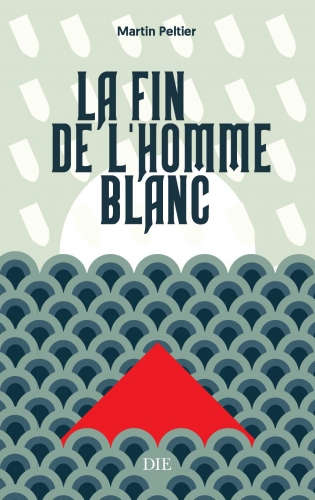Rubicon en vue pour Paris et Bruxelles
On découvre qui l’on a épousé le jour du divorce… Avec l’Amérique, peut-être en sommes-nous là. Notre président s’embourbe dans un marécage qui semble dissoudre ses initiatives les plus audacieuses. Envolées les illusions d’une complicité hors normes, déçues les espérances d’une connivence puissante restaurant le prestige de l’allié français sur la scène mondiale et transformant une vassalisation de fait en dissonance constructive. L’invocation d’une « armée européenne », quelle que soit le flou de la formule et les interrogations abyssales qu’elle ouvre sur le fond, a déclenché l’ire trumpienne avant, pendant et après le Forum de Paris sur la Paix, lui-même entaché d’oublis historiques dommageables à notre influence résiduelle et sans grand effet probable sur la réalité des équilibres du monde et son éventuel apaisement.
Pourquoi une telle fureur ? Cette « sortie » du président français a mis le doigt sur la plaie : il est juste hors de question pour l’Amérique ‒ celle de Trump comme celle de tous ses prédécesseurs ‒ que l’Europe ose jamais s’affranchir de sa tutelle stratégique et se prenne à rêver de compter par elle-même sur la carte du monde autrement que comme un appendice docile de l’imperium de notre Grand Allié. Le vouloir supposerait en effet, pour atteindre la masse critique, de souhaiter rapprocher enfin l’Union européenne de la Russie, ne serait-ce que sur le plan sécuritaire. Inadmissible pour Washington. Il y est presque plus impensable encore que l’Allemagne se rapproche de Moscou, un cauchemar outre Atlantique. La dépendance allemande envers le gaz russe doit d’ailleurs cesser et le gaz américain s’y substituer. Dès cet été, l’opposition tonitruante et insultante pour Berlin du président Trump au projet Nord Stream 2 en a témoigné sans équivoque.
L’Europe politique est donc plus que jamais en morceaux. Ce n’est la faute ni de la Russie ni de l’Amérique. C’est la nôtre, même si Moscou comme Washington y trouvent leur compte, et si l’Alliance atlantique creuse joyeusement les lignes de failles internes de notre Union chaque jour plus désunie, par des invites à consentir à notre dépendance sécuritaire et à notre rançonnement collectif via l’achat d’armement américains et des manœuvres militaires pharaoniques nourrissant les craintes folles de certains membres (Baltes ou Polonais). Les scenarii apocalyptiques de l’OTAN mettent en scène une menace russe de grande échelle face à un ennemi hybride et maléfique qui aurait carrément décidé une invasion des abords les plus vulnérables de l’Alliance. La « guerre froide » fait pâle figure à côté de ces délires otanesques. Moscou a bien d’autres préoccupations et projets qu’une telle lubie. La stratégie russe est défensive, ce qui ne veut pas dire insignifiante, naïve ou dénuée d’opportunisme et d’ambition. Cette « puissance pauvre » mais toujours globale n’a pas renoncé à compter, en Eurasie comme en Afrique, et déploie tous azimuts une diplomatie redoutable de subtilité et d’efficacité, car pragmatique, sans idéologie ni dogmatisme.
Pour Paris donc, après la dernière volée de bois vert reçue à distance, le Rubicon est en vue. Mais pour le franchir, les mots et les images martiales ne suffiront pas. S’ils ne sont pas adossés aux actes, ils creuseront même notre discrédit moral et politique qui n’a pas besoin de cela. Il suffit d’observer la différence de traitement et de réactions occidentales entre les affaires Skripal et Kashoggi pour comprendre que la messe est dite quant aux préoccupations et intérêts véritables de nos États dits modernes et moraux dans leur conception du monde.
Comment laver un tel discrédit, comment faire oublier ce cynisme au petit pied qui nous fait mépriser de tous côtés et, plus encore, va à l’encontre de nos intérêts au Moyen-Orient comme à l’échelle globale ?
Dieu merci, le tragique de la marche du monde offre toujours des occasions de rattraper les bévues, même lourdes. Il y a toujours quelque chose d’important ou d’utile à faire pour préserver l’honneur de la France. En l’espèce, il s’agit d’honorer sa signature apposée au bas du JCPOA de 2015, plus connu comme l’accord nucléaire iranien, qui devait permettre le contrôle des ambitions nucléaires de l’Iran contre le retour de ce grand pays dans le concert des nations et le relèvement de son économie. La sortie unilatérale des États-Unis de l’accord, les sanctions économiques renforcées, les tentatives de déstabilisation politique du régime qui affaiblissement très dangereusement le président Rouhani, la diabolisation croissante de la République islamique rendent vital le maintien de la promesse des autres signataires européens de l’Accord de s’y tenir et d’y maintenir Téhéran, qui jusqu’à présent en respecte scrupuleusement les clauses mais dont la patience s’émousse.
Le mécanisme européen, promis depuis des mois à l’Iran, notamment par Paris, et devant permettre aux pays membres de l’UE de commercer avec lui sans l’imprimatur washingtonien n’est toujours pas actif. « Pas mûr… », dit-on… La France a pourtant le pouvoir et encore l’influence de pousser à sa mise en œuvre effective rapide. Qu’attendons-nous ? Ce test grandeur nature de notre autonomie de décision par rapport à Washington serait décisif aux yeux de Téhéran mais aussi du reste du monde. Ce serait une démonstration de notre détermination à sauver un multilatéralisme mis à mal sur tous les fronts, depuis deux ans, par les États-Unis. Plus concrètement encore, il en va de la sécurité de l’Europe et du monde. Si l’Iran, en effet, était conduit par notre abandon à se dire légitimement délié de ses obligations au terme de l’Accord, la reprise de ses activités nucléaires deviendrait difficilement évitable (ne serait-ce que pour des raisons politiques internes). Celle-ci pourrait être portée par la venue d’un nouveau leadership extrémiste, dont les outrances verbales ouvriraient la voie à une réaction/provocation militaire américaine ou israélienne. Les conséquences sécuritaires d’une telle séquence ne seraient pas, dès lors, circonscrites à l’Iran mais très rapidement régionales voire mondiales. L’Europe aurait fait la preuve ultime de son insignifiance stratégique et le paierait cher à tous points de vue.
La crise du monde est une crise de confiance, une crise du respect, une crise de la souveraineté. Notre Histoire comme nos institutions nous donnent plus qu’à d’autres, sans doute, la possibilité mais aussi le devoir de nous affirmer comme un rempart contre ce dangereux ensauvagement.
Caroline Galactéros (Geopragma, 19 novembre 2018)