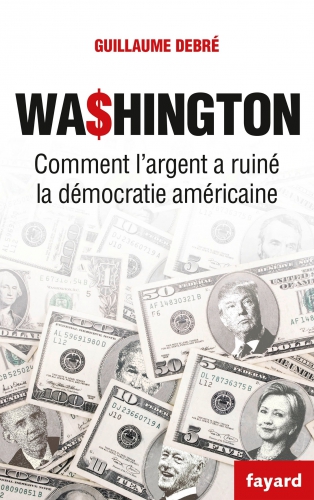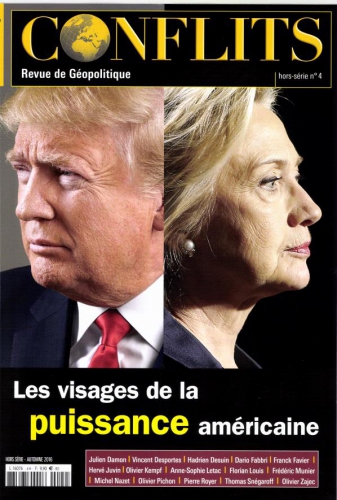Syrie : un martyre sans fin
Le storytelling fait rage depuis 2011 en Syrie. Il brouille les sens et l'entendement. Les Bons et les Méchants sont là, devant nous, Blancs et Noirs, chacun dans leur boîte, crimes de guerre et atrocités contre « rebellitude » armée, sur les victimes de laquelle on s'attarde beaucoup moins, surtout à l'OSDH (Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG basée à Londres)… Le jusqu'au-boutisme des uns et des autres tend l'affrontement vers son paroxysme et semble rendre toute évolution politique pragmatique impossible. Chacun pense encore, du fond de son tunnel mental, pouvoir venir à bout de l'adversaire en faisant assaut de sauvagerie et de résilience. En menant une guerre d'usure de l'horreur et de l'absurdité. L'enchaînement cynique des provocations et des représailles paraît sans fin.
Il est très difficile de continuer à raisonner politiquement devant un tel désastre humain, de ne pas s'abandonner à l'écœurement devant les images insoutenables. Difficile de ne pas juste s'insurger contre ce régime, et contre lui seul, qui résiste si brutalement à l'anéantissement, aux dépens d'une partie de son peuple, pour le sortir des griffes des islamistes ultra-radicaux que l'on nous présente inlassablement comme des rebelles démocrates. Alors, au risque de paraître insensible et précisément au nom de toutes ces victimes innocentes, il faut malgré tout renvoyer à l'enchaînement du drame et faire apparaître sous les gravats les inspirateurs sinistres d'une telle déconstruction humaine et nationale. Car les acteurs locaux de ce carnage planifié, que ce soit le régime syrien ou les innombrables mouvements islamistes qui ont fondu sur le pays depuis 2011, demeurent largement des marionnettes – actionnées avec une habileté fluctuante. Et il est devient chaque jour plus indécent de feindre de croire que ces poupées de chiffon enragées décideront seules du sort du conflit.
Un cessez-le-feu mort-né
La simili-trêve signée à Genève par messieurs Kerry et Lavrov le 9 septembre dernier a volé en éclats. Évidemment. L'administration Obama et les faucons « libéraux » qui l'environnent paraissent en effet de plus en plus tentés d'en finir avec Assad pour gonfler le bilan du président sortant. Quant à la Russie, elle n'a pas d'alternative à la sécurisation d'une « Syrie utile » la plus élargie possible, qui lui assure la part du lion d'un règlement politique ultime. Alors on joue à se faire peur, de plus en plus peur. Moscou accuse Washington d'avoir pavé la voie à une contre-offensive de l'organisation État islamique à Deir ez-Zor (est du pays) en bombardant les forces du régime, tuant plus de 80 militaires syriens. Washington accuse les forces syriennes et russes (incriminant tour à tour la chasse syrienne, puis les hélicoptères russes et enfin des Sukhoï Su-24 qui auraient frappé le convoi deux heures durant) d'avoir bombardé un convoi humanitaire aux portes d'Alep assiégée. Impossible de savoir ce qu'il en est réellement. On peut juste constater que les dommages sur les camions semblent avoir été causés par le feu et par des obus, sans grosse frappe directe ; se souvenir que les rebelles ont rejeté le cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur officielle, manifesté contre l'acheminement d'aide humanitaire au profit des populations qu'ils retiennent sous leur contrôle à l'est de la ville, et avaient même accusé l'ONU de partialité. Quel intérêt les forces syriennes auraient-elles eu à attaquer, dans une atmosphère hautement inflammable, un convoi du Croissant rouge islamique avec lequel elles sont en bons termes et dont elles savaient qu'il ne transportait pas de contrebande ?
Quoi qu'il en soit, le cessez-le-feu était de toute façon mort-né comme les précédents. Moscou ne pouvait réellement souhaiter la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne qui aurait cloué au sol l'aviation syrienne à l'orée de reconquêtes décisives. Surtout Washington, contrevenant aux termes de l'accord du 9 septembre, n'avait nullement l'intention de pousser ses alliés islamistes « rebelles » à se séparer des plus radicaux d'entre eux, le Front al-Nosra (Al-Qaïda) rebaptisé Fateh al-Sham. Logique d'ailleurs, puisqu'ils se servent depuis des années de ces groupuscules pour déstabiliser le régime. Enfin, les États-Unis auraient tout récemment déployé, sans le moindre accord ou consultation du régime de Damas, des forces spéciales et matériels divers dans sept bases militaires au nord-est de la Syrie (là où se trouvent des forces kurdes)... Une préparation dans la perspective d'une offensive générale sur Mossoul ou sur Raqqa, ou simplement dans celle d'un engagement plus décisif encore aux côtés des rebelles et des Kurdes contre les forces du régime syrien ? Bref, la pression monte, à Washington, pour un coup d'éclat, une salve de martialité sur les décombres d'un grand État laïque sciemment livré à une régression antédiluvienne, un fantasme punitif, une rapacité chronique. Tandis que la « coalition » se hâte lentement en Irak vers la reprise de Mossoul, mais doit encore gérer l'indocilité grandissante des Kurdes locaux jaloux de leur autonomie et de leur pétrole, et des milices chiites peu contrôlables qu'elle craint d'armer, on feint encore, en Syrie, de vouloir éradiquer Daech tout en laissant agir ses avatars islamistes les plus forcenés. Tout n'est que jeux d'ombres et de dupes.
Une guerre d'intimidation
Au-delà de cet imbroglio sanglant de plus en plus difficilement lisible, il est clair que le sort des Syriens et de leur splendide pays, partiellement réduit en cendres, est le cadet des soucis des protagonistes principaux qui se toisent et s'affrontent à ses dépens, et qui ont non seulement des intérêts divergents, mais des conceptions radicalement opposées de ce que peut et doit être son avenir.
Les Américains voient en fait, dans les soi-disant « rebelles », des supplétifs commodes à un engagement au sol auquel ils se refusent. Des « terroristes » peut-être, mais surtout des islamistes sunnites anti Assad qui peuvent encore lui ravir le pouvoir et instaurer un équilibre local favorable à leurs intérêts face à l'Iran, et en lien avec la Turquie et l'Arabie saoudite qui demeurent des alliés de fond et de poids pour l'Amérique. À leurs yeux, le terrorisme n'est rien d'autre que l'arme d'un chantage politique s'exerçant contre Damas, mais visant aussi Moscou et Téhéran…
Quant à la Russie, tout l'art de Vladimir Poutine consiste à s'engager suffisamment pour consolider son influence régionale et conserver sa base au Moyen-Orient, sans s'enliser ni devoir entrer dans une confrontation ouverte aérienne avec Washington dont il a de fortes chances de sortir humilié. Dans cette « guerre des perceptions », chaque capitale doit intimider, irriter, faire douter l'Autre, tout en contrôlant le cycle provocations-représailles pour éviter une « sortie de route » difficilement maîtrisable donc aucun ne souhaite encourir les conséquences. On frôle donc quotidiennement la catastrophe dans les airs, entre chasseurs des deux camps, tandis qu'au sol pullulent les missiles américains TOW livrés aux rebelles par les Saoudiens et les S-400 russes basés à Hmeimim… Depuis le chasseur russe abattu fin 2015 par la chasse turque (dûment renseignée sur le plan de vol des Sukhoï et probablement préparée à cette « mission »), et surtout depuis le bombardement russe, le 16 juin dernier, d'une base d'islamistes aux frontières jordaniennes, attaque jugée « hautement provocatrice » par Washington, la montée des tensions devient inquiétante. Et les pressions politiques à Washington pour en finir militairement avec Assad peuvent faire craindre une opération éclair US ouvrant sur une possible « montée aux extrêmes ». Pourrait-on alors tempérer les réactions d'un Kremlin acculé et humilié ? Moscou vient d'annoncer le déploiement prochain de son porte-avions amiral Kouznetzov au large de la Syrie. Une façon d'exprimer son exaspération croissante ? Sa détermination ? Ou de manifester une nouvelle « ligne rouge » ? L'issue de la bataille d'Alep sera géopolitiquement cruciale, au-delà même du martyre de sa population.
Une tragédie où l'Occident tient le pire rôle
La France, elle, parle de crimes de guerre (peut-être à raison) et, fort martialement, dit : « Ça suffit ! » À qui parle-t-elle ? Au régime ? Aux rebelles ? À Moscou ? Même en guise d'écho docile au discours américain, c'est un peu court. C'est d'un cynisme fou surtout, quand on songe à la politique de déstabilisation et de soutien aux islamistes soi-disant démocrates choisie par Paris dès le début de la crise syrienne, au nom de la nécessité d'en finir avec le régime honni et récalcitrant d'Assad. Mais, Dieu merci, notre influence sur le Grand jeu ne s'est exercée qu'à la marge. Même nos alliés américains nous ont lâchés en 2013, sur le point de lancer la curée, au prétexte de l'emploi d'armes chimiques par le régime qui n'a jamais été avéré. Mais les choses auraient, paraît-il, changé et nous serions désormais d'humeur plus lucide et pragmatique. La diplomatie française aurait enfin fait son aggiornamento et pris conscience de la réalité du monde, de certains faits, de son humiliante marginalisation sur la scène mondiale à force de mauvais calculs et de dogmatisme entêté, et en dépit de la valeur et de la compétence de ses armées dont l'excellence l'aurait trop longtemps dispensée d'une vision stratégique véritable. Cette mutation salutaire est encore loin de sauter aux yeux... Et le temps passe.
Le plus tragique est peut-être que, nous (l'Occident) n'avons pas le beau rôle dans cette sombre affaire, mais le pire : celui de fossoyeurs naïfs d'États laïques complexes, certes répressifs et inégalitaires, mais aussi protecteurs d'une diversité religieuse et communautaire précieuse. Peut-être, en France, notre inhibition face à notre propre édifice régalien, notre engloutissement consenti dans le communautarisme, le renoncement à notre histoire et à notre avenir en tant que puissance structurée, inclusive et protectrice, n'y sont-ils pas pour rien.
Caroline Galactéros (Bouger les lignes, 27 septembre 2016)