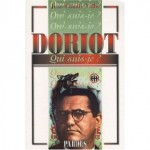Jean-Claude Valla est mort d'un cancer le 25 février 2010.Journaliste engagé, historien éclairé, il avait choisi de combattre avec sa plume.Membre fondateur du Groupement de recherche et d'étude pour la civilisation européenne en 1968, il avait été secrétaire général de cette association de 1973 à 1978 et avait accompagné sa montée en puissance.Au cours de la même période, il avait aussi dirigé la rédaction de la revue Eléments.
Dans sa carrière d'homme de presse, après avoir été journaliste à Valeurs actuelles, il a été rédacteur en chef puis directeur de la rédaction du Figaro-Magazine de 1978 à 1980, à l'époque où ce nouveau supplément du Figaro avait l'ambition de rendre la droite intelligente. Il a raconté cette aventure et sa triste conclusion dans un long article intitulé Avec Louis Pauwels au Figaro-Magazine.De 1983 à dirigé Magazine Hebdo, un hebdomadaire de droite intelligent, offensif et décomplexé. Il a par la suite poursuivi cette entreprise sous la forme plus modeste d'une lettre hebdomadaire, jusqu'en 1999, dont l'éditorial était assuré par Alain de Benoist.
Amateur d'histoire, grand connaisseur de la période de la guerre civile européenne, il collaborait régulièrement à la Nouvelle revue d'histoire de Dominique Venner mais avait surtout créé la collection des Cahiers libres d'histoire aux éditions de la Librairie nationale, dans laquelle il a signé , depuis 2000, pas moins de douze titres. De la Cagoule aux socialistes dans la collaboration en passant par la France sous les bombes américaines, il bousculait à plaisir, dans un style percutant et alerte, les idées reçues grâce à une documentation abondante et de qualité.Il avait publié en 2008 un Doriot, dans la collection Qui suis-je, aux éditions Pardès.La mort l'a saisi dans sa soixante-sixième année, l'empêchant de venir à bout de son projet d'un maître livre sur la période de l'occupation dans la région de Lyon, qu'il murissait depuis plusieurs années.Que cet homme libre repose en paix.
eléments - Page 10
-
Hommage à Jean-Claude Valla
-
Les trois écoles de Mona Ozouf
L'historienne Mona Ozouf, spécialiste de la Révolution, a récemment publié Composition française - Retour sur une enfance bretonne aux éditions Gallimard, un livre de souvenirs et de réflexion sur l'identité de la France, identité faite d'une tension entre l'esprit national et le génie des pays qui la composent. La revue Eléments a rendu compte de cet ouvrage sous la plume de Fabrice Valclérieux.
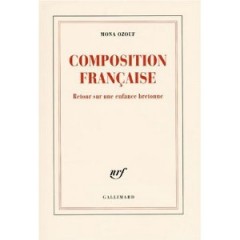
Les trois écoles de Mona Ozouf
Agrégée de philosophie, Mona Ozouf devint historienne sous l’influence de son mari Jacques Ozouf (auteur notamment de Lire et écrire : l'alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry) et de son condisciple à l’École normale supérieure, François Furet. Après un premier livre sur L’École, l’Église et la République. 1871-1914 (1962), elle fera paraître La Fête révolutionnaire, 1789-1799 (1976), puis L'École de la France. Essai sur la Révolution, l'utopie et l'enseignement (1984). Elle dirigera ensuite avec F. Furet le monumental et magistral Dictionnaire critique de la Révolution française publié en 5 volumes de 1988 à 1993 (« Idées », « Acteurs » « Événements », « Institutions et créations » « Interprètes et historiens »). Sa fascination pour « [cette] énigme, [cette] rupture dans le tissu de l’Histoire » (*) que fut la Révolution ne l’empêchera pas d’aborder dans la suite de son œuvre des thèmes comme Les Mots des femmes. Essai sur la singularité française (1995), Les Aveux du roman. Le XIXe siècle entre Ancien Régime et Révolution, (2001), ou encore Jules Ferry (2005).
Dans un registre à la fois semblable et très différent, elle a publié il y a quelques mois Composition française. Retour sur une enfance bretonne, un essai sur ses « souvenirs d’enfance et de jeunesse » à Plouha, un bourg des Côtes d’Armor, en même temps qu’un ensemble de réflexions sur la France et ses régions, sur son unité et sa diversité, au sens, bien sûr, où l’entendait Fernand Braudel.
Le fil rouge de la partie mémorielle du livre est une phrase de l’avant-propos : « Dans ma corbeille de baptême, les croyances [ont été] déposées par trois fées qui ne s’aimaient guère, l’école, l’église et la maison ». Toutes trois vont structurer les années d’apprentissage de la jeune Mona. Elle a quatre ans lorsque son père, instituteur, militant de la cause bretonne, pacifiste et antimilitariste meurt brutalement. Tôt affirmé « patriote breton », contre son milieu familial et contre l’École normale d’instituteurs « foyer d’impérialisme français », il adhéra à divers groupes autonomistes, dont le Parti national breton, tout en se réclamant de la gauche, soit, selon sa fille, « un socialiste nationaliste breton, espèce improbable ». Son rêve : « Une Bretagne autonome dans une France fédérée ». Devenu Yann ar scholaer (Jean le maître d’école), il crée un journal, Ar Falz, qui milite en particulier pour la défense de la langue bretonne. Entre-temps, il épouse une jeune finistérienne qui va embrasser sa cause et militer avec lui. Devenue veuve, elle éleva l’enfant en compagnie de sa mère venue s’installer chez eux. En cette grand-mère, se souvient Mona. Ozouf, tout parlait de l’identité bretonne, notamment la langue, « vigoureuse, expressive, anthropomorphique » mais en même temps « elle était, elle se savait française ».
Pour la jeune Mona, il y a trois écoles. D’abord « l’école de la Bretagne » représentée par la bibliothèque de son père : dictionnaires et grammaires de breton, histoires de Bretagne, livres qui expriment si bien le « génie celtique », comme le Barzaz Breiz, l’Iliade de Bretagne, ceux d’Anatole le Braz, de Charles Le Goffic et de Roparz Hémon, puis ceux venus d’Irlande « notre seconde patrie » (Synge, Yeats, O’Flaherty), enfin les « grands Bretons », Lamennais, Chateaubriand, Renan…
Ensuite c’est « l’école de la France », en l’occurrence l’école laïque de Plouha où elle est élève, celle de « l’égalité sur les bancs », mais où le classement récompense « nos seuls mérites et notre seul travail », celle aussi hélas « où l’on oublie d’où on vient », qui est indifférente, sinon hostile aux singularités bretonnes. Ce reproche n’empêche cependant pas l’auteur de L’École, l’Église et la République d’exprimer une vibrante défense et illustration des instituteurs de l’école de la République qui s’efforçaient de faire connaître « les coutumes et les savoirs locaux », en se faisant « ethnologues des terroirs, [en] recueillant les chansons, les proverbes, les mille et une façons de vivre et de mourir… ».
Il y a enfin « l’école de l’Église », celle de sa grand-mère qui décide de lui apprendre « ses » prières le jour de ses cinq ans, puis celle du catéchisme où elle découvre l’existence des enfants de l’école religieuse du village qui représente pour elle « le lieu de l’inégalité ». A l’église, un prêtre lui enseigne, en pratiquant une « pédagogie de la peur », une religion formaliste, froide et roide, « sans rien ou presque qui donnât à rêver ».
De fait, la jeune Bretonne devait vivre « trois lots de croyance : la foi chrétienne de [ses] ancêtres, la foi bretonne de la maison, la foi de l’école dans la raison républicaine », croyances qui composaient sa « tradition » et qui souvent s’ignoraient. « L’école, au nom de l’universel, ignorait et en un sens humiliait la particularité. Et la maison, au nom des richesses du particulier, contestait l’universel de l’école ». Par ailleurs, les mots liberté et égalité n’avaient pas la même signification pour l’école et la maison. Pour l’école, c’était la liberté « par l’abstraction des différences », pour la maison c’était la liberté d’un groupe particulier (les Bretons). Quant à l’égalité, c’était à l’école celle de la ressemblance, tandis qu’à la maison c’était celle du droit à affirmer sa différence. Toutefois, bien qu’elles s'ignorassent la maison et l’école vivaient toutes deux « dans la religion, du mérite et croyaient à la possible correction des inégalités ».
Après l’école primaire viennent les années de collège où peu à peu la spécificité bretonne s’éloigne et où « l’idéologie de l’école républicaine » prend le pas sur celle de la maison. Elève du collège Ernest Renan de Saint-Brieuc à partir de 1941, elle a comme professeur la femme de Louis Guilloux, l’auteur du Sang noir, qu’elle rencontre et qui devient pour elle un « indicateur de lectures ». Dans cet établissement « national », elle continue d’exprimer son « allégeance » à « la matière de Bretagne » ce qui lui vaut, à treize ans, d’être accusée par la directrice d’avoir constitué un réseau Sinn Fein au collège !
Les années suivantes au lycée représentent le temps du « ralliement à l’universel ». Après une hypokhâgne à Rennes, elle rompt les amarres avec la Bretagne et la « fidélité celtique » pour le Paris de la khâgne, de la Sorbonne, de l’École normale supérieure, et du Parti communiste auquel elle adhère en 1952 après la manifestation du 23 mai contre le général Ridgway. Adhésion qu’elle justifie d’une part par la fidélité à son père qui savait gré à « la patrie soviétique » de pratiquer, croyait-il, une « généreuse politique des minorités », et d’autre part par la sécurité intellectuelle et affective que le PC était censé apporter à des jeunes gens épris de justice et avides de solidarité. Mais la brillante normalienne devait vite déchanter : fin 1952, c’était à Prague la condamnation à mort de Slansky, début 1953 le « complot des blouses blanches », la mort du « Grand Staline » (L’Humanité du 18 mars), en juin, les émeutes ouvrières de Berlin-Est ..., autant d’événements qui lui ouvrent les yeux sur la réalité du « socialisme scientifique ». Elle quittera le Parti après la répression de l’insurrection hongroise de 1956.
Au-delà des vicissitudes de l’engagement politique, les années d’étudiante qui la mèneront à l’agrégation de philosophie s’achèvent sur le constat que « la foi de l’école semblait l’avoir emporté décisivement sur celle de la maison, l’idéologie française sur les attaches bretonnes ». Cette victoire de « l’universalité française » sur « la particularité bretonne » va conduire la jeune agrégée à entreprendre des recherches sur l’école républicaine, « temple neuf d’une humanité affranchie de Dieu, le lieu où on professe la perfectibilité indéfinie et la prise de l’homme sur son destin », puis à s’attaquer, seule ou avec François Furet, au monument de la Révolution française. A ce moment du récit, le livre bascule dans une dernière partie plus théorique, consacrée à la « composition française », c'est-à-dire à la « tension entre l’universel et le particulier ». A travers l’évocation de l’Ancien Régime où l’unité du roi permettait à la diversité du pays de se manifester, puis de la Révolution qui visait à la résorption de la diversité dans l’unité, enfin de la Troisième République qui proclamait avec Jules Ferry qu’il faut « refaire à la France une âme nationale », Mona Ozouf illustre les deux conceptions antithétiques de l’appartenance collective des Français : celle de Julien Benda, « la France est la revanche de l’abstrait sur le concret », et celle d’Albert Thibaudet, « La France est un vieux pays différencié ». Cette tension toutefois s’est relâchée avec l’assouplissement du modèle jacobin et le fait que la République s’est enracinée en prenant appui sur les singularités locales, comme le montre le Tableau de la géographie de la France de Vidal de la Blache dans lequel la diversité française n’est pas une menace, mais une chance. « Cette articulation heureuse du local et du national sous le signe de l’harmonie [se] retrouve dans l’enseignement dispensé par l’école républicaine ». Une exception cependant à ce tableau apaisé : le sort réservé aux langues régionales (que l’abbé Grégoire dénonçait comme « le fédéralisme des idiomes »), pourchassées sous la IIIe République et aujourd’hui encore contestées. A preuve le refus par le Conseil constitutionnel en 1999 de ratifier la signature de la Charte européenne des langues régionales, et la levée de boucliers, notamment au Sénat et à l’Académie française, suscitée par l’inscription dans l’article 1er de la Constitution de la formule « Les langues régionales font partie du patrimoine national ». Commentaire de Mona Ozouf : « La République n’a pu se défaire de son surmoi jacobin ». De fait, un certain intégrisme républicain, qui n’a plus l’Église comme adversaire principal, brandit désormais l’épouvantail du communautarisme « chaque fois qu’un individu fait référence à son identité ». Il faut en finir, dit-elle encore, avec « l’opposition binaire simpliste » entre universalistes et communautaristes et accepter de vivre, « tant bien que mal entre une universalité idéale et des particularités réelles ».
Qu’on les nomme appartenance, identité, enracinement (dans lequel Simone Weil voyait « le besoin le plus important de l’âme humaine »), ces spécificités sont dénigrées par tous les « pourfendeurs du communautarisme » qui ne voient en elles que « petitesse, étroitesse, enfermement ». A tous ceux pour qui « toutes les attaches sont des chaînes », donc des déterminations, Mona Ozouf répond, et ses propos revêtent une dimension particulière dans le contexte du débat actuel sur « l’identité nationale », qu’on ne saurait vivre sans déterminations, car « nous naissons au milieu d’elles, d’emblée héritiers d’une nation, d’une région, d’une famille, d’une race, d’une langue, d’une culture ».
Au « grand clapot tiède de l’indifférenciation » qui caractérise la vie démocratique de la France, l’auteur de La fête révolutionnaire oppose « la résistance des hommes à la rêverie de l’homogène » telle qu’elle s’exprime en Bretagne, ce « miraculeux conservatoire des origines celtes de la nation ».
Composition française est un livre passionnant, courageux et lucide, d’une telle richesse que l’on voudrait en citer des passages entiers, tant ceux où Mona Ozouf se souvient et se raconte que ceux où elle relit l’Histoire et réfléchit sur des questions essentielles pour la France. Ajoutons que la profondeur de la pensée s’accompagne d’une grande qualité d’écriture, comme en témoignent ces lignes sur sa Bretagne natale dont elle évoque joliment, après le Michelet du Tableau de la France ; « [la] « neige d’été du sarrasin dans les champs, [le} vent d’ouest autour des tombes, [les] pierres dressées sur la lande comme une noce pétrifiée ».
Fabrice Valclérieux (Eléments n°134, janvier-mars 2010)
-
Pour « Rébellion », le socialisme est toujours une idée neuve
Publié en mai 2009 aux éditions Aléxipharmaque, Rébellion, l'Alternative Socialiste Révolutionnaire Européenne, rassemble sous la signature de Louis Alexandre et de Jean Galié un ensemble de textes parus dans la revue Rébellion depuis 2003. "A l’Etat capitaliste, Rébellion oppose la Nation des travailleurs, à l’européisme technocratique la fédération européenne des peuples socialistes, au projet mondialiste le monde multipolaire débarrassé de l’impérialisme". Le livre est précédé d'une longue préface d'Alain de Benoist. Nous reprenons ici la chronique qu'a fait de ce livre Pierre le Vigan dans la revue Eléments (n°132, juillet-septembre 2009).

Pour « Rébellion», le socialisme est toujours une idée neuve
Rébellion. C’est le nom d’un groupe et d’une revue. C’est maintenant un livre, présenté par Louis Alexandre et Jean Galié. Qui sont-
ils : de jeunes gens qui réfléchissent au- delà des clivages partisans, qui refusent de se laisser enfermer dans les catégories de gauche et de droite instrumentalisées par l’hyperclasse mondialiste pour que rien ne change vraiment. Que veulent- ils : lutter contre le despotisme du capital, sortir de l’aliénation capitaliste et salariale. Sortir d’un monde à la fois monoforme et unipolaire. Ecrire pour cela ? Précisément, face au capital, il est subversif de continuer à penser et à écrire, même si on ne saurait se limiter à cela : il faut passer d’une critique théorique à une pratique critique. « Tout progrès vient de la pensée et il faut donner d'abord aux travailleurs le temps et la force de penser » disait Jean Jaurès en octobre 1889. Penser reste le premier acte d’émancipation sociale : c’est d’ailleurs pour cela que la pensée même est criminalisée de plus en plus souvent. La revue Rébellion du groupe éponyme a publié des entretiens avec des intellectuels comme Georges Corm, Alain Soral, Claude Karnoouh, André Bellon ou encore Alain de Benoist. C’est ce dernier qui a préfacé, en fin analyste des catégories politiques et des mouvements d’idées, le livre Rébellion, sans cacher sa sympathie pour la perspective socialiste révolutionnaire de cette jeune équipe. L’idéal du groupe Rébellion est celui d’une communauté militante, ce qui évoque à la fois Ernst Jünger dans les années 20 et le bolchévisme. Qu’est-
ce que le socialisme pour Rébellion ? On pourrait répondre que c’est l’esprit de révolte. C’est cela mais pas seulement. C’est un régime où la satisfaction des besoins prime sur la recherche du profit. Pour être classique, cette définition reste sans doute indépassable, sachant bien sûr que les besoins ne sont pas seulement matériels mais relèvent de la nature de l’homme : besoin de liens, besoin de chaleur, de reconnaissance, etc. L’homme n’a pas seulement besoin de pain et d’un toit. Les auteurs ont compris l’importance de se situer dans une continuité historique du socialisme, et d’identifier certaines figures majeures et fondatrices. Parmi celles-
ci se situe Pierre- Joseph Proudhon, mutualiste et fédéraliste, et Marx bien sûr, dont la critique de Proudhon a d’ailleurs été plus nuancée qu’on ne le dit en général. Il y a aussi des événements emblématiques. C’est le cas de la Commune de Paris, avec Eugène Varlin, Louise Michel, Benoit Malon, Edouard Vaillant ou encore l’officier Louis Rossel. Les auteurs soulignent à juste titre que tout un courant socialiste, avec Bakounine, mais avec Marx lui-
même, a défendu le principe de l’autonomie ouvrière et populaire qui était celui de la Commune de Paris comme une pratique révolutionnaire profondément nécessaire. Elle n’était au demeurant pas spécifique à Paris puisqu’il y eut des ébauches de Communes à Lyon, Marseille, Limoges, Toulouse, Narbonne, le Creusot, … La Commune est pour Marx une première ébauche de dépassement de l’Etat comme structure parasite de la société, au service de la domination bourgeoise. Pour Rébellion, le socialisme est aussi une figure morale. C’est pourquoi un portrait est consacré à la belle figure panthéiste, libre et socialiste de Jack London, ou encore à l’irlandais James Connolly, indissociablement socialiste et combattant d’un nationalisme de libération. Les portraits les plus inattendus sont sans doute ceux de Heinrich Laufenberg et de Fritz Wolffheim. Ce sont des socialistes révolutionnaires ou encore des nationaux communistes bien plus que des « nationaux bolchéviks ». Bolchevik, un mot qui signifie « majorité », n’a de sens précis que pour désigner une fraction, d’ailleurs minoritaire, qui était celle de Lénine, du Parti Ouvrier Social Démocrate de Russie avant 1914 (social démocrate ne voulait alors pas du tout dire « socialiste réformiste »).
Dés 1917, Heinrich Laufenberg et Fritz Wolffheim défendent l’idée des conseils ouvriers. Ce doit être pour eux la source nouvelle du pouvoir exécutif. Hostiles à la guerre et à l’Union sacrée, qui se met en place en Allemagne comme en France, ils ne désertent toutefois pas. Ils développent avec les socialistes de Hambourg les thèses d’une « révolution par le bas », décentralisatrice, à l’opposé du léninisme bolchevik. Ils appellent à l’unité des classes laborieuses à l’exception de la grande bourgeoisie et appellent à l’appropriation de l’idée nationale par les travailleurs dans le cadre de la construction d’une « Nation socialiste ».
Un temps membre du parti communiste allemand (KPD), H. Laufenberg et F. Wolffheim en sont exclus et créent le parti communiste ouvrier allemand (KAPD) où se retrouvent notamment Otto Rühle et Paul Mattick, ce dernier étant une autre figure inspiratrice du groupe Rébellion. Le KPD reprendra l’orientation très « nationale » du KAPD mais bien entendu pas du tout la critique du « capitalisme bureaucratique d’Etat » qui tint lieu de socialisme en URSS.
Une autre figure majeure pour nos auteurs est Georg Orwell, engagé pendant la Guerre d’Espagne dans le POUM, Parti ouvrier d’unification marxiste, liquidé par les communistes staliniens. Orwell dénonça ensuite tous les totalitarismes, y compris celui des sociétés dites « libérales », le totalitarisme de l’homme machinal. Orwell disait que le socialisme, c’est de se demander : « Qu’est-
ce qui rend l’homme plus humain ? », ce qui suppose d’avoir une idée juste de l’homme et de ne le réduire ni à un producteur ni à un consommateur. Les auteurs s’attachent aussi aux figures de Hans et Sophie Scholl, et Christoph Probst, de la Rose Blanche, résistants au nazisme et patriotes allemands qui furent guillotinés en 1943. Les parties philosophiques et théoriques du livre ne sont pas moins riches. Outre une belle synthèse de la philosophie politique, qui prend parti pour Althusius contre Jean Bodin, en une opposition frontale qui gagnerait à être nuancée, le portrait philosophique de Lucian Blaga permet de découvrir un auteur roumain peu connu. Pour L. Blaga, c’est la compréhension des horizons éthiques et esthétiques qui transforme la vie en destin. Critique du racialisme biologique, Lucian Blaga développe l’idée d’une « matrice stylistique » qui donne vie et sens aux individus et aux peuples. Ainsi l’homme n’est pas « citoyen du monde » -
qu’il ne le soit pas ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas d’enjeux planétaires - mais l’homme est au contraire inscrit dans un paysage, d’où l’importance du thème du village chez L. Blaga, thème évidemment un peu daté. L’article « Orientations nationales-
bolchéviques » a l’inconvénient de reprendre un terme ambigu, très marqué par la fascination pour les méthodes léninistes dont il est prouvé qu’elles ont servi d’exemple à Hitler lui- même (Ernst Nolte). Mais c’est bien sûr à Ernst Niekisch qu’il est fait référence, avec le lien entre conscience de classe et libération nationale. E. Niekisch tenta d’influencer le SPD de l’intérieur vers le nationalisme après la défaite allemande de 1918, puis fonda ses propres groupes « nationaux bolchéviques » notamment en lien avec Karl- Otto Paetel. Il fut constamment hostile au régime hitlérien. Compte tenu de l’absence en France de quelque chose comme le « national bolchévisme », il est heureux que les équipes de Rébéllion se définissent non comme « nationaux bolchéviques » mais comme « communistes nationaux » (p. 174 et 175). Ce communisme national postule l’analyse de classe et la lutte de classe, c’est pourquoi il se distingue des nationaux-
socialistes de gauche antihitlériens du type le Front Noir d’Otto Strasser et des divers « fascistes de gauche ». La nation est, pour le groupe Rébellion, un point d’appui pour la défense des intérêts des travailleurs et pour la construction d’une Patrie socialiste. Presque un siècle après la Commune de Paris, Mai 68 n’a certes pas été sanglant mais son importance est considérable. Les auteurs notent l’ambivalence du phénomène : d’un coté il y a le déploiement et la victoire de l’hédonisme et de l’idéologie libérale-
libertaire, bien analysée par Michel Clouscard (et ensuite par Alain Soral), d’un autre coté il y a une tentative d’instaurer une autonomie ouvrière qui est le meilleur du socialisme même si ce n’est pas tout le socialisme. Ce dernier aspect est la constitution des travailleurs comme sujet historique au- delà de l’identification à un parti politique, le PCF. C’est « l’insurrection de l’être » (Francis Cousin) face à la Forme- Capital. L’article sur les syndicats appelle une remarque : la constitution de SUD n’est pas un échec par rapport à l’apparition de nouveaux rapports de force dans le paysage syndical, et SUD ne peut être mis sur le même plan que les embryons de syndicats FN qui n’ont jamais été une tentative sérieuse pour une raison simple : si pendant 10 ans le FN a été le premier parti ouvrier en terme de vote de cette catégorie sociale pour lui, il n’a jamais cherché à donner une place aux ouvriers ni dans ses instances dirigeantes ni dans son programme (a-
t- il jamais proposé des interventions ouvrières dans la gestion des entreprises ?). C’est à juste titre, par contre, que Rébellion défend la place du politique. Les Conseils ouvriers ne peuvent exister durablement que dans le cadre d’une République sociale, et non d’une république bourgeoise. De même notent-
ils à propos que la « société de l’indifférence » (Alain- Gérard Slama) laisse le champ libre à la fois au tribalisme et au totalitarisme technicien des sociétés hypermodernes de contrôle total. L’indifférence alimente la transparence qui permet le contrôle total. « L’opéra mythologique mondialiste des grandes machineries financières et terroristes ne va pas cesser de tenter d’intensifier le contrôle technique et policier de la planète à mesure qu’il va perdre de plus en plus la capacité de se contrôler lui- même. » écrit de son coté Gustave Lefrançais. Mais il y a bien sûr des soulèvements qui laissent penser que l’indifférence a peut être atteint ses limites. Quand les auteurs s’interrogent sur la ville, c’est avec une même justesse. L’hypermodernité produit la ségrégation dans la ville et la segmentation de la ville, la paix sociale est achetée par l’argent public, des zones de non droit, de délinquance, de ghettos, de chômage, de laideur et d’isolement sont délibérement sacrifiées. Les auteurs proposent un urbanisme inspiré de Michel Ragon et de Michel de Sablet (mais ne semblent pas avoir lu Le Vigan !), avec un désengorgement des grandes villes.
L’approche de l’écologie est complémentaire. Elle ne nie pas la nécessité d’un développement social, tout différent du productivisme économique. Les auteurs opposent à un courant de l’ « écologie profonde » anti-
humaine, une écologie sociale inspirée de Murray Bookchin, un communiste libertaire américain, et de Pierre Kropotkine. Selon Rébellion, la décroissance est un antidote illusoire à la « course aveugle à la croissance » : ce n’est pas parce que les classes dirigeantes font croire que plus est toujours mieux qu’il est judicieux de théoriser que mieux, c’est toujours moins. Le développement durable, dit l’équipe de Rébellion, ne doit pas être abandonné à ses récupérateurs. Ouvrant une parenthèse personnelle, je soutiens que le développement durable poussé jusqu’au bout est un développement social de tout l’homme et de tout dans l’homme. Il revêt une dimension profondément transformatrice et révolutionnaire, tandis que la théorie de la décroissance court le risque d’être assimilée à une valorisation de la récession et de son cortège de souffrances sociales accrues. L’immigration est un sujet majeur qu’il fallait aborder. Du point de vue libéral, l’homme est une marchandise et même la première des marchandises. Or, le libéralisme veut la libre circulation des marchandises et donc des hommes. Il la veut à son profit. L’immigration participe de la chosification de l’homme tout comme de la destruction des nations et des identités. L’immigration dite « choisie » -
par le grand capital – vide les pays du tiers monde de leurs élites, et tend à accroître l’immigration de la misère et l’immigration de peuplement, notamment l’immigration clandestine souvent supérieure à 10 % de l’immigration légale. Ces transfusions de populations, cette allogénisation est masquée par le fait que les naturalisations massives par le droit du sol maintiennent le nombre apparent d’étrangers à un pourcentage à peu près stable malgré environ 200 000 entrées légales en France par an. Les auteurs remarquent justement que le regroupement familial de 1975 a été voulu, alors que les travailleurs immigrés s’engageaient de plus en plus dans les luttes sociales, comme le moyen de les « stabiliser » et de freiner leurs ardeurs combatives en leur donnant une famille à faire vivre. Bien entendu, le chômage de masse a changé la donne très vite. Il n’en reste pas moins, à mon avis, que l’immigration continue de peser à la baisse sur les salaires, mais aussi de diviser la classe ouvrière, en opposant les « petits blancs » qui se lèvent tôt, aux assistés, soit par manque de qualifications, ou de motivation, ou décalage culturel. De fait, les immigrés ayant perdu leurs repères culturels d’origine sans en avoir acquis de nouveau, sont sans tradition de lutte sociale à l’européenne.
Immigrés non assimilés et Français déracinés dans des quartiers qui perdent leur francité, qui subissent un néo-
tribalisme violent et une libanisation- ghettoisation de notre société tendent tous deux à devenir de véritables machines à consommer et/ou à déprimer (ce n’est pas incompatible, bien au contraire), zombies d’une société machinale qui a très exactement besoin de ce type humain (français ou immigrés) qui ne pensera jamais et ne pourra jamais « faire la révolution ». Mais justement, quel cadre adopter pour cette révolution sociale ? Si le groupe Rébellion est pour l’unité politique de l’Europe, c’est parce que la France seule est impuissante et parce que le régionalisme n’a pas d’avenir s’il est un séparatisme. L’Europe fédérale du peuple et du travail est la nouvelle patrie de Rébellion. C’est Jean Jaurès, qui n’était pas précisément un socialiste révolutionnaire, qui disait : « Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques » (1903). C’est un précepte plus actuel que jamais
Pierre le Vigan (article publié dans la revue Eléments, n°138, juillet-septembre 2009)
-
Porteurs d'âmes
Porteurs d'âmes, le roman de Pierre Bordage, publié initialement en 2007, est récemment ressorti dans la collection Livre de poche. Nous publions ici la recension qu'en avait fait Arnaud Bordes dans la revue Eléments.
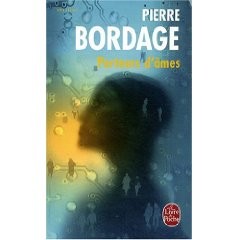 Quand les âmes migreront... jusqu'à l'«hyper-classe»
Quand les âmes migreront... jusqu'à l'«hyper-classe»Explorant avec une égale réussite les domaines variés de la science-fiction façon space opera (Les guerriers du silence), du merveilleux (Les fables de l'Humpur), de la politique-fiction avec la trilogie des Prophéties, ou encore le roman historique à connotations magistes et conspirationnistes avec L'enjomineur, Pierre Bordage se signale par l'ampleur de son imaginaire, à la fois humaniste, violent, sordide et sexuel, par l'envoûtement du suspense et des exigences de style, et d'écriture, qui souvent font cruellement défaut à la littérature dite de genre.
Avec Porteurs d'âmes, il s'inscrit dans la veine du thriller un rien anticipatif, celui, semble-t-il, d'un très proche avenir, évoqué et à peine suggéré par touches fines et subtiles impressions, dont la noirceur n'est pas sans rappeler peut-être les sombres prospectives faîtes par des auteurs tels que Jérôme Leroy ou J.G. Ballard, où la décomposition sociale va s'accroissant, où le cynisme est loi, où le fantasme sécuritaire, dressant murs et interdictions, contient clandestins et invasions, et sépare inclus et exclus, démunis et nantis. Une machine a été inventée: elle permet la translation des âmes .
Et cette migration des âmes, si elle a quelques liens avec l'hypothèse fameuse de la near death expérience (expérience de la mort prochaine), n'est pas pour autant un désir de transcendance ou de spiritualité, ou une foi en l'au-delà, et moins encore une tentative de réguler le délitement du lien social en proposant un autre mode de connaissance d'autrui. Implacablement, elle sert et favorise la domination d'une société secrète, Les Titans.
Celle-ci, qui réunit gens du pouvoir politique, médiatique et économique, n'est jamais que la métaphore, filée à l'extrême, des think-tanks et autres clubs de cette hyper-classe qui, émergeant en ce monde ultra-libéral, apprécient certes la démocratie, mais sans le peuple.
À quoi s'ajoute, sur le mode des récits croisés (comme presque toujours chez Bordage), l'enquête policière d'un inspecteur fatigué, dépressif, bien sûr divorcé, «fajardien » pourrait-on dire, qui exhumera un charnier sur les bords de la Marne (on appréciera l'esthétique de la décomposition en milieu fluvial; avec pluie, boue, vent, rives désertes, cadavres gonflés et mous...), puis découvrira la piste d'une bande de tueurs pratiquant avec une méthodique délectation la torture et l'exécution. Des bourreaux qui participent d'une moderne barbouzerie, et illustreront plus en avant dans le récit la notion d'alliés objectifs: c'est-à-dire du principe selon lequel, pour se maintenir et se justifier, et cela lui fût-il apparemment contraire, le Système doit toujours veiller à maintenir la présence d'une certaine qualité de désordre et de chaos.
On notera enfin, et là réside peut-être le sens véritable du titre et des migrations d'âmes, l'histoire d'amour sans mièvrerie ni lourdeur qui se dessine tout au long du récit.
Arnaud Bordes (revue Eléments, n°125, été 2007)
-
Un nouveau siècle de feu et de sang...
Nous publions ici une recension, parue dans la revue Eléments sous la plume d'Alain de Benoist, du livre de Colin S. Gray, La guerre au XXIe siècle - un nouveau siècle de feu et de sang, publié aux éditions Economica.
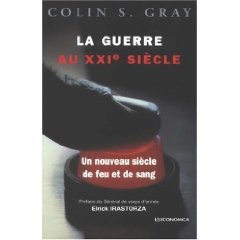
« Il ne s'agit pas de proclamer qu'on aime la paix, disait Montherlant. Il s'agit d'être assez fort pour imposer la paix à ceux qui veulent la guerre». Grand spécialiste des questions stratégiques, l'Anglo-Américain Colin S. Gray appartient à l'école « réaliste», qui croit que la guerre est consubstantielle à la nature humaine et qu'en dépit du changement constant de la plupart des contextes conflictuels l'essentiel dans la guerre et dans la façon de la mener ne varie pas du tout. C'est ce qu'il démontre dans cette étude prospective, véritable panorama des nouvelles frontières ouvertes par l'expansion de la géographie du combat, notamment dans ses dimensions désormais extra-atmosphériques (guerre dans l'espace, guerre dans le cyberespace). Conscient que la guerre irrégulière entre États et adversaires non étatiques a de bonnes chances de constituer la forme dominante de la belligérance dans les années à venir, il n'en estime pas moins que la guerre entre États et entre grandes puissances est toujours bien vivante. Distinguant entre la nature immuable de la guerre et son caractère fortement variable, il se sépare de nombre de ses confrères (notamment le major général J.F.C. Fuller) en affirmant, d'abord que la guerre « est par-dessus tout un comportement politique», et donc une affaire de pouvoir, ensuite que « l'histoire de la guerre n'est pas synonyme d'histoire des techniques». Il écrit enfin que « la prochaine manche du cycle historique stratégique de l'antagonisme des grandes puissances est déjà en train de prendre forme», un axe sino-russe étant en cours d'émergence, « ce qui pose un formidable défi à la notion américaine d'un ordre mondial unipolaire». Une somme remarquablement informée.
Alain de Benoist (recension publié dans la revue Eléments, n°128, printemps 2008)
-
Des animaux et des hommes
L'éditorial de Robert de Herte (alias Alain de Benoist) dans le numéro 134 de la revue Eléments, disponible en kiosque ou ici :
 Des animaux et des hommes
Des animaux et des hommesLa pensée antique, avec Thalès, Anaximandre, Héraclite, Xénophane et bien d'autres, était fondamentalement moniste. Du constat des oppositions, elle ne concluait pas au dualisme, mais à la conciliation des contraires. Dans l'Antiquité, on ne confond pas les dieux avec les hommes, les hommes avec les animaux, les animaux avec les végétaux, les végétaux avec la matière inanimée, mais on leur attribue des niveaux différents dans un procès continu de perception. Pour les Anciens, tout être vivant, homme ou animal, porte en lui un principe de vie et de mouvement, que les Grecs appellent psyche, terme que l'on traduit généralement par « âme». (On notera que le latin anima, « âme », est aussi à l'origine du mot « animal » ) .
Pour Aristote, l'homme est le seul animal doué de logos, le seul animal « rationnel ». On notera toutefois qu'Aristote ne dit pas que l'homme est le seul être raisonnable, mais qu'il est le seul « animal raisonnable », formule qui montre bien ce qui apparente l'homme à l'animal, et le différencie en même temps. Pour Aristote, l'âme de l'homme diffère de celle des animaux en ce sens que l'homme peut accéder à la pensée conceptuelle et dégager des notions générales à partir de ses perceptions singulières, mais cette différence, tout en étant décisive, est aussi relative: il n'y a pas de rupture nette entre le monde animal et celui des hommes, mais une échelle continue allant de l'inanimé jusqu'aux dieux. En d'autres termes, Aristote reconnaît l'unité du monde, tout en y introduisant une hiérarchie.
La tradition stoïcienne, de Chrysippe à Sénèque, sera la première à tracer une frontière plus nette entre l'homme et les animaux. Dans le stoïcisme, seul l'homme est capable d'agir en fonction de sa seule raison, tandis que l'animal est toujours contraint par la « nécessité naturelle ». Mais l'animal n'en continue pas moins d'avoir une âme, ce qui explique qu'il soit capable de perceptions, de sensations, de souffrances et de plaisirs. Un tournant radical est en revanche pris avec le christianisme, qui affirme pour la première fois que les animaux n'ont pas d'âme: quoique mortel comme les autres vivants, l'homme est seul à en posséder une. Cette âme ne tient pas à sa nature, mais résulte de la grâce de Dieu. Elle est en outre individuelle (il n'y a pas d'âme collective), et enfin elle est immortelle. Dans le christianisme, cette triple particularité est liée à l'affirmation de l'unité de l'espèce humaine. Il y a en effet un lien très fort entre l'unicité de Dieu, l'unité de la famille humaine et la mise à l'écart ,ou le rabaissement des animaux.
Dans cette perspective, l'animal est fondamentalement perçu comme un homme inachevé, un vivant imparfait, une « structure privative ». À la vue de l'immense fossé qui le sépare désormais du reste du vivant, l'homme va donc s'excepter du discours sur les animaux et désolidariser sa nature de la leur. Les conséquences de cette rupture seront immenses. C'est la philosophie cartésienne qui en donnera la formulation la plus décisive.
Non seulement Descartes condamne définitivement l'idée que les animaux puissent avoir une âme, mais il va jusqu'à ruiner la thèse qui accorde au vivant une prédominance sur l'inanimé. Pour Descartes, l'âme n'a plus de fonction vitale: son seul attribut est la pensée. « Je pense, donc je suis », cela signifie que l'être premier de l'homme réside dans la pensée, non dans la vie. Entre l'âme et le corps de l'homme, il n'y donc plus aucun rapport naturel: l'âme est purement spirituelle, tandis que le corps est purement matériel. Double dualisme: l'homme est coupé en deux (d'un côté son corps, de l'autre son âme et son esprit) et. d'autre part, il est plus que jamais séparé de façon radicale des animaux. Parallèlement, Descartes assimile le vivant à une machine. L'animal n'ayant pas d'âme, n'est qu'une machine insensible. Descartes explique que l'animal ne peut penser et en tire la conclusion qu'il ne percevoir, ni ressentir de la souffrance ou de la joie. Les cris que pousse un chien battu reçoivent une explication purement mécanique : les coups de bâton provoquent un ébranlement nerveux qui entraîne le remplissage des poumons, et l'expiration de l'air fait vibrer les cordes vocales. Telle est la théorie cartésienne des « animaux-machines ».
Elle soulève évidemment d'insurmontables problèmes. Si l'âme et le corps n'ont chez l'homme aucun rapport naturel, comment peuvent-ils cohabiter? Le dualisme cartésien n'en va pas moins se propager, de façon durable, dans toute une série de domaines: coupure entre le corps et l'âme, l'homme et la nature, l'esprit et la matière, le plan spirituel et le plan matériel,la raison et l'émotion, la liberté et le déterminisme, l'inné et l'acquis, la nature et la culture, l'être et le devenir, l'instinct et la moralité, la nécessité et la liberté, etc. - chacune de ces notions ne définissant plus les différents aspects d'un même champ conceptuel, mais se présentant comme des pôles dont l'affirmation de l'un entraîne automatiquement la dévalorisation ou la négation de l'autre.
Descartes a eu une triple postérité. D'abord ceux qui retiennent la thèse de 1'« animal-machine », mais rejettent l'idée d'une coupure entre l'homme et l'animal. Ensuite ceux qui retiennent l'idée que les animaux n'ont pas d'âme, mais affirment que l'homme n'en a pas non plus et rejettent par ailleurs la thèse de 1'« animal machine » au profit de l'idée d'une unité du vivant. Enfin, ceux qui, au contraire, retiennent l'idée d'une coupure fondamentale entre l'homme et l'animal, mais en donnent une autre interprétation que celle proposée par Descartes.
La première tendance est représentée par certains penseurs mécanistes du XVIIe et XVIIIe siècles, comme La Mettrie, qui s'efforcent de réduire le rôle de l'âme dans l'explication des phénomènes humains en soutenant que l'homme n'est lui-même qu'une «machine» au même titre que les animaux. La thèse a l'avantage de réintégrer l'homme dans l'ordre du vivant, mais d'un vivant qui n'a plus aucune des caractéristiques de la vie. La deuxième tendance est représentée par le courant biologiste qui, au travers des théories transformistes de Lamarck et de Darwin, fait de l'homme un animal évolué, replaçant ainsi pleinement l'homme dans l'ordre du vivant, mais dont nombre de représentants restent fondamentalement attachés à l'analytisme et au réductionnisme cartésiens. La troisième correspond aux kantiens, qui soutiennent que la spécificité de l'homme tient au fait qu'il échappe entièrement à toute détermination biologique «naturelle»: l'homme, selon eux, n'est devenu homme qu'en s'arrachant au règne animal, et affirme d'autant plus sa « dignité » d'être humain qu'il continue à s'écarter de la simple nature.
En 1755, dans son Traité des animaux, Condillac écrivait: «Il serait peu curieux de savoir ce que sont les bêtes, si ce n'était pas un moyen de savoir ce que nous sommes». Tout discours sur l'animal a en effet des retombées sur l'homme, qu'il s'agisse pour ce dernier de se concevoir lui-même comme un animal ou de se désolidariser des animaux. Mais ce n'est là qu'un aspect d'une problématique beaucoup plus vaste, dont les enjeux philosophiques, scientifiques, idéologiques et religieux sont considérables et qui, depuis bientôt deux millénaires, a suscité des controverses innombrables. Cette problématique est celle de la place qu'occupe l'homme dans la nature. Le débat reste ouvert. Il est immense.
Robert de Herte ( Eléments n°134, janvier-mars 2010)