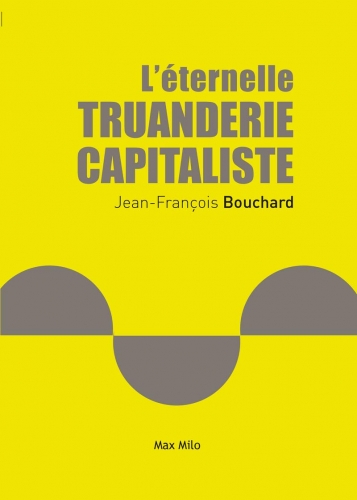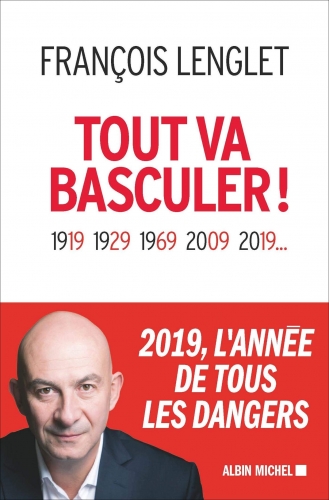Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Jacques Sapir, cueilli sur Figaro Vox et consacré à la guerre des prix du pétrole qui vient de se déclencher parallèlement à la crise du coronavirus et à la tempête boursière... Économiste hétérodoxe et figure de la gauche souverainiste, Jacques Sapir a publié de nombreux essais comme La fin de l'euro-libéralisme (Seuil, 2006), La démondialisation (Seuil, 2011) ou Souveraineté - Démocratie - Laïcité (Michalon, 2016).

Derrière le Coronavirus, la guerre du pétrole ?
Derrière l’épidémie du Coronavirus (COVID-19) se profile une nouvelle guerre sur les prix du pétrole. La chute de la production en Chine a eu des conséquences importantes sur les marchés des matières premières, et celui du pétrole en particulier. Mais, depuis le vendredi 6 mars, on assiste à l’éclatement de l’accord qui unissait l’OPEP, emmené par l’Arabie Saoudite, au groupe dit «non-OPEP» conduit par la Russie. Nous sommes donc entrés dans une autre logique.
L’échec de la réunion de Vienne
Une réunion se tenait à Vienne le vendredi 6 mars pour étudier les réponses à apporter à la baisse des prix engendrée par la chute de la demande chinoise et par le ralentissement de l’activité économique. Le ministre Russe de l’Énergie, Alexandre Novak, arrivé de Moscou vendredi matin déclara alors à ses collègues ministres qu’il était en faveur du maintien de la réduction de l’offre aux niveaux actuels jusqu’en juin, date à laquelle il conviendrait d’étudier des coupes plus profondes. Les ministres de l’OPEP, sous la direction du Ministre Saoudien avaient proposé jeudi à la Russie de réduire la production de pétrole de 1,5 million de barils supplémentaires par jour afin de compenser l’impact du coronavirus. Quelques heures plus tard, l’OPEP avait de nouveau fait pression sur Moscou, pour une réduction immédiate des volumes de production. La déclaration d’Alexandre Novak fut l’équivalent d’une fin de non-recevoir.
Malgré les efforts du secrétaire général de l’OPEP, Mohammad Barkindo, le marché pétrolier est entré dans une crise profonde. Le prix du pétrole brut, en conséquence, a chuté brutalement.
L’impasse à laquelle on est arrivé constitue la plus grande crise depuis que l’Arabie saoudite, la Russie et plus de 20 autres pays ont créé le groupe appelé «OPEP +» en 2016. Ce groupe, qui contrôle plus de la moitié de la production mondiale de pétrole et a remodelé la géopolitique du Moyen-Orient est aujourd’hui en crise. Le risque pour les Saoudiens est que si leur stratégie consiste à faire céder la Russie par une baisse de production, ils ont en fait plus à perdre que ce dernier pays car ils ont besoin des prix du pétrole bien plus élevés pour financer leur budget que la Russie.
La décision russe
Pendant trois ans, le président Vladimir Poutine a maintenu la Russie au sein de la coalition OPEP +. Cette alliance a été décisive pour permettre à la Russie de traverser la crise engendrée par la baisse brutale des prix du pétrole de 2015 mais elle a aussi apporté à la Russie des gains importants de politique étrangère. On peut se demander pourquoi la Russie, alors, veut y mettre fin.
Cette alliance, cependant, a également aidé - indirectement - l’industrie du schiste américain. Or, la Russie est en pleine confrontation avec les États-Unis. La volonté de l’administration Trump d’utiliser l’énergie comme un outil politique et économique est mal vue par la Russie. La Maison-Blanche a ciblé les activités vénézuéliennes du producteur de pétrole russe Rosneft. Le gouvernement russe a, certes, trouvé une solution de substitution. Mais, cet épisode a cristallisé un conflit avec les États-Unis.
La décision de la Russie de sacrifier l’accord serait donc la réponse à cette politique américaine. Il faut aussi ajouter que l’accord dit OPEP + n’a jamais été très populaire auprès de nombreux acteurs de l’industrie pétrolière russe. Le Kremlin a également été déçu par son alliance avec Riyad. La stabilité de Mohammed Ben Salman ne semble pas assurée si l’on en croit des observateurs moscovites. La décision de prendre le risque d’une guerre commerciale avec l’Arabie saoudite et de provoquer une baisse importante des prix du pétrole brut aurait donc été prise lors de la réunion entre Vladimir Poutine et les dirigeants de l’industrie pétrolière le samedi 29 février.
La stratégie russe
La Russie vise deux objectifs. Le premier est de mettre les producteurs américains en difficulté. On sait que les petites compagnies, qui produisent une partie du pétrole de schiste, ont besoin d’un prix du brut supérieur à 50, voire 60 dollars, pour pouvoir rembourser les emprunts qu’elles ont contractés envers les banques (et ces emprunts couvrent souvent 90% du capital de la société). Compte tenu des réserves accumulées, la Russie pourrait s’accommoder de prix de l’ordre de 30 $ pour une période assez longue. De tels prix mettraient les petites sociétés américaines, mais aussi les banques qui leur ont avancé l’argent, dans de grandes difficultés. Ces prix bas accentuent la tendance baissière de Wall Street car des prix du pétrole faibles signifient aussi une chute des dépenses d’exploration et d’exploitation du pétrole, et donc une moindre valorisation pour les entreprises qui fournissent le matériel et la technologie pour ce faire. D’ailleurs, l’EIA a annoncé le 11 mars que la production de pétrole des États-Unis baisserait en 2021, une première depuis 2016.
Mais, on ne peut exclure un autre objectif de la stratégie russe. L’Arabie saoudite, s’est lancée dès dimanche dans une politique très agressive de guerre des prix en réduisant massivement les prix de son brut. Le géant de l’énergie saoudien ARAMCO a ainsi offert des remises sans précédent de 6$ à 8$ en Asie, mais aussi en Europe et aux États-Unis dans l’espoir d’inciter les raffineurs à utiliser le brut saoudien. Car, le pétrole saoudien est ce que l’on appelle un pétrole «lourd» qui demande un raffinage bien plus complexe que le pétrole produit par la Russie. Ces remises ont été immédiatement imitées par les autres producteurs de la région comme le Koweït et les Émirats Arabes Unis.
Le pays a désespérément besoin d’argent. Le budget saoudien pourrait avoir un déficit de 100 milliards de dollars dans la situation actuelle, et la privatisation d’une partie de la société pétrolière ARAMCO dépend étroitement de prix élevés. En contraignant l’Arabie Saoudite à chercher des fonds par l’accroissement des volumes de production, les dirigeants russes escomptent que d’ici quelques semaines à quelques mois, la chute des prix du pétrole pourrait créer des problèmes insupportables pour Mohammed Ben Salman. D’ailleurs, ce dernier a fait arrêter il y a quelques jours trois membres de la famille royale saoudienne pour «haute trahison». La stabilité de son pouvoir, minée par les échecs au Yémen, dans les relations avec les pays du Golfe, mais aussi éprouvée par la timide libéralisation du régime saoudien, pourrait bien être fragile.
Alors qu’Erdogan a dû venir à résipiscence à Moscou le jeudi 5 mars et accepter un accord qui est en réalité favorable au gouvernement syrien et au gouvernement russe, l’idée d’affaiblir l’autre pôle du Moyen-Orient, l’Arabie saoudite, a pu traverser l’esprit du gouvernement russe.
Jacques Sapir (Figaro Vox, 12 mars 2020)