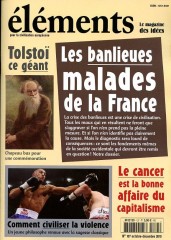
Elle peut être écoutée sur le site de Radio Courtoisie ou sur le blog de la radio.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
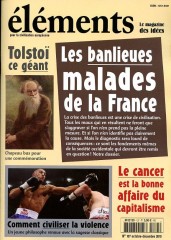
Elle peut être écoutée sur le site de Radio Courtoisie ou sur le blog de la radio.
Le nouveau numéro du Choc du mois, daté de novembre 2010, est disponible en kiosque. On pourra lire un premier dossier consacré au nouveau désordre mondial, comprenant des entretiens avec Hervé Juvin et Georges Corm. Un deuxième dossier est consacré à la cathophobie. Et on retrouvera comme toujours, les rubriques "Monde", "Société" et "Culture"...
Bonne lecture !
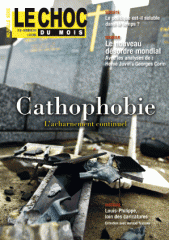
Au sommaire du numéro :
Le bloc-notes de François-Laurent Balssa
L’allahicisation
Succession au Front national
Dossier : Nouveau désordre mondial
L’inexorable dérive des continents
Vers un big bang géopolitique
Entretien avec Hervé Junin
De l’hyperpuissance à l’impuissance
La thèse du choc des civilisations
Entretien avec Georges Corm
Pays émergents versus pays submergés
Vers un nouveau Nomos de la terre ?
Société
Te rappel 2main si chui dispo
Comment les séries américaines colonisent les esprits
Je suis féministe, mais je me soigne
Le politique est-il soluble dans le temps ?
Dossier : Cathophobie
Interdit aux catholiques et aux animaux
Aux origines de la cathophobie
Pourquoi je suis (aujourd’hui) anticlérical ?
Quand les curés avaient des têtes de veaux
Pour trente deniers de plus
et un passage à la télévision
L’Eglise face aux droits de l’homme
Entretien avec Frigide Barjot
Culture
HISTOIRE
Entretien avec Arnaud Teyssier
Contre-courant
Délire logique anniversaire
Giono, le retour du Grand Pan essais
Z comme Zarka
La Grèce au cœur
Dictionnaire des injuriés
ENQUÊTE
Les ambassadeurs côté cour littérature
Houellebecq persiste et signe
BEAUX-ARTS
Face-à-face
BD
Exposition
Cinéma
Maurice Schérer est mort, vive Rohmer
Nous reproduisons ci-dessous un texte assez étonnant de l'économiste souverainiste Jacques Sapir, publié par le site de l'hebdomadaire Marianne, qui évoque le recours à la dictature pour rétablir une démocratie indépendante dans notre pays. Un signe parmi d'autre que la crise économique pourrait rapidement prendre un tournure politique dans les mois à venir, voire se transformer en crise de régime...

L'une des leçons les plus claires que l’on puisse tirer du mouvement social de ces dernières semaines est qu’il a bénéficié d’une très forte légitimité, chose qui va de pair avec le discrédit qui frappe une bonne partie des élites politiques. Le gouvernement et le président ont voulu opposer à cela la légitimité qu’ils tirent de l’élection. Le conflit de légitimité ne saurait pourtant exister que dans la tête de quelques-uns. Il relève en fait de l’ignorance dans laquelle se trouvent nombre de commentateurs.
L’élection ne garantit pas en effet la légitimité pour la totalité du mandat, ainsi que le prétendent tant les porte-paroles du gouvernement que ceux du président. Ceci revient à oublier, ou à ignorer, la différence qui existe entre le « Tyrannus absque titulo » et le « Tyrannus ab exertitio ».
Dans le premier cas, on appelle « Tyran », ou frappé d’illégitimité, celui qui arrive au pouvoir par des voies injustes. Ceci n’est pas le cas du pouvoir actuel et nul n’a contesté les élections tant présidentielles que législatives, ni leurs résultats. Mais, -et l’on voit ici que la légitimité ne se confond pas avec la légalité-, nous avons un second type de « Tyran », celui qui est « arrivé au pouvoir par des voies justes et qui commet des actes injustes ». Tel est le cas devant auquel nous sommes confrontés aujourd’hui.
De fait, et exprimés en termes modernes, ceci revient à dire qu’un candidat ne saurait à la veille de son élection tout prévoir et faire des promesses couvrant la totalité du champ des possibles. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le législateur a, fort justement, proscrit le mandat impératif. Quand le candidat désormais élu doit faire face à des éléments imprévus, ou doit prendre des décisions par rapport auxquelles il ne s’est engagé que de manière très vague, il doit nécessairement faire la preuve de nouveau de sa légitimité et ne saurait la tenir pour acquise du simple fait de son élection.
Or, nous avons typiquement sur la question des retraites un débat sur la « justice », qui renvoie aux principes mêmes de notre Constitution, tels qu’ils sont exprimés dans son préambule. Notons, d’ailleurs, que ce débat fut précédé par quelques autres, qui ne plaidaient pas franchement pour le gouvernement.
En cherchant à passer « en force », en refusant le débat sur le fond, le pouvoir a été contraint d’exercer des moyens qui, étant dès lors dépourvus de légitimité, sont devenus par eux-mêmes des facteurs de trouble et de désordre. Il se propose désormais de doubler la mise en jetant en chantier le projet d’un nouveau traité européen qui sera probablement appelé à être ratifié en contrebande par des majorités de circonstance.
La constitution de ce pouvoir en « Tyrannus ab exertitio » se révèle dans ses actes présents comme dans ses desseins futurs.
Ceci ne fait que révéler la crise de la Démocratie que nous vivons de manière particulièrement intense depuis 2005 et qui s’est révélée au grand jour par l’abstention phénoménale lors des élections européennes. Dans une telle situation, les trajectoires que peuvent décrire les mouvements sociaux dépassent, et de très loin, leurs objectifs immédiats. Certains ont remarqué la dimension « anti-Sarkozy » qu’avait revêtue le mouvement. Mais nul ne s’est interrogé sur son origine. Dans ce mouvement s’est exprimée très profondément l’illégitimité du pouvoir et le refus de cette illégitimité par le peuple.
La Tyrannie appelle alors la Dictature. Ce mot ne doit pas être ici entendu dans son sens vulgaire, qui en fait un synonyme du premier, mais bien dans son sens savant. La Dictature est en effet une partie intégrante de la Démocratie. Il s’agit de la fusion temporaire des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) dans le but de rétablir les principes de la Démocratie. C’est bien un pouvoir d’exception, mais dans le cadre des principes de l’ordre démocratique.
Il faut donc poser la question de savoir si, pour rétablir la Démocratie et par là la souveraineté du peuple, compte tenu des dérives que nous connaissons depuis certaines années, il ne nous faudra pas en passer par l’exercice de la Dictature. Cette dernière n’aurait alors pas d’autres buts que de rétablir dans son intégralité les principes de notre Constitution, tels qu’ils sont inscrits dans son préambule où l’on affirme le principe d’une République sociale. Quand j’ai évoqué, il y a quelques semaines, la possibilité de gouverner par l’article 16 pour mettre entre parenthèses certains des traités qui font obstacle à l’accomplissement des principes contenus dans le préambule de notre Constitution, je ne pensais pas à autre chose.
Il est certes possible que l’on puisse éviter encore d’y avoir recours, et que l’on puisse sauver notre démocratie si malade et si mal traitée. Mais, ce sera par la combinaison des formes actuelles avec une organisation permanente d’une partie de la population dans les Comités d’Action et de Résistance et par le recours, sur des questions précises et avec un libellé clair, au référendum.
Cependant, plus nous avançons et nous éloignons des principes de la Démocratie et plus la Dictature apparaîtra comme la seule issue qui nous reste possible. Tel est, aussi, l’enjeu de ces dix-huit mois qui nous séparent des échéances électorales de 2012.Jacques Sapir (Marianne, 4 novembre 2010)
Nous reproduisons ici un texte intéressant de la philosophe franco-italienne Michela Marzano, intitulé "Réinventer la société de confiance" et publié par le quotidien Le Monde le samedi 6 novembre 2010.

Réinventer la société de confiance
Voilà quinze ans, dans un livre consacré à la "société de confiance", Alain Peyrefitte, pourtant ancien ministre du général de Gaulle, nous vantait les mérites des modèles anglo-saxons, affirmant notamment qu'ils permettaient à chacun de se dépasser constamment dans des "entreprises risquées mais rationnelles".
Ces dernières années, les élites françaises ont cherché sans relâche à promouvoir ce modèle idéal de "confiance compétitive". Il fallait "être performant" et "ne jamais se soucier des autres". La confiance n'était plus synonyme que de "self estime". L'une des raisons du succès de Nicolas Sarkozy, en 2007, a été justement sa capacité à mobiliser les électeurs autour de l'idée de réussite personnelle.
Le fameux "travailler plus pour gagner plus". Pour quel résultat ? La crise a mis à jour les contradictions d'un tel discours. Elle a montré les limites d'un volontarisme à outrance. Les manifestations récentes contre la réforme des retraites ne sont pas, on le sait, une simple protestation contre un allongement de quelques années de cotisation mais aussi le symptôme d'une grande déception et d'un grand désarroi. Peut-on se limiter à croire, comme un Claude Bébéar, que les citoyens ne seraient descendus en masse dans la rue que parce qu'ils "dénigrent le travail, se disent fatigués et aspirent aux congés et à la retraite" (Le Monde du 1er novembre) ?
Une chose est sûre. La fatigue française est bien réelle. Mais elle n'est pas une propriété intrinsèque du "Français-paresseux-par-nature" comme voudraient le faire croire certaines élites, se berçant de telles niaiseries pour éviter de se remettre en cause. La fatigue actuelle est le résultat d'une longue suite de contes de fée et de mensonges auxquels les citoyens avaient fini par adhérer et dont ils découvrent depuis peu l'inanité.
Ce peuple qui, depuis 1789 et 1848, n'avait cessé d'opposer aux puissants du monde le rire moqueur de Gavroche, s'était progressivement laissé convaincre par les sirènes d'un certain management. Il avait accepté l'idée qu'il suffisait de croire "en soi-même" et de ne jamais compter sur les autres pour réussir sa vie. La société se partageait entre les "winners" et les "loosers", entre ceux qui croyaient n'avoir besoin de rien, ni de personne, et ceux qui avaient la faiblesse de croire aux autres.
La crise a eu le mérite de montrer qu'il ne suffit pas de "vouloir pour pouvoir" et que, sans coopération et solidarité, "notre monde peut être un enfer", comme le disait déjà Hannah Arendt. Tous les jours, dans les entreprises, ils sont des milliers à le vivre dans leur chair. Pas besoin d'aller chercher des exemples dramatiques chez France Télécom ou Renault.
EXEMPLARITÉ
Prenons ce salarié qui, à l'approche de la cinquantaine, et après s'être voué à son travail en essayant d'être toujours "flexible", se voit remercié car "trop coûteux". Ou ces seniors qui connaissent un véritable parcours du combattant, se traînant d'entretien en entretien, à la recherche d'un nouvel emploi. Qui dit que ces Français ne veulent pas travailler ? Qui croit qu'ils dénigrent le travail ? Ne voudraient-ils pas simplement une société plus juste ?
Globalisation et mutation technologique poussent certes au changement. Mais elles ne poussent pas nécessairement aux dérives oligarchiques et au cynisme triomphant. Une société plus juste est toujours possible. Elle est même la condition du retour de la confiance en l'avenir. Elle passe par le refus de cette fausse "société de confiance" vantée par l'idéologie néolibérale moribonde.
Il faut retrouver le chemin de la coopération et de la confiance mutuelle. Mais cette confiance-là ne se décrète pas. Pour qu'elle puisse surgir à nouveau dans ce pays et se développer, elle doit pouvoir s'appuyer sur des preuves tangibles. Pas de confiance sans fiabilité. Or, c'est là que le bât blesse. Tout ce qui manque à nos élites, aujourd'hui, c'est d'être fiable. On dira que ce propos est "populiste". L'accusation est commode. Jugeons sur actes. Les chefs d'entreprise, les politiques, les médias parlent d'exemplarité. Mais ce sont toujours, comme par hasard, les autres qui doivent être exemplaires. Pas ceux qui demandent des efforts. Pis. En France, un grand manager est désigné comme "courageux" lorsqu'il taille dans ses effectifs, tandis qu'il négocie âprement, et parfois en douce, ses stocks options et sa retraite chapeau.
Le pouvoir politique n'est pas en reste. Les ministres sarkozystes susurrent à l'oreille des Français la petite musique des "sacrifices nécessaires et partagés" pendant qu'ils redonnent à Mme Bettencourt et à ses semblables des millions d'euros au titre du bouclier fiscal. On pourrait multiplier à l'envi les preuves de ce double discours. Comment s'étonner que les Français doutent de la fiabilité de ceux en qui ils sont censés placer leur confiance ? C'est là que réside, en profondeur, le malaise du pays.
En a-t-il toujours été ainsi ? Les esprits cyniques tentent de s'en convaincre. Sans doute n'est-il pas aisé de demander à ceux qui nous gouvernent de ressembler aux vrais héros de l'Antiquité, toujours prêts à se sacrifier eux-mêmes avant de demander le sacrifice des autres. Mais il est des modèles plus réalistes. En 1940, les Anglais savaient bien qu'en leur proposant du "sang et des larmes", Churchill prendrait sa part de l'effort et qu'il n'irait pas se prélasser sur un yacht ou dans un paradis fiscal… A la même époque, les élites françaises de la "drôle de guerre" donnaient, elles, la triste image de pantins désabusés et insouciants, comme l'avait souligné Marc Bloch dans L'étrange défaite (Gallimard, 1990). En va-t-il si différemment aujourd'hui ?
Cette crise étrange, qui frappe l'économie réelle mais épargne les profits de la finance, empêche probablement les plus fortunés de bien en saisir les enjeux. Les élites de cette "drôle de crise" sont un peu comme les élites de la "drôle de guerre". Elles se trompent de diagnostic. Souhaitons qu'elles sortent vite de leurs illusions pour reconquérir la confiance des Français et croire en un avenir commun.
Michela Marzano, philosophe, professeur des universités à Paris-Descartes (Le Monde, 6 novembre 2010)
A l'heure où l'on commémore De Gaulle pour mieux trahir son oeuvre, nous reproduisons ici ce texte de Laurent Pinsolle, gaulliste libre, qui souligne toute l'actualité de la pensée gaulliste. Alors, comme l'écrivait Régis Debray : à demain De Gaulle !
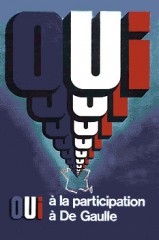
Le gaullisme, une boussole pour sortir de la crise
Demain, ce sera le 40ème anniversaire de la mort du plus grand homme de notre histoire ainsi que l’occasion de se pencher sur ce qu’il a pu faire pour la France et les Français. Mais plutôt que de conjuguer le gaullisme au passé, c’est au futur que son message prend encore plus de valeur.
Une crise de la globalisation néolibérale
Les crises récurrentes de l’économie mondiale depuis une quinzaine d’années ont deux raisons clairement identifiées : la globalisation et la déréglementation économique qui a abouti à une forme d’anarchie, commerciale, monétaire et financière. En effet, d’une part la libéralisation de la finance a conduit à une explosion du montant des transactions (aujourd’hui égales à 70 fois le PIB mondial), non pas du fait de l’épargne, mais d’un recours accru au crédit par l’effet de levier.
Cette augmentation de la demande d’actifs a provoqué une hausse de leur prix mécanique puisque l’offre n’a pas pu suivre la demande. Cette progression, indépendante de leur valeur réelle, provoque des bulles qui finissent par éclater quand leur valeur dévie trop de la réalité, comme lors du krach de la bulle Internet en 2001 ou celle de l’immobilier étasunien en 2008. Il est terrifiant de constater la proximité des deux bulles, qui illustre l’irrationalité congénitale des marchés.
Cette libéralisation touche également le commerce et là, le phénomène a été parfaitement analysé par Maurice Allais ou Jean-Luc Gréau. La mise en concurrence des salariés des pays dits développés avec ceux des pays en voie de développement, dans un monde où les entreprises peuvent investir comme bon leur semble, a provoqué une vague massive de délocalisations, rayant de la carte occidentale bon nombre d’industries (jouet, textile, électronique…).
Pire, cette concurrence déloyale pousse à la baisse les salaires des classes populaires et des classes moyennes dans les pays dits développés du fait du rattrapage de productivité. Non seulement la globalisation néolibérale casse la croissance des pays du Nord, mais en plus, elle transmet de plus en plus rapidement et de plus en plus violemment la moindre crise d’un pays à l’ensemble de la planète, comme on a pu le voir en 2001 ou en 2008.
La réponse gaulliste
A ce moment, on pourra se demander ce que peut bien faire le gaullisme dans cette analyse de la crise. Le Général de Gaulle a présidé pendant les Trente Glorieuses. En quoi son message pourrait bien nous guider dans ces temps nouveaux de la globalisation néolibérale ? La première objection est que les défenseurs du système actuel persistent à se référer à des penseurs d’il y a deux siècles comme Ricardo, qui vivait dans un monde largement plus différent du nôtre que celui des années 60.
Et puis, le Général a démontré pendant toute sa vie qu’il était capable de voir loin. En 1965, il affirmait que « le laissez-faire, le laissez-passer appliqué à l’économie (…) a souvent (…) donné au développement une puissante impulsion. Mais on ne saurait méconnaître qu’il est en résulté beaucoup de rudes secousses et une somme énorme d’injustices ». Qui pourrait mieux résumer en deux lignes les conséquences négatives de la globalisation néolibérale ?
Mieux, il nous a laissé en héritage plusieurs principes fondamentaux qui sont autant de réponses à la crise actuelle. C’est lui qui a insisté pendant toute sa vie pour que le progrès économique profite à tous, réclamant sans cesse une troisième voie entre le communisme et le capitalisme dont il dénonçait les excès, tout en reconnaissant son attachement à l’économie de marché. Il refusait cette corbeille, « où la politique de la France ne se fait pas ». L’Etat doit rester au-dessus de la libéralisation.
En outre, pour lui, il ne pouvait pas y avoir le moindre compromis avec la souveraineté nationale, seule garante de l’intérêt général, et qui est désormais opprimée par les traités européens. Il s’appuyait sur les frontières et était favorable à l’autosuffisance alimentaire alors que l’UMP et le PS ont laissé démanteler la PAC pour laquelle il s’est tant battu. Bref, les remèdes à la crise, relocalisation, règlementation, rétablissement des frontières, sont profondément gaullistes.
La pensée du Général de Gaulle est un des seuls systèmes de pensée alternatifs cohérent dont découlent directement les réponses à la crise. Comme il le disait, « puisque tout recommence toujours, ce que j’ai fait sera tôt ou tard une source d’ardeur nouvelle, après que j’aurai disparu ».
Analyste financier et observateur lucide des milieux de la bourse, Edouard Tétreau a passé ces trois dernières années aux Etats-Unis et a pu observer aux premières loges le déroulement de la crise. Avec 20 000 milliards de dollars - chroniques de la folie américaine, publié chez Grasset, il nous offre une portrait sans fard d'un pays malade et au bord de l'explosion ...
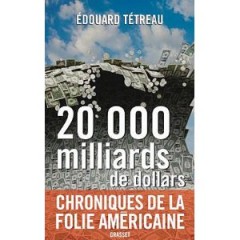
"Vous voulez la bonne ou la mauvaise nouvelle ?
La bonne : l’Amérique est de retour. Le « Yes we can » de Barack Obama semble avoir galvanisé un pays sous tension, sorti d’une crise sans précédent aucun depuis 1929, et en voie de guérison.
La mauvaise : l’Amérique aura bientôt (2020) atteint le seuil de 20.000 milliards de dollars de dette publique. Premier créancier : la Chine. D’après Edouard Tétreau, qui conjugue dans ce livre hilarant mais effrayant le talent de l’humoriste et le fiel du pamphlétaire, la première puissance mondiale ne remboursera jamais sa dette. Vous vous en fichez ? Vous avez tort : c’est VOUS qui allez payer.
Après Analyste, plongée au cœur de la folie des marchés financiers, le nouveau Tétreau nous précipite dans l’œil du cyclone : l’aberration de la puissance américaine, du Kansas à Manhattan, d’une chambre forte à un bureau de lobbyiste. En trois parties, Requiem, Born Again, Apocalypse, c’est l’Amérique dans tous ses états : la religion comme marché, les 75 millions de chiens domestiques sur-nourris, les vautours de Wall Street qui ne savent rien, disent-ils, des produits toxiques, un taux d’intérêt à 79,9 %, la faillite de Lehman Brothers vue d’un balcon privilégié, mais aussi l’immigration galopante, l’hispanisation de la société, le dynamisme de la Silicon Valley, une visite à Detroit ou à Palo Alto, la Californie propre ou le Mexique en surchauffe. « Je ne connais pas de pays où l’amour de l’argent tienne une plus large place dans le cœur de l’homme. » La phrase de Tocqueville n’a pas pris une ride… "