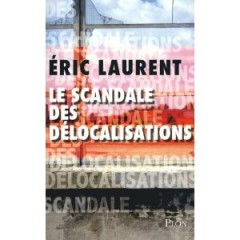Pourquoi la crise continue... et pourquoi menace une guerre des monnaies
Fin janvier, au forum de Davos en Suisse il a été question une nouvelle fois de réguler l’économie mondiale. Président temporaire du G20 et du G8, Nicolas Sarkozy n’est jamais le dernier à afficher de grandes ambitions dans ce domaine. Preuve que la régulation automatique du marché ne satisfait personne. A vrai dire, les théories de l’économie de marché ont souvent fait sourire. Elles supposent des agents rationnels, et ils ne le sont pas toujours. Elles consacrent peu de place à l’Etat, or il est omniprésent dans l’économie depuis la guerre de 1914 voire avant. Bref, ces théories paraissaient irréalistes.
Une économie de casino ?
Pourtant elles le sont de moins en moins. Pourquoi ? Parce que le monde réel ressemble de plus en plus à une économie de marché. Parce que l’économie de casino devient le fond réel de l’économie de marché « pure et parfaite ». Les Etats pèsent désormais moins, beaucoup moins, que les multinationales et que la finance. L’industrie n’est plus nationale. Et elle est à la remorque de la finance. Les investissements industriels, par définition à moyen et long terme, sont moins rentables que les spéculations financières, par définition à court terme. Les peuples et leurs représentants ne pèsent désormais plus grand-chose. On a pu dire des réunions du G20 que c’était un groupe d’anciens alcooliques qui se réunissaient pour décider de ne plus boire et qui se séparaient sans rien avoir décidé mais… en ayant pris un dernier verre. Ce dernier verre, c’est la dette mais plus encore la cause de la dette : la finance prédatrice, l’hyperclasse exigeant son taux de rentabilité.
Jacques Attali remarque justement : « une économie de marché sans Etat, surtout si l’information est imparfaite, ne trouve son équilibre qu’à un niveau de sous-emploi des facteurs. » (Slate.fr, 12 novembre 2010). Autrement dit, l’ajustement se fait sur la base d’une compression de la demande. Nous en sommes là. Avec en prime la guerre des monnaies.
La Chine ne veut pas réévaluer son yuan (ou renminbi selon son nom officiel). La monnaie chinoise n’est pas convertible donc pas soumise à des tensions ce qui accessoirement empêche toute démocratisation au sens occidental quand bien même le gouvernement chinois en aurait le goût. Plus de la moitié du PIB chinois est exporté : c’est dire l’enjeu. Puisque les Américains veulent maintenir leur dollar bas, les Chinois doivent maintenir bas le taux de change de leur yuan.
La Chine avec un yuan faible, et une main d’œuvre de plus en plus qualifiée reste donc hyper-compétitive. Elle exporte de plus en plus, accroit son excédent donc son déséquilibre commercial avec l’Amérique, et investit cet excédent en bons du Trésor américain et fonds de pension. La Chine est donc le premier créancier des USA qui eux mêmes ont tout intérêt à un dollar sous-évalué. Pour deux raisons : rester un tant soit peu compétitif, et diminuer la valeur de leur dette.
Chine et EUA : les deux ont intérêt à un euro surévalué. Les deux craignent que le premier marché mondial, la zone euro, devienne la première force mondiale. Mais qui mène le bal ? Philippe Dessertine note : « Le coupable premier, actuellement, ce sont les Etats-Unis, comme ils sont d’ailleurs généralement à l’origine de la dette folle ayant créé la crise de 2007-2008 et se prolongeant dans la crise économique et dans la crise de la dette souveraine actuelle. La Chine a d’abord financé la dette américaine, acceptant de devenir le premier détenteur de dette publique américaine (en dollars), avec comme contrepartie la possibilité d’asseoir sa croissance sur des exportations massives. » (« si la guerre des monnaies se poursuit… », Le Monde, 12 novembre 2010).
La finance de plus en plus loin de l’économie réelle
Or depuis la crise de 2008 l’économie réelle, l’économie de production ne s’est pas rapprochée de l’économie financière. Au contraire. Début 2007, la Banque centrale européenne détenait 900 milliards d’euros, elle en détient prés de 2000 fin 2010. La FED soit la banque centrale américaine est passée dans le même temps de 1200 à 2300 milliards de dollars. Un doublement en trois ans ce n’est pas la croissance de l’économie réelle c’est l’emballement de la financiarisation. Et l’un des indices de cela, c’est que les banques centrales ont du garder les actifs dépréciés qu’elles ont acquis. Sauvant ainsi le système bancaire privé avec l’argent public.
La crise continue pour plusieurs raisons. Dans l’économie réelle les délocalisations se poursuivent. Depuis 2002 la hausse du prix des matières premières a été considérable. Pétrole et métaux sont de plus en plus couteux à extraire : cette hausse est donc structurelle. Cette hausse des matières première a accru les réserves de changes des pays producteurs. Elles ont été multipliées par 5 de 2002 à 2007. Total mondial des réserves de change : dans les 9000 milliards de dollars, soit 14 % du PIB mondial. Des réserves de change en dollar, et en bonne part détenues par la Chine, à hauteur de 2500 milliards de dollars : près du tiers des réserves mondiales. De cet excédent de liquidités se sont ensuivis des produits financiers parasites créant des bulles spéculatives qui ont fini par éclater avec la crise des ‘’subprimes’’ c’est-à-dire des prêts à hauts risques. Exemple de ces produits financiers : la titrisation soit le refinancement de dettes à long terme.
« C’est là où se situe la principale dérive du système : rajouter un endettement qui a pour seul objectif d’améliorer le rendement. » écrit Jean-Hervé Lorenzi (slate.fr, 27 octobre 2010). La crise de confiance dans le système bancaire depuis 2007 amène une baisse des crédits accordés, et la récession qui va avec. Le noeud de la crise est un excès d’épargne, un excès d’exigence de rentabilité des investisseurs, et une insuffisance de la demande. La crainte de la faillite d’un Etat surendetté (Grèce ou Irlande) amène à des hauts niveaux de primes de risque. Elle amène aussi à une guerre des monnaies. Une guerre dans laquelle l’Europe est désarmée. Car l’écart se creuse entre les BRIC, qui vont vers une croissance de 6 à 10 %, et les EUA et l’Europe, qui stagnent. Aux EUA l’immobilier ne repart pas, le crédit est rare, le chômage reste considérable (9%). Les fonds de pension US qui doivent financer la retraite des Américains manquent de 6600 milliards de dollar soit 45 % du PIB américain. Mais les plans de relance gouvernementaux vont limiter les dégâts et la monnaie américaine reste la principale monnaie de réserve mondiale. Les Américains produisent autant de dollar que nécessaire pour eux : un privilège qu’ils sont seuls à détenir. Il en est tout autrement pour l’Europe. Tout son flanc sud (Grèce, Espagne, Portugal…) est menacé par la montée des dettes souveraines.
Dans ce contexte, la Chine joue le rachat des dettes. C’est le moyen pour elle de soutenir la monnaie des autres pays à un niveau au dessus de la sienne. Une façon là encore de sous évaluer son yuan. Le yuan faible est en effet « la garantie de la puissance chinoise » (Moises Naim) : il permet les exportations chinoises, et en rendant très chers les produits importés, il protège leur marché intérieur de la concurrence étrangère. Et c’est pourquoi la Chine peut avoir des réserves de change de la Chine égales à prés de la moitié de son PIB (40 %), le 2eme du monde avec 5500 milliards de dollars.
Que faire ? C’est la question qui se pose aux Américains mais aussi à l’Europe. Rétorsion ? Taxation des exportations chinoises ? Les Américains le peuvent, mais la Chine ne manque pas de rappeler que ceux qui s’y risqueraient porteraient la responsabilité d’une crise sociale majeure dans un pays d’1,3 milliards d’habitants. Qui veut jouer avec cela ? Si les grands pays industriels ne veulent pas se lancer dans le protectionnisme, trop inquiets d’une contraction brusquée des échanges, l’arme monétaire reste une tentation. A défaut d’obtenir une substantielle réévaluation du yuan les Américains peuvent toujours maintenir le dollar le plus bas possible, ce qui limite l’invasion de leur marché par les produits chinois.
Reste que tant que la Chine achète les dettes des occidentaux, le monde, et d’abord les USA, connait un trop plein de liquidités d’où des taux d’intérêt très bas, et donc une incitation au surendettement des ménages. Or, plus chacun s’endette, plus il y a de dettes à racheter. Solution : que chaque pays reconquiert son marché intérieur et que la production chinoise s’oriente vers… le marché chinois.
Bref il faut plus d’économie autocentrée et moins de mondialisation pour limiter les risques de conflagration et de répercussions en chaine des crises des uns et des autres. Il faut certainement aussi une Europe plus autocentrée au niveau financier, d’où l’idée qui chemine d’un Trésor européen. Anton Brender, chef économiste de la banque Dexia note : « Il faut quelqu’un qui achète les dettes ; or, même à l’échelle de la zone euro, il n’existe pas de Trésor commun. Voilà toute l’ambiguïté de l’Union monétaire européenne. Elle est dotée d’une même monnaie, mais la Banque centrale européenne ne dispose d’aucune autorité en matière prudentielle vis-à-vis des banques ». (Le Figaro, 24.09.08). En d’autres termes : intervenir, prévenir la spéculation et mutualiser les risques. C’est déjà ce qu’affirmait Pierre Hillard dans La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, F-X de Guibert, 2007).
Indépendance européenne ou nouvel ordre mondial ?
L’ennui, c’est que beaucoup voient toute action européenne comme une simple étape vers une gouvernance mondiale, et que celle-ci dans l’état actuel des choses ne peut être autre chose que la pérennisation de la domination de l’hyper-classe. Alors, comment fait-on ? Et si on revenait aux idées simples ? L’Europe souveraine, l’Europe protectrice de ses nations plutôt que l’Europe tremplin vers le grand marché mondial. Jean-François Jamet suggère de son coté que l’intérêt des pays émergents (surtout les BRIC – Brésil, Russie, Inde, Chine -, et la Turquie) serait d’évaluer leur monnaie non par rapport au seul dollar mais par rapport à un panier de monnaies. « Ce panier pourrait par exemple inclure le dollar, l’euro, le yen – éventuellement la livre britannique et le franc suisse – à proportion du poids de chacune des zones monétaires correspondantes dans les échanges de ces pays. » (Les Echos, 17 décembre 2010). Un usage multipolaire de la monnaie. Ce qui ouvrirait la voie vers un autre ordre mondial. Mais ce n’est pas seulement d’un rééquilibrage dont le monde a besoin. C’est d’une autre conception de la place de l’économie. Le président du forum économique de Davos, Klaus Schwab, constate : « Cette année, l’économie mondiale va croître de 5%. Si ce rythme se maintient, elle doublera de taille en quinze ans, ce qui signifie aussi que l’utilisation des ressources sera multipliée par deux, sauf si bien sur, on parvient entre temps à améliorer l’efficacité énergétique. Dans ces conditions, nous allons être confrontés à un problème de pénurie, un thème qui sera présent dans nos discussions de Davos. » (La Tribune, 26 janvier 2011). La hausse des prix des matières premières y compris les plus vitales, celles des produits alimentaires, est un signe. Ses conséquences politiques, nous les voyons déjà au Maghreb. Parce que cela commence toujours par les plus fragiles. Avant de remonter vers les pays faussement solides. La France par exemple. Développer l’homme et non seulement les biens matériels et l’argent : un sacré défi.
Pierre Le Vigan (Flashblog, 10 février 2011)