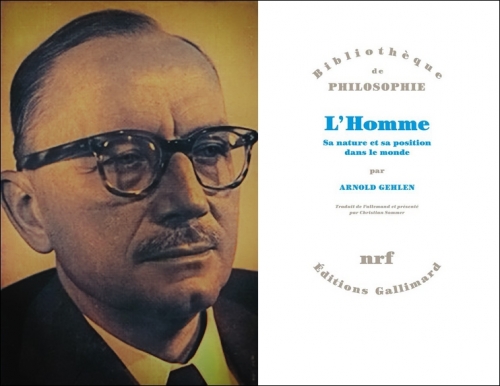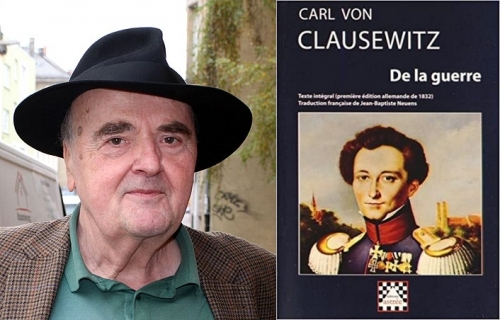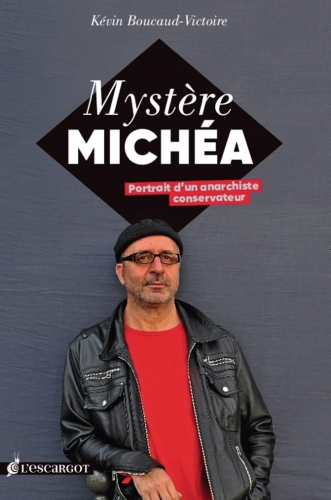« Soyons conservateurs… et révolutionnaires ! »
Soyons conservateurs… et révolutionnaires. Ou, pour le dire autrement, conservons et innovons, sauvegardons et rompons tout à la fois. L’oxymoron (pour les victimes de nos systèmes éducatifs : la contradiction logique) entre les deux exigences semble manifeste. Et pourtant…
Et pourtant, je pourrais invoquer qu’une telle dualité avait, par exemple, déjà marqué, voici un siècle, un mouvement aussi important que la Révolution conservatrice allemande (avec des figures aussi éminentes que les frères Jünger, Spengler, Heidegger et tant d’autres). Mais laissons les invocations historiques. Il suffit d’affirmer que de deux choses l’une : ou nous devenons à la fois conservateurs et révolutionnaires, conservateurs et innovateurs – c’est-à-dire des conservateurs d’un type nouveau, très différents des conservateurs traditionnels –, ou rien ne pourra nous sauver.
C’est d’être conservateur qu’il était question aussi dans le discours récemment prononcé à Rome par Marion Maréchal et dont le niveau intellectuel – il vaut la peine de le souligner – surmonte de très haut la plupart des discours politiques, eux qui ont la platitude comme signe et la langue de bois comme expression.
Oui, elle a raison Marion Maréchal lorsqu’elle se proclame conservatrice ; lorsqu’elle affirme que, face à la décomposition du monde, face à la folie nihiliste qui nous entoure, il faut conserver les valeurs essentielles de notre civilisation. Quelle société pourrait d’ailleurs exister si elle ne conservait pas ce qui lui est le plus propre, si elle mettait tout constamment en question ?
Bien entendu. Le problème est qu’une fois admis ce qui précède, c’est alors que les véritables questions se posent. Des questions importantes, décisives. Et difficiles. Examinons-les.
Il faut conserver, certes… Mais conserver quoi, au juste ? Non pas le monde d’aujourd’hui, bien sûr ; non pas ce monde absurde et gris, laid et triste qu’il s’agit de démolir.
S’agirait-il donc de conserver (de récupérer, plutôt) le monde d’hier, de revenir à lui et à ses principes ? Pas davantage. Tout d’abord, parce que l’histoire (ce que les réactionnaires s’échinent à ne pas comprendre) ne revient jamais en arrière (tout comme elle n’avance pas vers le Progrès des progressistes). Mais il y a une raison encore plus importante. Même s’il était possible de revenir aux temps d’hier, il ne faudrait pas non plus retourner à des temps dont il faut certes conserver certaines choses (nous verrons lesquelles) mais pas toutes, et pas non plus l’esprit qui y présidait. Il en va de même avec le monde d’aujourd’hui, dont certaines choses méritent d’être conservées (par exemple, les découvertes scientifiques et le bien-être matériel ; par exemple, la liberté sexuelle et la liberté d’expression) mais pas toutes ses choses, et encore moins l’esprit qui y préside.
S’agirait-il donc de tomber dans éclectisme bon teint et dans l’équidistance molle ? S’agirait-il de mettre en œuvre des recettes telles que : « Un peu de ceci, un peu de cela… Ne tombons pas dans les extrémismes… Le mieux, c’est un bon compromis » ? Absolument pas. Ce dont il s’agit, c’est de tout repenser sur de nouveaux frais, de fond en comble, en sachant ce qu’il faut extirper et préserver (ou récupérer) dans un résultat final – dans une nouvelle vision du monde – qui ne ressemblera (quand ce sera son tour : ce n’est pas une affaire d’un jour ou de deux) ni au monde d’hier ni à celui d’aujourd’hui.
Je viens de prononcer le mot extirper : ce mot intempestif – presque une grossièreté – que plus personne ne prononce à propos de telles choses. Mais c’est bien le mot qu’il faut prononcer quand il est question de racines et celles-ci sont pourries. « Les racines du mal qui nous ronge », disait Marion Maréchal dans son discours, il faut les chercher dans « le citoyen abstrait de la Révolution française, détaché de sa terre, de sa paroisse, de sa profession […], dans cette matrice du citoyen du monde ! Du citoyen du néant ! ».
Sans nul doute. Or, qu’est-ce qui fait que ce citoyen s’enfonce dans le néant (tout en se tordant de rire, le malheureux) ? Pourquoi cet homme se détache de ses liens, ignore ses enracinements, méprise ses traditions ? Pourquoi, devenu abstrait, erre-t-il comme un somnambule parmi de nuages inconsistants ?
Cet homme (ou ceux qui le manipulent) est-il à ce point imbécile ou méchant ? Bien sûr qu’il l’est, en partie du moins ; il ne faut pas charrier ! Mais ne tombons pas dans les simplifications, dans la reductio ad stultitiam et malignitatem (si facile, si commode) dans laquelle tombent parfois nos gens. Si l’homme erre perdu aujourd’hui dans les nuages du néant, s’il essaye de les remplir avec des délires aberrants, c’est pour la simple raison qu’il est resté seul. Seul avec son corps, seul avec sa matière, seul avec sa mort. Réduit à cette solitude, à cette inanité et à cette mort qui constituent le fond même de « la mort de l’esprit », comme elle est appelée dans le Manifeste que j’ai lancé, il y a quelques années, avec le soutien de l’écrivain Álvaro Mutis.
La mort de l’esprit ?… Mais qu’est-ce que vous racontez là, voyons ! On ne parle pas de ces choses-là, surtout pas en politique ! On ne les envisage même pas. Tout d’abord, parce que la plupart des politiciens n’y comprendraient que dalle, et ensuite parce que ces choses-là ne mobilisent ni ne peuvent mobiliser personne.
C’est vrai, de telles questions ne mobilisent ni ne peuvent, dans le quotidien, dans l’immédiat,mobiliser personne. Mais il n’est pas question ici de mots d’ordre pour mobiliser qui que ce soit : il n’est question que de la lame de fond qui bouillonne en-dessous de ce par quoi les hommes vivent et rêvent, luttent et se mobilisent – ou, ne le faisant plus, ils périssent.
La mort de l’esprit… Comprenons : l’évanouissement du souffle spirituel qui avait marqué, de mille façons différentes, toutes les cultures, toutes les sociétés, toute l’histoire : le monde lui-même… jusqu’à l’arrivée du nôtre.
La mort de l’esprit… S’agit-il donc de la mort de Dieu, de l’évanouissement social de la religion ? S’agit-il de ce fait inouï, énorme, que personne n’avait connu jusqu’à nous ? Non, il ne s’agit pas de cela. Ou plutôt si, mais seulement en partie.
L’effondrement de la religion n’est qu’une des manifestations où la mort de l’esprit s’exprime. [1] Cet effondrement est accompagné de bien d’autres phénomènes : depuis l’anéantissement systématique du beau, que le soi-disant « art » contemporain entreprend (là aussi pour la première fois dans l’histoire), jusqu’au règne de la laideur et de la vulgarité qui se déploie dans nos villes et nos campagnes, en passant par l’exacerbation du matérialisme et de l’individualisme, pour ne rien dire de tous les délires propagés par l’ultra-féminisme et l’idéologie du genre.
Or, ce ne sont là qu’autant de manifestations d’une perte, d’une disparition bien plus profonde. Si le néant répand son inanité sur le monde, c’est parce que le souffle s’est évanoui, qui faisait que, de mille façons différentes mais dans toutes les sociétés, à toutes les époques, le monde se trouvait comme auréolé d’un sens supérieur, imprégné d’une inquiétude spirituelle qui empêchait les hommes et les choses de rester embourbés dans leur matérialité plate, immédiate et mortelle.
Et tant qu’un nouvel élan spirituel, un nouveau souffle sacré n’halètera pas dans nos cœurs et dans celui des choses nous resterons au bord de l’abîme sur lequel nous nous tenons à présent.
Revenons aux questions proprement politiques
Il est juste et nécessaire d’en finir avec l’invasion migratoire qui nous étouffe. Il est juste et nécessaire d’en finir avec la dissolution anthropologique constituée par l’idéologie du genre et par les effronteries de l’ultra-féminisme. Il est juste et nécessaire d’en finir avec la mise à l’écart qui, exercée sous la houlette de la nouvelle classe dominante – la ploutocratie financière et mondialiste – et frappant presque tout le monde, configure une sorte de confraternité inédite qui va des classes les plus populaires, victimes de la précarité, jusqu’à une bourgeoise (appelée aussi classe moyenne-haute) victime de la spoliation fiscale.
Tout cela est juste et nécessaire. Tout simplement indispensable. Mais rien ne pourra être réussi sans la force d’un peuple porté, encouragé par un grand idéal, par un idéal supérieur. [2] Or, un tel idéal pourra bien difficilement se déployer et une telle force s’exercer si nos objectifs restent de nature « négative », réactive, d’opposition ; si nous nous bornons à des objectifs qui, comme ceux que je viens de rappeler, consistent finalement à s’opposer à d’autres projets, à barrer le chemin à d’autres idéaux.
Des idéaux – ceux des « progressistes » – qui, eux, sont affirmatifs, ont une sorte de projet de monde à offrir. Un projet qui anéantit, certes, le monde ; un projet proprement im-monde mais un projet quand même, une affirmation, un espoir (pour ceux qui y croient). Soyons clairs : nous n’avons rien de pareil. Tout ce que nous avons, ce sont des objectifs « défensifs ». Des objectifs absolument indispensables pour nous défendre de la menace qu’aussi bien les progressistes libéraux de droite que les progressistes libéraux ou socialistes de gauche font peser sur la civilisation. Mais rien de cela ne configure un nouveau projet de monde, une nouvelle et stimulante vision des choses, une nouvelle cosmovision qui conserve (ou récupère) le souffle qui permettait à nos ancêtres de se forger un destin où, parmi les bassesses et les misères qui existeront toujours dans toute société, la grandeur et la beauté étaient bien présentes.
Mais entendons-nous bien. Ce qu’il s’agit de conserver (ou de récupérer), c’est l’exigence d’un souffle spirituel ; non pas le contenu, non pas les modalités, non pas les expressions que ce souffle avait lors de l’Antiquité païenne, ou lors de la Chrétienté moyenâgeuse, ou lors de la Renaissance pagano-chrétienne, ou lors de l’Ancien Régime, ou lors de ce qui pouvait rester de ce souffle aux premiers temps du Nouveau (et actuel) Régime.
Ce dont il s’agit, c’est de la tâche enivrante (et difficile) de forger un nouveau souffle, un nouvel esprit, un nouveau projet de monde qui, étant porteur de sens, de grandeur et de beauté, façonne le destin des hommes qui, plongés dans la matérialité de l’existence, n’ont plus un destin inspiré par un Dieu, exprimé dans la figure symbolique d’un Monarque, reflété dans les normes intangibles d’une Tradition.
Une telle chose, est-elle possible ?… Bien sûr qu’elle l’est ! Il ne s’agit ni d’une extravagance ni d’un délire. Certes, nous sommes encore peu nombreux, insignifiants même à l’échelle globale, mais nous sommes là, nous qui portons la Liberté et son indétermination dans notre cœur, nous qui n’avons ni Dieu, ni Loi, ni Tradition qui fixe nos pas ; et nous qui, pourtant, sommes empreints d’un profond sens spirituel, d’un désir profond de beauté et de grandeur, de noblesse et d’héroïcité – et j’arrête de dire des mots qui sont devenus autant de grossièretés (et peut-être bientôt autant de délits).
Mais la question n’est pas de savoir si un tel projet de monde est possible en soi. La question est de savoir si un tel projet est possible pour le monde. Et être possible pour le monde, cela veut dire aujourd’hui : être possible pour tout le monde – pour l’immense majorité, enfin.
Est-il possible qu’une nouvelle cosmovision fleurisse où halèterait quelque chose du souffle ayant imprégné l’air qui, sous de formes si différentes, a été respiré par les hommes de tous les temps et de toutes les cultures jusqu’à il y a à peu près un siècle ? Une telle chose est-elle possible sans que cela implique (ne vous faites pas d’illusions, amis réactionnaires et conservateurs) aucun retour au status quo ante ? Une telle chose, est-elle envisageable lorsqu’il semble impossible que la religion – rien qu’un élément du souffle spirituel, certes, mais élément probablement indispensable – puisse revivre dans le monde ?
Il semble impossible que la religion puisse revivre lorsque l’Église catholique consacre ses efforts depuis plus d’un demi-siècle (l’église protestante depuis presque un demi-millénaire…) à jeter par-dessus bord tout ce qu’elle avait de plus grand et merveilleux – son culte, son rituel – en même temps qu’elle sauvegarde avec soin ce qui mérite les qualificatifs opposés. Mais il n’y a pas que cela. Il y a une autre question plus importante encore. Comment le divin pourrait-il renaître dans le monde dès lors qu’il semble impossible de lui assigner aucune place ou statut ontologique ? [3]
Et s’il s’agissait peut-être d’assigner au divin une place et un statut profondément différents de ceux qui lui ont été assignés jusqu’à présent (mais à des degrés différents) para l’ensemble des religions ?
Peut-être, qui sait, sait-on jamais…
Or, l’affaire est si complexe et cet article si long qu’il vaudra mieux laisser une telle question pour un autre jour.
Javier Portella (Polémia, 11 février 2020)
Notes :
[1] Avec l’évanouissement social de la religion, nous sommes probablement en train d’assister au désastre que tant de penseurs de l’Antiquité païenne (un Cicéron, un Lucrèce, un Épicure…) avaient craint.Tout en mettant en doute l’existence physique des dieux ou leur implication dans les affaires de hommes,ces penseurs considéraient que l’existence de la religion n’en était pas moins indispensable, pour la sauvegarde de la société, eu égard aux aspirations et aux sentiments du peuple. Ou du vulgaire, comme on disait il n’y a pas si longtemps.
[2] Un peuple, d’ailleurs, non seulement « périphérique », comme on le dit, mais « central » aussi. Un peuple non seulement des campagnes et des villes de province mais des grandes capitales aussi.
[3] Seuls les croyants qui restent encore sont capables d’assigner un statut ontologique au divin. Mais ce statut se borne au sentiment subjectif – et légitime, il va sans dire – d’une foi face à laquelle aucun raisonnement ou explication n’est possible. Par là-même, le croyant ne fait rien d’autre que renforcer l’enfermement du divin dans le domaine de la conscience subjective, individuelle. Encore une expression, finalement, du subjectivisme ou individualisme contemporains.