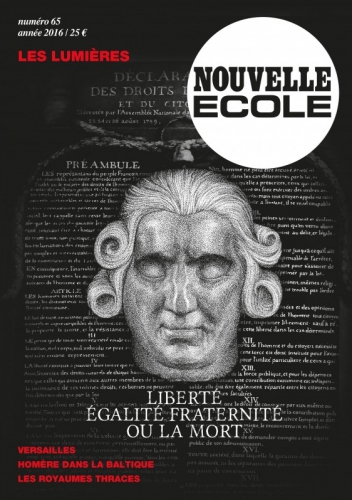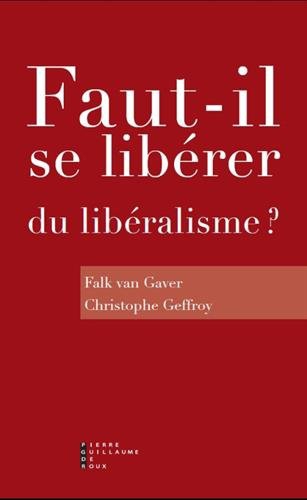Nous reproduisons ci-dessous entretien avec Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire et consacré à la question de l'Allemagne et de sa chancelière...

« Le couple franco-allemand repose sur des malentendus que rien n’a jamais pu lever »
Angela Merkel a été élue « personnalité de l’année » par le magazine Time. Mais qui est-elle vraiment ? Incarnation du capitalisme rhénan ? Des vieux démons pangermaniques ? Ou juste mère fouettarde des élégances budgétaires ?
Angela Merkel est à l’image de l’Allemagne d’aujourd’hui : excessivement morale, grassouillette et sans enfants. Élue chancelière il y a tout juste dix ans, elle s’est imposée à bas bruit, triomphant peu à peu de tous les scepticismes, jusqu’à jouer un rôle de premier plan, comme on l’a vu dans l’affaire ukrainienne, la crise grecque ou plus récemment l’ouverture des frontières aux migrants. Elle s’est imposée d’une façon paisible, figure exemplaire du Muttistaat, « l’État maternel » qui rassure les Allemands (“Keine Experimente!”, disait-on déjà de l’autre côté du Rhin dans les années 1960). La main onctueuse, les lèvres pincées, la paupière lourde, elle incarne à la perfection cette femme sans qualités, au sens que Robert Musil donnait à cette expression, qui se pose tantôt en gardienne de l’orthodoxie monétaire et de l’austérité budgétaire, tantôt en vestale de l’accueil humanitaire.
Lisse, opaque, se dérobant aux affects, cette fille de pasteur a fait basculer encore un peu plus son pays vers les valeurs du protestantisme. L’Allemagne, depuis la réunification, pèse d’un poids grandissant plus que d’une réelle volonté. Elle assume un leadership dont elle n’a pas vraiment envie – ce que le Britannique William Paterson a appelé le “reluctant hegemon”, l’hégémonie à contrecœur.
Avec l’affaire des migrants, sa popularité est quand même retombée ?
Elle a été entamée, puisque après une phase d’euphorie orchestrée, une partie de son électorat commence à s’effrayer sérieusement de l’afflux des « réfugiés » : 16 % seulement des Allemands considèrent aujourd’hui les migrants comme autant de « chances » pour leur pays. C’est surtout vrai dans l’ancienne RDA, moins marquée que les länder de l’Ouest par l’idéologie libérale et « occidentale », mais aussi dans l’« État libre de Bavière », aujourd’hui en première ligne face au flot des migrants et dont le ministre de l’Intérieur, Joachim Hoffmann, vient d’annoncer (dans un entretien au Welt am Sonntag passé totalement inaperçu dans la presse française) qu’il assurera désormais lui-même le contrôle de ses frontières, tournant qui revient à mettre en cause un aspect essentiel du principe fédéral.
Angela Merkel n’en reste pas moins à un niveau de popularité que lui envieraient bien d’autres chefs d’État ou de gouvernement, à commencer par le nôtre puisque 60 % des Allemands pensent qu’aucun autre dirigeant politique ne gérerait la situation mieux qu’elle. Personne ne voit, d’ailleurs, par qui la remplacer, à commencer ceux qu’on présente imprudemment comme ses compétiteurs, qu’il s’agisse du social-démocrate Sigmar Gabriel, du ministre des Finances Wolfgang Schäuble ou du président des chrétiens-démocrates de Bavière Horst Seehofer.
Et le fameux « couple franco-allemand », qu’on a toujours décrit comme le moteur de l’Europe, il en est où ?
Fruit d’un mariage de raison, le couple franco-allemand repose sur une série de malentendus que rien n’a jamais pu lever, tant l’histoire et la culture politique des deux pays sont différentes depuis que le traité de Verdun (843) a divisé en deux l’ancienne Francie en une partie romane et une partie tudesque. D’un côté, un État-nation, où la politique s’ordonne toujours à des initiatives spectaculaires prises par de grands acteurs, de l’autre un pays de tradition impériale-fédérale, où l’on n’a jamais très bien compris quelle est l’essence du politique (on y prône la dépolitisation par le droit) et où l’on considère qu’après la parenthèse jacobine du IIIe Reich, il importe avant tout de garantir le respect des normes afin de se prémunir contre tout événement dramatique. D’un côté, des fonctionnaires et des énarques, de l’autre, des parlementaires et des juristes. Ne nous étonnons pas que la mentalité allemande reste aussi incompréhensible pour les Français que les institutions politiques françaises pour les Allemands !
Quoique voisins, Français et Allemands se connaissent peu et se comprennent mal. Quant au traité d’amitié franco-allemand dont le général de Gaulle avait pris l’initiative en 1963, ses dispositions en faveur d’une meilleure compréhension entre les deux peuples sont restées lettres mortes. La règle, vue en France comme une limite et une contrainte, est perçue en Allemagne comme un facteur d’ordre et de liberté. Un Français est français grâce à l’État, un Allemand est allemand grâce à sa culture. La France privilégie son marché intérieur et son pouvoir d’achat, l’Allemagne sa compétitivité et ses exportations. La première a d’abord un Président, la seconde un Parlement. De l’Europe, l’une et l’autre se font des idées opposées – l’une l’utilise comme levier pour cacher sa faiblesse, l’autre comme couverture pour cacher sa force -, ce qui explique pourquoi le souverainisme et le populisme n’ont pas, en Allemagne, le succès qu’ils ont en France.
Bref, le divorce n’est pas en vue, mais le couple bat de l’aile : dans le train européen, la locomotive est en panne. Ce qu’il faut retenir, c’est que le déséquilibre franco-allemand ne vient pas d’une Allemagne trop forte, mais d’une France trop faible. La nouvelle germanophobie façon Mélenchon, qui veut voir dans Merkel la réincarnation de Bismarck, tombe de ce point de vue totalement à plat.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 4 janvier 2016)