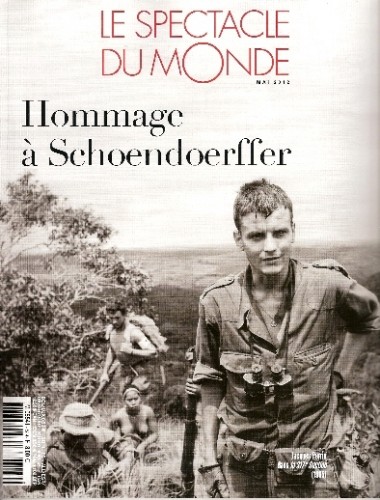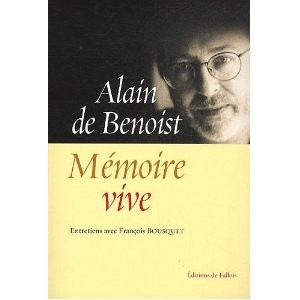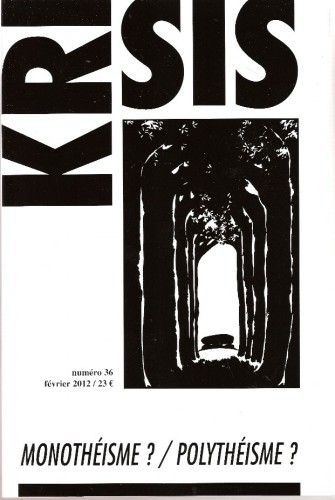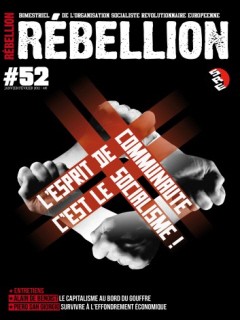Nous reproduisons ci-dessous un texte du philosophe italien Costanzo Preve, traduit par Yves Branca et consacré au nécessaire dépassement du clivage Droite/Gauche...
Marxiste critique et atypique, Costanzo Preve a noué un dialogue fécond avec Alain de Benoist depuis plusieurs années et est maintenant bien connu des lecteurs d'Éléments et de Krisis. Un de ses ouvrages, Histoire critique du marxisme, a été publié en 2011 aux éditions Armand Colin.

La boussole s'est rompue
1: On ne peut décemment demander au marin de partir en mer sans compas, surtout lorsque le ciel est couvert et que l’on ne peut s’orienter par les étoiles. Mais qu’arrive-t-il, si l’on croit que le compas fonctionne, alors qu’il est falsifié par un aimant invisible placé dessous ? Eh bien, voilà une métaphore assez claire de notre situation présente.
2 : En Italie, avec le gouvernement Monti, les choses sont devenues à la fois plus claires et plus obscures. Plus claires, parce qu’il est bien évident que la décision politique démocratique (dans son ensemble, de gauche, du centre, de droite) a été vidée de tout contenu ; et que nous sommes devant une situation que n’avaient jamais imaginée les manuels d’histoire des doctrines politiques (bien évident : du moins pour ces deux pour cent de bipèdes humains qui entendent faire usage de la liberté de leur intelligence ; je ne tiendrai pas compte ici des quatre-vingt dix-huit pour cent restant).
En bref, nous sommes devant une dictature d’économistes, à légitimation électorale référendaire indirecte et formelle. Il est évident que cette dictature s’exerce pour le compte de quelqu’un, mais ce serait se tromper que de trop « anthropomorphiser » ce quelqu’un : les riches, les capitalistes, les banquiers, les américains, etc.. Cette dictature d’économistes est au service d’une entité impersonnelle (que Marx aurait qualifiée de «sensiblement suprasensible »), qui est la reproduction en forme « spéculative » de la forme historique actuelle du mode de production capitaliste (v. Diego Fusaro, Minima mercatazlia. Philosophie et capitalisme, Bompiani, Milan, 2012). A ce point de vue, les choses sont claires.
Ce qui n’est pas clair du tout, et même obscur, c’est la manière dont cette junte d’économistes peut « conduire l’Italie hors de la crise ». Elle est au service exclusif de créanciers internationaux ; son unique horizon est la dette. La logique du modèle néo-libéral consiste à « délocaliser » de Faenza jusqu’en Serbie la fabrication des chaussures Omca, afin de pouvoir payer les ouvrier deux cents euros.
Dans cette situation, le maintien du clivage Droite/Gauche n’est plus seulement une erreur théorique. C’est potentiellement un crime politique.
3 : Dernièrement, je suis resté ébahi en lisant un tract du groupuscule « La Gauche critique ». Je ne comprenais même pas pourquoi, et puis tout d’un coup j’ai cru comprendre. Le terme même de « gauche critique » est une contradiction, puisque le présupposé principal et très essentiel de toute critique, sans lequel le terme de « critique » perd tout son sens, est justement le dépassement de cette dichotomie « Droite/Gauche ». On ne peut plus être à la fois critiques, et de gauche ; non plus que de droite, ce qui revient au même.
Je viens de renvoyer au dernier livre de Diego Fusaro. Dans cette histoire philosophique du capitalisme, depuis ses origines au XVIe siècle jusqu’à aujourd’hui, ces deux petits mots, Droite et Gauche, n’apparaissent absolument jamais, par ce fait tout simple et nu que la mondialisation capitaliste, et la dictature des économistes qui nécessairement en est la forme, a entièrement vidé ces catégories de leur sens. Norberto Bobbio(1) pouvait encore en parler en toute bonne foi, en un temps où existait encore une souveraineté monétaire de l’Etat national, et où les partis de « gauche » pouvaient appliquer des politiques économiques de redistribution plus généreuses que celle des partis « de droite ». Mais aujourd’hui, avec la globalisation néo-libérale, le discours de Bobbio ne correspond plus à la réalité.
Il y a, bien sûr, un problème, du moment que la dictature « neutre » des économistes a cependant toujours besoin d’être légitimée constitutionnellement par des élections, fussent-elles vides de tout sens de décision. C’est donc ici que se met en scène une comédie à l’italienne ; personnages : la « gauche responsable » : Bersani, D’Alema, Veltroni, tout le communisme togliattien recyclé ; le bouffon qui fait la parade, Vendola, dont on sait bien à priori que ses suffrages iront de toute façon au Parti Démocrate (2) ; les « témoins du bon vieux temps » Diliberto et Ferrero, dont les suffrages iront toujours au même Parti Démocrate, sous le prétexte du péril raciste, fasciste, populiste, etc. ; les petits partis à préfixe téléphonique ( respectivement « Pour la refondation de la IVe internationale bolchevique », « refondateurs communistes » ), de Turigliatto et Ferrando, fidèles au principe olympique « l’important n’est pas de vaincre, mais de participer » ; enfin, les Témoins de Jéhovah du communisme (Lutte communiste), dans l’attente du réveil du bon géant salvifique, la classe ouvrière et salariée mondiale.
L’idéal serait que, selon la fiction du romancier portugais José Saramago, personne n’allât plus voter; je souligne : personne. Si personne n’allait plus voter, la légitimation formelle de la dictature des économistes s’écroulerait. Le magicien capitaliste trouverait encore le moyen de tirer un nouveau lapin de son chapeau, mais on s’amuserait bien en attendant. Hélas! Cela est un rêve irréalisable. La machine Attrape-couillons est trop efficace pour qu’on la laisse tomber en désuétude.
4 : Et pourtant, la solution pourrait bien être à la portée de la main : une nouvelle force politique radicalement critique à l’égard du capitalisme libériste mondialisé, et tout à fait étrangère au clivage Droite/Gauche. Une force politique qui laisse tomber tous les projets de « refondation du communisme » (la pensée de Marx est encore vivants, mais le communisme historique est mort), et qui retrouve plutôt des inspirations solidaristes et communautaires (4). En théorie, c’est l’œuf de Christophe Colomb ; en théorie, il faudra encore plusieurs décennies, à moins d’improbables accélérations imprévues de l’histoire, pour que l’on comprenne bien que la boussole est hors d’usage, et que « droite » et « gauche » ne sont plus désormais que des espèces de panneaux de signalisation routière.
5 : Et c’est ici que je vais donner l’occasion à tous les scorpions, araignées, et vipères de m’accuser: « Preve fasciste ! ». Il est vrai que, si l’on a peur de briser les tabous, mieux vaut se reposer et lire des romans policiers.
Voici : un cher ami français vient de m’envoyer le livre qu’a écrit Marine Le Pen (Pour que vive la France, Grancher, Paris, février 2012). Je sais déjà qu’on va parler d’une astucieuse manœuvre d’infiltration populiste par l’éternel fascisme ; mais ce livre, lisez-le, au moins. Il est étonnant. Moi, il ne m’étonne pas, puisque je connais bien la dialectique de Hegel, l’unité des contraires, et la logique du développement tant de la gauche que de la droite depuis une vingtaine d’années.
Voyons cela. A la page 135, Marine Le Pen écrit : « Je n’ai pour ma part aucun état d’âme à le dire : le clivage entre la gauche et la droite n’existe plus. Il brouille même la compréhension des enjeux réels de notre époque ». Je vois que ses principales références philosophiques dont deux penseurs « de gauche » : Bourdieu et Michéa (page 148). Je vois que Georges Marchais, ce représentant du vieux communisme français, est cité, favorablement. Plus de Pétain ni de Vichy. Sarkozy est condamné tant pour sa politique extérieure au service des Etats-Unis que pour sa politique intérieure qui aggrave l’inégalité sociale. Sur la question du marché, sa principale référence théorique est Polanyi (page26). Le Non français à la guerre d’Irak de 2003 est revendiqué (p.37). Marx est cité (page 61) ; le grand économiste Maurice Allais est souvent cité, pour soutenir l’incompatibilité du marché et de la démocratie. Mais surtout, j’y ai retrouvé avec plaisir ce qui me séduisait dans le communisme des années soixante, à savoir que la parlotte polémique à courte portée marche derrière, et non devant : le livre commence par un long chapitre intitulé, à la française « Le mondialisme n’est pas un humanisme ». La globalisation est très justement qualifiée d’«horizon de renoncement », et il y est réaffirmé que « l’empire du Bien est avant tout dans nos têtes », ce qui est vrai.
Je pourrais continuer. Je sais que j’ai donné aux vipères et aux scorpions une belle occasion de m’outrager; c'est ce qui va arriver.
Mais pour moi, tout ce que je veux, en réalité, c’est faire réfléchir.
6 : Pour comprendre ce que sont aujourd’hui la Droite et la Gauche, nul besoin de s’adresser à des défenseurs « idéal-typiques » de la fameuse dichotomie, en termes de valeurs éternelles et de catégories de l’Esprit, comme un Marco Revelli. Il suffit de lire des défenseurs du système comme Antonio Polito (dans le Corriere della sera, 25 février 2012). Polito dit ouvertement que la compétition politique peut désormais avoir lieu dans le seul cadre, tenu pour définitif, de l’économie globalisée ; que tout le reste, du pitre Nichi Vendola (Mouvement pour la gauche) à Forza Nuova (d’« extrême droite »), n’est qu’agitation insignifiante ; que cela est notre destin.
Que proposent donc les « gauches » encore en activité, d’Andrea Catone à Giacche et à Brancaccio ? Une relance du keynesisme et de la dépense publique en déficit à l’intérieur de l’Union européenne ? Une nouvelle mise en garde après tant d’autres contre la menace du racisme, de la Ligue du Nord, du populisme ? Une « alter-globalisation à visage humain » ? A présent que le Grand Putassier n’occupe plus le devant de la scène, avec quoi va-t-on continuer à fanatiser comme des supporters de foot le «peuple de gauche» ?
Si on lit le dossier « Chine 2020 » de la banque mondiale, récemment présenté à Pékin, on verra que la dictature des économistes s’étend sur le monde entier. Aujourd’hui, la révolution n’est pas mûre ; elle n’est à l’ordre du jour ni selon sa variante stalinienne (Rizzo), ni selon sa variante trotskiste (Ferrando). Ni même le réformisme, puisque le réformisme suppose la souveraineté de l’Etat national. Et il y en a encore qui jouent comme des enfants avec la panoplie du petit fasciste contre le petit communiste ? Ou du petit communiste contre le petit fasciste ? Aujourd’hui, l’ennemi, c’est la dictature des économistes néo-libéraux. Avec ceux-ci, pas de compromis ! Voilà le premier pas. Si on le fait, on pourra faire les suivants.
Deux mots encore à propos de la manie du vote compulsif.
Il est probable que l’américanisation intégrale et radicale, bien plus grave encore que l’européisme, que va apporter le gouvernement Monti, produise une diminution de la participation électorale des italiens, qui depuis 1945 a toujours atteint des niveaux délirants. Cette compulsion électoraliste, qui est évidente chez les personnes âgées, était liée à l’opposition Démocratie Chrétienne/ Parti communiste; elle s’est prolongée, par inertie, au temps de Craxi, de Prodi, et de Berlusconi. Mais à présent que l’Etat prend tout et ne donne plus rien, elle devrait diminuer ; pas assez vite, hélas ! Il y aura toujours du champ pour des clowns comme les Casini, les Veltroni, les Vendola, etc.
A côté de cet affaiblissement du vote compulsif, ou notera un second aspect de l’américanisation : le déclin des débats sur la politique extérieure. Aux USA, il est naturel que les gens ne sachent pas où sont l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie, etc. , dont les bombardements sont confiés à d’obscurs spécialistes. Les temps où tous s’intéressaient à la Corée ou au Vietnam sont bien passés, irréversiblement. Toute la caste journalistique, sans aucune exception, est devenus une parfaite machine de guerre qui produit joyeusement du mensonge.
Au temps de la guerre du golfe de 1991, il y avait encore de la discussion ; puis elle s’est tue. On a eu alors ce que Carl Schmitt a appelé la reductio ad hitlerum, c'est-à-dire l’attribution de tous les malheurs du monde à de féroces dictateurs, et l’invention (dont l’origine est « de gauche ») de peuples unis contre les dictateurs. Les peuples furent médiatiquement unis contre des Hitler toujours nouveaux, ennemis des droits de l’homme. Le jeu commença avec Caucescu, continua avec Noriega, puis ce furent Saddam Hussein, Ahmadinejad, Milosevic, Kadhafi, et maintenant Assad. L’histoire a été abolie; on l’a remplacée par un argument de comédie, toujours le même : un peuple uni contre le féroce dictateur ; le silence coupable de l’Occident ; les « bons » dissidents, auxquels est réservé le droit à la parole. Depuis un an, je n’ai jamais entendu à la télévision manipulée un seul partisan de Assad, et pourtant, la Syrie en est pleine.
C’est seulement lorsque le jeu se durcit qu’il importe que les durs commencent à jouer. Tant que règne la comédie italienne de la parodie Droite/Gauche, il en est toujours comme de ces spectacles de catch américain où tout n’est que simulation devant des spectateurs idiots.
Etat national, souveraineté nationale, programme de solidarité de la communauté nationale, non à la globalisation sous toutes ses formes, et à la dictature des économistes anglophones !
Turin, le 3 mars 2012.
Costanzo Preve
Traduit de l’italien par Yves Branca.
Notes:
(1) : Norberto Bobbio, 1909-2004. turinois, professeur de philosophie politique socialiste, célèbre en Italie. Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en français. Signalons, Droite et gauche, Paris, Le Seuil, 1996 ; L'État et la démocratie internationale. De l'histoire des idées à la science politique, Bruxelles, Complexe, 1999. Ce dernier ouvrage est considéré comme son œuvre majeure. Costanzo Preve a correspondu avec lui et a écrit une étude critique courtoise, mais radicale, de sa pensée, comme forme classique d’un politiquement correct de gauche : Les contradictions de Norberto Bobbio. Pour une critique du bobbioisme cérémoniel, Petite plaisance, 2004.
(2) : Fondé en 2007, par une coalition de divers courants de gauche et centristes (démocrates chrétiens) ; d’une tonalité analogue au Nouveau Centre de l’UMP en France.
(3) : respectivement trotskiste à la manière du Parti des travailleurs ou de Lutte ouvrière, et refondateur communiste. Susceptibles de s’unir dans une sorte de « front de gauche » à l’italienne. Diliberto et Ferrero cités auparavant sont les chefs de file d’autres courants gauchistes et « refondateurs communistes ».
(4) : Preve a quant à lui retrouvé l’inspiration aristotélicienne; à ses yeux, la communauté est la société même.