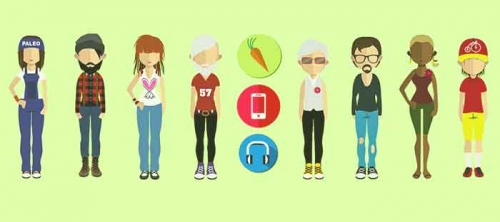Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Michel Geoffroy, cueilli sur Polémia et consacré à la politique de Jean-Michel Blanquer à la tête du Ministère de l’Éducation nationale. Ancien haut-fonctionnaire, Michel Geoffroy a récemment publié La Superclasse mondiale contre les peuples (Via Romana, 2018).
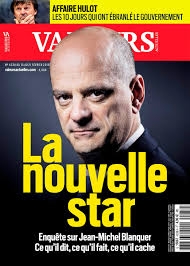
Une couverture de Valeurs Actuelles datant de février 2018...
Claude Meunier-Berthelot annonce la fin de la Blanquer-mania
Le livre de Claude Meunier-Berthelot, Blanquer, ce monstre froid – Remède de cheval contre la « blanquer-mania »[1], arrive à point nommé au moment où le ministre de l’Education nationale – la bien mal nommée – annonce son intention catastrophique d’encourager l’enseignement de l’arabe à l’école.
Car Claude Meunier-Berthelot dénonce dans cet essai vigoureux, mais aussi rigoureux, l’escroquerie politique et pédagogique incarnée par Jean Michel Blanquer, le ministre qu’adule une certaine droite qui ne sait pas aller plus loin que les déclarations d’intentions relayées par des médias complaisants.
Claude Meunier-Berthelot sait de quoi elle parle : elle connaît le Mammouth de l’intérieur et a déjà écrit de nombreuses études dénonçant l’entreprise de déracinement qu’est devenue d’Education nationale, notamment depuis la loi de « refondation de l’école » de 2013.
L’analyse clinique de la manipulation
Son essai est de nature clinique : il en a la sèche objectivité, sans fioritures inutiles.
Point par point, depuis l’école maternelle jusqu’à ParcourSup, en passant par la laïcité, l’autonomie des établissements ou les écoles hors contrat, Claude Meunier-Berthelot met en effet en regard des affirmations ministérielles, la réalité des circulaires, des budgets et du fonctionnement de l’Education Nationale. C’est plus qu’un essai de 171 pages : c’est à une véritable dissection que l’auteur nous invite, décryptant et démontant chaque composante de l’escroquerie Blanquer.
Avec un remarquable esprit de synthèse, Claude Meunier-Berthelot démontre le double langage permanent du ministre. Car en digne représentant de la macronie, Jean Michel Blanquer est avant tout passé maître dans l’art de la communication, c’est-à-dire de l’enfumage médiatique de la population. Car il dirige surtout le ministère de la parole.
Blanquer, le ministre du statu quo
Claude Meunier-Berthelot nous montre que Jean-Michel Blanquer, homme du Système, ne change rien du tout, sinon dans le mauvais sens. Il ne fait que poursuivre la ligne de ses prédécesseurs dont il constitue un nouveau clone.
Il ne remet pas en cause, notamment, le cadre dressé par le vieux Plan Langevin Wallon d’inspiration communiste de 1947 et par la loi de refondation de l’école de 2013 élaborée par le socialiste Vincent Peillon, le ministre qui voulait « arracher » l’enfant de toutes ses « servitudes » pour lui inculquer les droits de l’homme.
L’enfumage médiatique permanent
La première méthode d’enfumage du ministre consiste à affirmer devant les caméras des orientations qui paraissent souhaitables : par exemple le port de l’uniforme ou la méthode d’enseignement de la lecture.
Tout le microcosme médiatique, complice, se met alors à gloser sur l’audace ministérielle afin de faire croire que de simples propos correspondraient à une véritable volonté politique et ensuite à une réalité sur le terrain.
Mais ensuite rien ne se passe : aucun texte, aucun cadrage national, ne vient confirmer les propos du ministre. Et si la rue de Grenelle accouche finalement d’une circulaire, celle-ci remettra les vagues intentions ministérielles dans le droit fil du pédagogiquement correct.
Claude Meunier-Berthelot montre par exemple dans le détail comment Jean Michel Blanquer a trompé son monde sur la question de la méthode d’apprentissage de la lecture : car la méthode « syllabique » qu’il présente comme une alternative à la méthode « globale » n’est en réalité… qu’un succédané de cette dernière, comme l’illustre l’analyse précise de la circulaire du 26 avril 2018 à laquelle se livre l’auteur.
Blanquer : le ministre des Autres
La seconde manipulation, la plus lourde de conséquences, consiste à passer sous silence que l’essentiel des réformes destinées à améliorer la qualité de l’enseignement public annoncées par Jean Michel Blanquer, ne concernent en réalité… que les zones classées REP et REP+[2] ! C’est-à-dire les zones où sont scolarisés en majorité les enfants issus de l’immigration légale ou non, ceux que l’Education Nationale appelle du doux euphémisme : EANA – élèves allophones nouvellement arrivés.
Conformément au programme présidentiel d’Emmanuel Macron, le ministre Blanquer organise en effet cyniquement une école à deux vitesses, mais bien sûr au nom de l’égalité !
D’une part une école qui enseigne les savoirs mais avant tout pour les enfants des immigrants et qui vampirise les moyens budgétaires et humains notamment à cause du dédoublement des classes de CP.
On ferme ainsi des « moyens d’enseignement » – donc des classes – dans la France profonde pour financer de dédoublement des CP dans les banlieues de l’immigration. Car cette école des REP et des REP + bénéficie de toutes les attentions ministérielles et présidentielles. Les banlieues de l’immigration ne sont-elles pas une… chance pour la France ?
L’enseignement de l’ignorance pour les petits Français
Et de l’autre côté, l’école des petits français souchiens, devenue une garderie (un lieu de vie) où l’on n’enseigne pas grand-chose car on continue d’y appliquer tous les délires pédagogiques et où l’on met des enseignants à la qualification déclinante[3]: transversalité, interdisciplinarité, « construction » des savoirs par les élèves eux-mêmes par le moyen de « parcours » sont les maîtres mots de cette nouvelle garderie. Mais une garderie où l’on veille surtout à diffuser la doxa bien-pensante, repentante, droit de l’hommiste et LGBT friendly auprès des futurs électeurs….
Mais cela ne gêne pas l’oligarchie, bien au contraire.
Car comme le montre Claude Meunier-Berthelot, citant Rousseau, l’ignorance ouvre justement la voie à la sujétion des Européens : « Le pauvre enfant qui ne sait rien, qui ne peut rien , qui ne connaît rien , n’est-il pas à votre merci ? »
La destruction du savoir c’est-à-dire de la transmission de la culture et de l’identité par l’Education nationale ne résulte pas d’un accident de parcours, mais bien d’une volonté politique : celle qui programme la mise en servitude des autochtones.
La fin de la Blanquer-mania
Il faut donc lire le livre de Claude Meunier-Berthelot car il constitue un exemplaire et salutaire exercice de décryptage de l’enfumage macronien, d’autant plus salutaire qu’une partie de l’opinion de droite – généralement ignorante des questions d’éducation – s’est laissée prendre à l’habile communication de Jean-Michel Blanquer.
Comme la Macron-mania n’est désormais qu’un lointain souvenir quand les sondages montrent que deux Français sur trois désapprouvent l’action et le comportement du président de la république, Claude Meunier-Berthelot nous annonce maintenant la fin de la Blanquer-mania.
Et c’est une bonne nouvelle.
Michel Geoffroy (Polémia, 23 septembre 2018)
« Blanquer, ce monstre froid » – Remède de cheval contre la blanquer-mania – Editions des Trianons
[1] Editions des Trianons 2018, avec une préface de François Billot de LOCHNER ;
[2]Réseaux d’éducation prioritaire et réseaux d’éducation prioritaire renforcée ; il y en a environ 1200 REP
[3] « emploi-avenir-professeur », « contrat de service civique » et autre « réserve citoyenne »