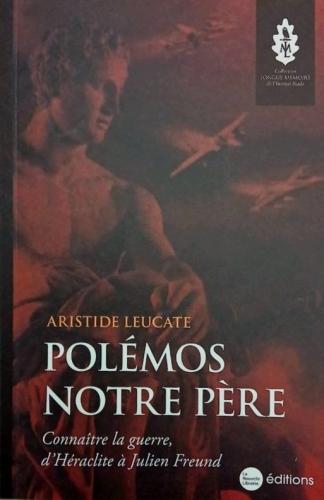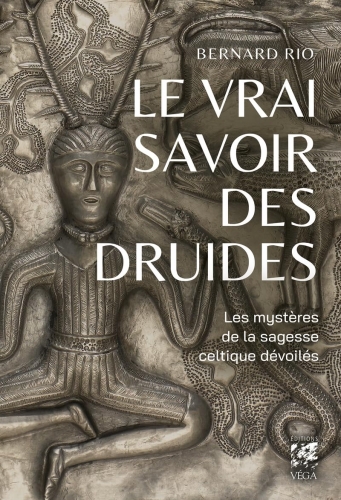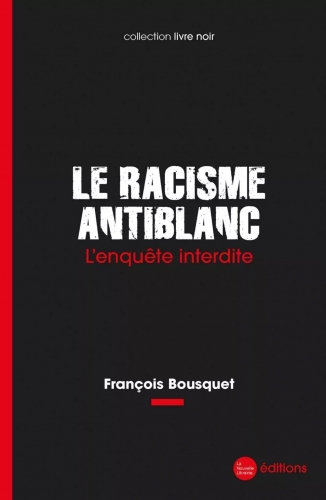« Une décision de justice n’est jamais politique… » Ainsi s’est exprimé, ces jours derniers, non pas Zarathoustra mais, nettement moins célèbre jusqu’il y a peu, M. Aurélien Martini, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale des magistrats (USM), organisation majoritaire au sein de l’honorable corporation des juges. M. Martini entendait-il concourir aux prochains Molière de la profession, dans la catégorie « Tartufferies » ? Les magistrats qui, après avoir tous (à deux exceptions près) prêté serment de fidélité au maréchal Pétain, siégèrent et statuèrent dans les trop fameuses sections spéciales de Vichy, ceux (parfois les mêmes) qui jugèrent et condamnèrent, à la Libération, à la Haute Cour de justice ou dans les chambres civiques de l’épuration, ceux qui siégèrent, de 1954 à 1962, dans les tribunaux devant lesquels comparurent les militants du FLN, puis les chefs et les soldats de l’OAS, auraient été plus que surpris par le plaider non coupable de M. Martini.
Disons-le simplement : les trois juges qui viennent de confirmer les réquisitions déjà exceptionnellement sévères du parquet dans l’affaire des assistants parlementaires du FN ne prétendaient nullement diriger le procès et rendre leur sentence depuis la lointaine, étincelante et impartiale étoile Sirius, mais bien au contraire accomplir un devoir civique dont elles étaient les premières à proclamer les motifs, à revendiquer la légitimité, à prévoir et à assumer les conséquences sur l’élection présidentielle à venir, c’est-à-dire sur l’orientation de la vie politique de notre pays, en fonction de la personne, des idées et du programme de celui – en l’occurrence de celle - à qui le peuple français pourrait librement et souverainement confier, au plus tard en 2027, les rênes du pouvoir.
Des sanctions lourdes
L’arrêt rendu par Mme Bénédicte de Perthuis et ses deux « assesseuses » comporte deux volets bien distincts dans leur nature et dans leurs suites. D’une part, des peines de prison, des amendes lourdes, des restrictions aux droits civiques, sanctions lourdes et globalement conformes aux réquisitions des procureurs, mais dont on ne saurait contester qu’elles sont prévues par les dispositions de la loi que les accusés s’étaient bien légèrement dispensés de respecter. Même si la loi Sapin II ignore superbement la nature de la vie politique, la réalité des rapports entre les élus assistés et les militants qui les assistent, à telle enseigne qu’elle a été violée, à peine entrée en vigueur, par des partis et des dirigeants aussi divers que Bayrou et son MoDem, Mélenchon et son Parti de gauche, Jean-Marie puis Marine Le Pen et le FN de l’époque. Même si le séisme déclenché par l’arrêt des trois Parques a fait ressortir la nécessité, voire l’urgence, de revenir sur le contenu d’un texte conçu et voté en urgence dans la foulée de l’affaire Cahuzac, on ne peut dire, si sévères qu’aient été les juges, qu’ils aient outrepassé les pouvoirs que leur conférait la loi.
Il n’en est évidemment pas de même du point désormais central, du point désormais litigieux qui est au centre du verdict rendu, lundi dernier, par la 11e chambre correctionnelle, à savoir l’exécution provisoire (provisoire, en l’espèce, ressemble fort à un synonyme de définitif) de la peine d’inéligibilité effectivement prévue, mais sans obligation, par la loi.
On ne fera pas l’injure à trois magistrates expérimentées et parfaitement conscientes des enjeux en cours de leur accorder la moindre circonstance atténuante, ignorance du dossier ou de leur responsabilité. L’inéligibilité de Marine Le Pen était certes automatiquement liée à sa condamnation, sauf à l’en dispenser en fonction de critères spécifiques. Or, ces critères étaient patents, et connus de tous. Comme la majorité des Français, comme la totalité de la classe politique, comme tous ceux - juges, avocats, journalistes, simples militants, grand public - qui avaient suivi le procès dont elles maîtrisaient pleinement le dossier, les trois juges savaient pertinemment que la présidente du RN, désormais le premier parti de France, trois fois candidate à la présidence de la République, deux fois finaliste et battue seulement au second tour, était lors de la prochaine échéance assurée d’arriver en tête au premier et susceptible de l’emporter au second. Le tribunal a décidé de passer outre la réalité, quitte à sortir de la neutralité inhérente à sa mission et, donc, d’y perdre sa légitimité. Son verdict constitue une immixtion délibérée, brutale, grossière et insupportable du judiciaire dans le politique, au mépris du principe fondamental de la séparation des pouvoirs.
Trouble à l’ordre public ?
En tant que citoyennes, les trois magistrates ont bien entendu (et gardent) le droit d’avoir leurs choix personnels, leurs sympathies, leurs préférences et leurs détestations. En tant que juges, elles avaient le devoir de les oublier. Ce qu’elles n’ont pas fait, comme en attestent des attendus qui, relevant visiblement de leurs opinions, interfèrent dans une sphère dont la justice, dans une démocratie, devrait s’interdire l’accès. Si Marine Le Pen est seule, pour l’instant, à être durement frappée, ce sont au minimum entre onze et quinze millions d’électeurs, voire davantage, et peut-être même la majorité, dont trois personnes, chargées de rendre la justice, se sont permis de restreindre avec leur liberté de choix les droits civiques. Cet attentat, pour n’être pas physiquement violent, n’en constitue pas moins une atteinte, aussi grave et aussi lourde de conséquences que le geste meurtrier d’un terroriste à la régularité, à la crédibilité et donc à la légitimité du processus déjà engagé dans la perspective de l’élection qui est et demeure la clef de voûte de nos institutions.
Au premier rang des attendus qui prétendent justifier l’intrusion éhontée et calamiteuse de la 11e chambre correctionnelle dans un paysage politique déjà tourmenté figure la crainte du supposé « trouble à l’ordre public » que constituerait la quatrième tentative de Marine Le Pen de solliciter pacifiquement l’onction du suffrage universel. Le trouble à l’ordre public ? Nous y sommes du fait de trois apprenties sorcières. L’éventuelle conjonction des deux oppositions de droite et de gauche faisait déjà planer une menace permanente sur le gouvernement titubant de François Bayrou. L’éventuelle éviction de Marine Le Pen ne fait qu’ajouter de la fragilité à la fragilité. Deux épées de Damoclès, c’est beaucoup, pour une seule République. C’est trop.
Dominique Jamet (Boulevard Voltaire, 4 avril 2025)