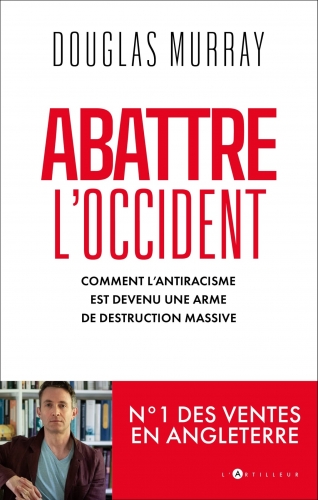Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné à la revue Conflits par Arnaud Imatz, le préfacier de l'essai historique de Pio Moa, Les mythes de la guerre d'Espagne (L'Artilleur, 2022).
Fonctionnaire international à l’O.C.D.E. puis administrateur d’entreprise, spécialiste de l'Espagne, Arnaud Imatz a notamment publié La Guerre d’Espagne revisitée (Economica, 1993), Par delà droite et gauche (Godefroy de Bouillon, 1996) et José Antonio et la Phalange Espagnole (Godefroy de Bouillon, 2000) et Droite - Gauche : pour sortir de l'équivoque (Pierre-Guillaume de Roux, 2016).

Pío Moa et les mythes de la Guerre d’Espagne. Entretien avec Arnaud Imatz
Comment analyser la guerre civile espagnole, au-delà des mythes et des passions politiques ? Comment effectuer un travail d’historien car l’histoire est encore chaude et soumise aux passions de la mémoire et des jeux partisans ? C’est tout le travail exercé par Pio Moa dans son livre sur les mythes de la guerre d’Espagne, dont la traduction vient de paraitre en français. L’ouvrage est préfacé par Arnaud Imatz, membre correspondant de l’Académie royale d’histoire d’Espagne, historien, auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’Espagne
Vous avez accepté de préfacer la traduction française du dernier livre à succès de l’historien espagnol Pio Moa. Son travail est-il rigoureux, et si oui, pourquoi suscite-t-il la polémique en France après un entretien dans le Figaro histoire ?
A.I. : J’ai préfacé ce livre pour une série de raisons, générales et particulières. La première tient, je crois, à la conception de l’histoire des idées et des faits qui m’a été transmise par mes maîtres à une époque déjà lointaine – les années 1970 – lorsque je préparais ma thèse de doctorat d’État de sciences politiques. Mes maîtres m’avaient alors appris que la qualité de la recherche historique (qui ne se confond pas avec la mémoire historique, vision émotionnelle et réductrice de l’histoire) dépend à la fois de la formation de l’auteur, de sa curiosité intellectuelle, de sa capacité de discernement, de sa créativité, de sa conscience et de son intégrité morale. Ils m’avaient inculqué l’idée que l’historien doit chercher ardemment la vérité tout en sachant qu’il n’y parviendra que partiellement. Ils m’avaient aussi convaincu que tout ici est affaire de subtilité, de degré, de nuances, de bon sens et d’honnêteté.
Ayant été d’abord, en quelque sorte, une victime collatérale du lynchage médiatique subi par Moa en Espagne, j’ai mis des années avant de me décider à dépasser mes préjugés pour lire cet auteur étiqueté « sulfureux ». Une démarche que les censeurs de Moa – pour la plupart des universitaires socialo-marxistes favorables au Front populaire, mais aussi des « spécialistes » soucieux de leur promotion, pour ne pas parler des légions de néo-inquisiteurs qui sévissent aujourd’hui sur les réseaux sociaux – refusent obstinément de faire. On ne se commet pas avec le diable ! Pour ma part, je suis ressorti, je l’avoue, impressionné et étonné par cette lecture de Moa, et surtout avec la ferme conviction que contrairement à beaucoup de ses contempteurs, il remplit les critères de l’historien honnête, intègre et désintéressé.
Il me faut bien sûr évoquer ici mon intérêt spécial pour la Guerre civile espagnole. Cet intérêt ne s’est jamais démenti depuis près d’un demi-siècle. Il m’a conduit à publier d’abord une thèse de doctorat d’État sur le fondateur de la Phalange, José Antonio Primo de Rivera, plus tard préfacée par le prestigieux économiste et académicien espagnol, Juan Velarde Fuertes ; à publier ensuite un livre préfacé par Pierre Chaunu, membre de l’Institut de France (La guerre d’Espagne revisitée, 1989), puis, à préfacer moi-même le livre d’un des meilleurs spécialistes du thème, injustement victime en France d’une véritable omerta pendant près de quarante-cinq ans, l’Américain Stanley Payne (La guerre d’Espagne. L’histoire face à la confusion mémorielle, 2010), et enfin, à multiplier les articles sur le sujet au cours des années 2000-2020. Cela dit, il y a bien sûr, parmi les raisons de mon intérêt, celles qui tiennent spécifiquement au cas particulier de la vie et de l’œuvre de Moa.
Moa est la bête noire de la gauche, de l’extrême gauche et d’une bonne partie de la droite. La haine et les insultes dont il est périodiquement l’objet, dans les milieux journalistiques, mais aussi universitaires, sont proprement sidérants. Il est « l’incarnation du mal », un « négationniste », un « révisionniste dangereux », un « fasciste », un « nazi camouflé », un « auteur médiocre », un « historien dépourvu de méthodologie », « un pseudo-historien qui n’est pas universitaire », « un écrivain sans aucune perspicacité ni culture », « un provocateur », « un menteur » dont « l’indigence intellectuelle est reconnue », pire, un « agent camouflé de la police franquiste ». Les adeptes de l’attaque ad hominem s’en donnent avec lui à cœur joie. Pour les plus excités, il n’est rien moins qu’un « apologiste des crimes de l’humanité ». Les raccourcis infamants, les injures, les invectives et les calomnies, tout a été bon pour le faire taire dans la Péninsule et les polémiques qu’il suscite aujourd’hui dans l’Hexagone, après son intéressant et complet entretien dans le Figaro histoire (été 2022), ne peuvent en donner qu’un faible écho.
Mais la question Moa n’est pas aussi simple que le laissent accroire ses nombreux détracteurs qui ont pour habitude de confondre, plus ou moins consciemment, la diatribe avec le débat. Démocrate-libéral déclaré, Pío Moa a manifesté à plusieurs reprises son respect et sa défense de la Constitution de 1978. C’est donc en réalité son passé et son parcours atypique – sacrilège absolu aux yeux des socialistes-marxistes et autres crypto-marxistes – qui lui sont secrètement et invariablement reprochés. Il a d’abord été communiste-maoïste sous le régime de Franco. Il appartenait alors au mouvement terroriste du GRAPO bras armé du PCr (le Parti communiste reconstitué). Il n’était pas un militant antifranquiste d’opérette, comme le sont aujourd’hui tant d’intellectuels et de politiciens bien établis, mais un résistant armé et déterminé, prêt à mourir pour sa cause. C’est d’ailleurs en sa qualité de marxiste, combattant contre le franquisme, d’homme de gauche insoupçonnable, et de bibliothécaire de l’Ateneo de Madrid, qu’il a eu accès à la documentation de la Fondation socialiste Pablo Iglesias. Cette recherche a été la source principale de son premier livre, véritable bombe médiatique : Los orígenes de la guerra civil española (1999).
Après avoir dépouillé et étudié minutieusement ces archives socialistes, Moa a changé radicalement d’idées, n´hésitant pas à sacrifier pour elles son avenir professionnel et sa vie sociale. Il a découvert l’écrasante responsabilité du parti socialiste et de la gauche en général dans le putsch de 1934, et dans les origines de la guerre civile. On parlait jusqu’alors de « Grève des Asturies » ou de « Révolution de Asturies », après son livre on parle de « Révolution socialiste de 1934 ». J’ai raconté en détail dans ma préface l’histoire étonnante de son premier livre à succès. Mais c’est son best-seller, Los mitos de la guerra civil, publié en 2003, réimprimé ou réédité une vingtaine de fois, vendu à plus de 300 000 exemplaires, numéro un des ventes en Espagne pendant plus de six mois, qui a suscité la colère proprement hallucinante des médias « mainstream ». Par la voix de l’historien démocrate-chrétien, Javier Tussell, le journal socialiste, El País, a demandé la censure pour l’insupportable « révisionniste », des syndicats ont protesté devant les Cortès, une campagne de propagande hystérique a même suggéré l’incarcération et la rééducation du coupable. Depuis Moa est persona non grata dans les Universités d’État et les médias du service public.
Dès lors, rares ont été les universitaires, académiciens et historiens indépendants qui ont osé prendre parti pour Moa. Certains sont cependant fameux. On peut citer notamment : Hugh Thomas, José Manuel Cuenca Toribio, Carlos Seco Serrano, César Vidal, José Luis Orella, Jesús Larrazabal, José María Marco, Manuel Alvarez Tardío, Alfonso Bullón de Mendoza., José Andrés Gallego, David Gress, Robert Stradling, Richard Robinson, Sergio Fernandez Riquelme, Ricardo de la Cierva, etc. Il y a aussi l’un des plus prestigieux spécialistes, l’Américain Stanley Payne, qui a écrit ces quelques mots particulièrement justes et instructifs :
« L’œuvre de Pío Moa est novatrice. Elle introduit un peu d’air frais dans une zone vitale de l’historiographie contemporaine espagnole, qui était enfermée, depuis trop longtemps, dans d’étroites monographies formelles, vétustes, stéréotypées, soumises à la correction politique. Ceux qui divergent de Moa doivent affronter son œuvre sérieusement. Ils doivent démontrer leur désaccord par la recherche historique et l’analyse rigoureuse et cesser de dénoncer son œuvre en utilisant la censure, le silence et la diatribe, ces méthodes qui sont davantage le propre de l’Italie fasciste et de l’Union soviétique que de l’Espagne démocratique ».
Mais cette exhortation, propre d’un esprit ouvert et raisonnable, n’a bien évidemment jamais été entendue.
Il y a une autre raison importante qui explique mon intérêt pour la publication de la version française du best-seller de Pío Moa : la défense de la liberté d’expression, le combat contre toute forme de censure et de vérité officielle, la résistance face à la montée du manichéisme totalitaire. Pío Moa ne cache pas sa sympathie pour Gil Robles, leader de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) sous la IIe République. Une sympathie pour le leader du parti conservateur libéral espagnol des années trente que je ne partage pas, pas plus que je ne partage sa justification, à mon sens excessive, des longues années de dictature franquiste. Il est vrai que Français, je ne suis ni franquiste, ni antifranquiste, mais un historien des idées et des faits, passionné par l’histoire du monde hispanique. Mais cela dit, je ne confonds pas les recherches de l’historien Moa avec ses analyses politiques, ses interprétations et ses commentaires au quotidien dans lesquels il donne libre cours à son esprit combatif, à ses penchants pour la polémique et le goût de la diatribe, hérités, pour le bien et pour le mal, de son passé de clandestin et de sa solide formation marxiste. Je suis d’accord avec lui pour dire que la guerre civile et le régime de Franco sont des faits distincts qui, en tant que tels, peuvent être jugés et interprétés de manière très différentes. Je suis aussi d’accord avec lui pour dénoncer le raisonnement foncièrement subjectif et faux selon lequel la Seconde république, qui serait le mythe fondateur de la démocratie espagnole postfranquiste, aurait été un régime presque parfait dans lequel l’ensemble des partis de gauche aurait eu une action irréprochable.
Il y a enfin une dernière raison qui m’a conduit à m’investir directement dans la publication du bestseller de Moa. En 2005, les éditions Tallandier se sont portées acquéreuses des droits de Los mitos de la Guerra Civil. La publication de la version française était prévue pour 2006. Le traducteur avait été engagé, l’ouvrage et son isbn annoncés chez les libraires. Mais étrangement la date de sortie a été reportée et, finalement, l’édition a été déprogrammée sans la moindre explication. En février 2008, lors d’une émission sur la chaîne française Histoire (alors dirigée par Patrick Buisson), consacrée à la Guerre d’Espagne, à laquelle je participais en compagnie de Anne Hidalgo, Éric Zemmour, Bartholomé Bennassar et François Godicheau, j’ai eu la surprise d’apprendre qu’un autre livre sur la Guerre d’Espagne venait d’être publié chez Tallandier. Il s’agissait des actes du colloque Passé et actualité de la guerre d’Espagne, dirigé par le spécialiste du PCF, ancien rédacteur en chef de la revue d’inspiration marxiste, Les Cahiers d’histoire, Roger Bourderon, précédés du discours d’ouverture d’Anne Hidalgo, alors première adjointe du maire de Paris. C’est bien après avoir été mis au courant de cette étonnante expérience, que j’ai décidé de m’impliquer directement dans la recherche d’un nouvel éditeur. Le lecteur francophone aura donc attendu quinze ans de plus, pour avoir enfin accès à cet ouvrage. Gageons qu’il n’aurait probablement pas vu le jour sans l’ouverture d’esprit, l’indépendance et le courage intellectuel de la direction des Éditions l’Artilleur / Toucan.
Vous êtes-vous aussi un spécialiste de la période, Quelles nouveautés apporte le livre à l’historiographie de la guerre civile ?
On entend souvent dire que Moa n’apporte rien de nouveau, rien de plus que ce qui a été dit avant lui par des auteurs favorables au camp national ou au camp « franquiste », comme le premier ministre de la culture du roi Juan Carlos, Ricardo de la Cierva, ou Jesús Larrazabal et Enrique Barco Teruel, voire par des auteurs antifranquistes, tels Gabriel Jackson, Antonio Ramos Oliveira, Claudio Sánchez Albornoz ou Gerald Brenan. Peut-être, mais aucun d’entre eux n’a jamais eu l’aura de Pío Moa dans l’opinion publique. Il faut par ailleurs distinguer ses travaux de recherche [avec ses premiers livres très sourcés et documentés de la trilogie, Los origines de la Guerra Civil, Los personajes de la República vistos por ellos mismos et El derrumbe de la Republica y la Guerra Civil / Les origines de la guerre civile, Les personnages de la République vus par eux-mêmes et L’effondrement de la République] de son effort de synthèse réussi que constitue Les mythes de la guerre d’Espagne.
Mais l’élément le plus novateur de son œuvre, celui qui n’a pas manqué de faire grincer les dents de ses adversaires est, répétons-le, la divulgation des archives du parti socialiste, un parti totalement bolchevisé à partir de la fin de 1933, et qui est le principal responsable du putsch de 1934. Bien des auteurs en avaient eu l’intuition avant lui. L’antifranquiste Salvador de Madariaga avait même écrit : « Avec la rébellion de 1934, la gauche espagnole a perdu jusqu’à l’ombre d’autorité morale pour condamner la rébellion de 1936 ». Et ces propos sévères avaient été corroborés par les Pères fondateurs de la République, Marañon, Ortega y Gasset et Perez d’Ayala, voire par le philosophe basque Unamuno. On savait aussi que Largo Caballero, principal leader socialiste, surnommé le Lénine espagnol par les jeunesses socialistes (lesquelles fusionnèrent avec les jeunesses communistes au printemps 1936) avait déclaré «Nous ne nous différencions en rien des communistes » « L’essentiel, la conquête du pouvoir ne peut se faire par la démocratie bourgeoise » « Les élections ne sont qu’une étape de la conquête du pouvoir et leur résultat ne s’accepte que sous bénéfice d’inventaire… si la droite gagne nous devrons aller à la guerre civile », ou encore, lisez bien : « Quand le Front populaire s’écroulera, comme cela se produira sans doute, le triomphe du prolétariat sera indiscutable. Nous implanterons alors la dictature du prolétariat ». Mais depuis l’exploitation systématique et la divulgation publique des archives de la Fondation socialiste Pablo Iglesias par Moa, en 1999, le doute n’est plus permis.
Franco est dépeint comme entrant dans la guerre presque contre son gré, n’est-ce pas un peu exagéré, les communistes ont ils le monopole de la responsabilité historique de la guerre ?
Les trois principaux responsables de la guerre d’Espagne sont dans l’ordre : le leader socialiste Largo Caballero et les présidents Azaña et Alcala-Zamora lesquels auront par la suite des mots terribles pour qualifier le Front populaire. Franco a été longtemps, au moins jusqu’au début du mois de juillet 1936, le général qui refusait l’idée d’un coup d’État. Il semble que l’assassinat d’un des leaders de la droite, Calvo Sotelo, a été l’événement déterminant dans sa décision finale de participer. Le rôle des communistes, qui plus tard a été essentiel, était relativement marginal à la veille du soulèvement. La thèse de Moa sur les antécédents et le déroulement de la guerre civile est globalement juste. Les principaux partis et leaders de gauche, prétendument défenseurs de la République, ont violé la légalité républicaine en 1934. Ils ont alors planifié la guerre civile dans toute l’Espagne. Ils ont ensuite achevé de la détruire lors des élections frauduleuses de février 1936, écrasant la liberté dès leur prise du pouvoir. Je vous renvoie ici aux travaux incontournables de Roberto Villa García et Manuel Álvarez (1936 : Fraude y violencia en las elecciones del Frente popular, 2019), sur les fraudes et les violences du Front Populaire lors des élections de février 1936 (sans les 50 sièges dont la droite a été spoliée par un véritable coup d’État parlementaire, la gauche n’aurait jamais pu gouverner seule).
La guerre civile n’était pas un combat des démocrates contre les fascistes pas plus qu’elle n’était le combat des rouges contre les défenseurs de la chrétienté. Il y avait en réalité trois forces inégales dans le camp Républicain ou plutôt le Front populaire : la première, de très loin la plus importante, comprenait les communistes, les trotskistes, les socialistes bolchevisés et les anarchistes, qui aspiraient à implanter un régime de type démocratie populaire sur le modèle soviétique et/ou collectiviste anarchiste; la seconde, regroupait les nationalistes-séparatistes (catalans, basques, galiciens, etc.), qui voulaient l’indépendance pour leurs peuples ; et enfin, la troisième, beaucoup plus minoritaire, qui réunissait les partis de la gauche bourgeoise-jacobine ou social-démocrate, lesquels faisaient volontairement ou involontairement le jeu de la première force. On ne saurait trop souligner que le Front populaire français était très modéré en comparaison du Front populaire espagnol, coalition de gauche dominée à la veille du soulèvement, par un parti socialiste bolchevisé, extrémiste, violent, putschiste et révolutionnaire.
Il y avait aussi dans l’autre camp, le camp national et non pas nationaliste comme le répètent les médias français par ignorance ou réflexe pavlovien, plusieurs tendances politiques qui allaient des centristes-radicaux (dont un groupe d’ex-ministres furent exécutés par le Front populaire), aux républicains-démocrates, agrariens, libéraux et conservateurs, en passant par les monarchistes libéraux, les monarchistes-carlistes/traditionalistes, les phalangistes et les nationalistes. Le confit opposait des « totalitaristes » de gauche à des « autoritaristes » de droite, et de part et d’autre les véritables démocrates brillaient par leur absence.
Le mouvement Vox tente de défendre les aspects positifs de l’héritage franquiste et le livre de Moa se vend très bien. L’Espagne est-elle en train de réhabiliter Franco, est-elle mûre pour regarder son histoire avec objectivité ?
Les aspects positifs et négatifs du régime de Franco sont connus des historiens. Au nombre des erreurs que l’on peut reprocher au Caudillo et aux partisans du franquisme, il y a en particulier : la censure drastique appliquée jusqu’au début des années 1960, la dureté de la répression de l’immédiat après-guerre civile (non pas les 100 000 voire 200 000 exécutés selon la propagande du Komintern, mais 14 000 exécutés judiciairement et près de 5 000 règlements de compte ou assassinats politiques extrajudiciaires) et la volonté inflexible du Caudillo de se maintenir au pouvoir jusqu’au bout. Le mouvement Vox, généralement qualifié de populiste, bien qu’il s’agisse en réalité d’un parti libéral-conservateur pro-européen, est en effet actuellement le seul parti qui tente de défendre les aspects positifs du franquisme que sont : les succès économiques indiscutables entre 1961 et 1975 (les années du « miracle espagnol », avec une croissance du PIB qui a oscillé entre 3,5% et 12, 8% ce qui a permis à l’Espagne se hisser au 9e rang des nations industrialisées alors qu’elle est aujourd’hui au 14e rang); ensuite, le fait que Franco et les franquistes ont vaincu le communisme (minoritaire au début de la guerre civile, mais devenu hégémonique au cours du conflit), qu’ils ont aussi permis à l’Espagne (d’abord neutre puis non-belligérante) d’échapper à la deuxième guerre mondiale et enfin, qu’ils ont enrayé le séparatisme et sauvé l’unité du pays. C’est par ailleurs, la droite modérée franquiste qui a pris l’initiative d’instaurer la démocratie, la gauche ayant eu l’intelligence politique de s’adapter et de contribuer à consolider la démocratie.
Il n’y a pas 36 manières de sortir d’une guerre civile, il n’y en a qu’une : l’amnistie totale et sans réserve. Cela les acteurs de la transition démocratique (1975-1986) le savaient. C’est pourquoi les Cortès démocratiques (dans lesquelles siégeaient la Pasionaria, Santiago Carrillo et Rafael Alberti pour ne citer qu’eux) avaient adopté le 15 octobre 1977 une loi d’amnistie pour tous les crimes politiques et actes terroristes de droite comme de gauche (notamment ceux de l’ETA et de l’extrême gauche). Deux principes animaient alors l’immense majorité de la classe politique : le pardon réciproque et la concertation entre gouvernement et opposition. Il ne s’agissait pas d’imposer le silence aux historiens et aux journalistes, mais de les laisser débattre entre eux librement en se gardant d’instrumentaliser leurs travaux à des fins politiques. Depuis lors, bien de l’eau est passée sous les ponts. Des lois mémorielles (« loi de mémoire historique » de Zapatero en 2007 et projet imminent de « loi de mémoire démocratique » de la coalition de Pedro Sánchez – PSOE/PSC, Podemos/CatComú, PCE/IU, en 2022), ont été adoptées théoriquement pour lutter contre « l’apologie du franquisme, de la violence et de la haine », mais en réalité étant d’essence totalitaire elles sont pratiquement liberticides. Les autorités espagnoles ne semblent plus vouloir rechercher la paix sociale qu’à travers la division, l’agitation, la provocation, le ressentiment et la haine. L’Espagne est bien loin d’essayer de panser définitivement ses plaies et de regarder son histoire avec honnêteté, rigueur et objectivité. Par la faute de sa caste politique, singulièrement médiocre, sectaire et irresponsable, elle réactive l’esprit de guerre civile et s’enfonce lentement, mais inexorablement, dans une crise globale économique, politique, culturelle, démographique et morale d’une ampleur alarmante.
Les historiens savent qu’en histoire il y a les faits, parfois tus, souvent minorés ou survalorisés, selon les auteurs, et que leurs analyses et interprétations ne sont pas moins différentes selon les convictions et sensibilités de chacun. Mais les historiens savent aussi que personne ne saurait monopoliser la parole et faire un usage terroriste de l’argument dit « scientifique » sans se situer hors de l’espace de la recherche sérieuse et finalement de la démocratie. Tout cela Pío Moa le sait et le clame et c’est pour cela qu’on ne saurait trop recommander la lecture de son beau livre, argumenté, courageux et décapant.
Arnaud Imatz, propos recueillis par Hadrien Desuin (Conflits, 14 août 2022)