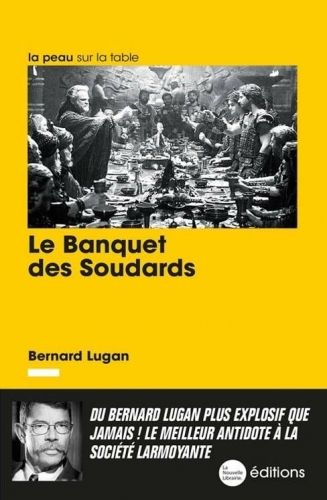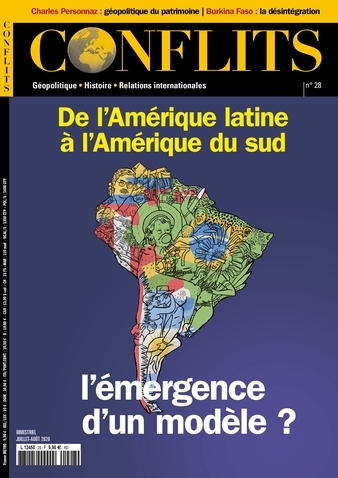Et si l’écologie était... de droite ?
Les dernières élections municipales ont rappelé la place prépondérante de l’écologie dans notre vie politique et renvoyé la droite à ses insuffisances. «Nous devons porter une politique environnementale compatible avec nos valeurs», affirma en guise d’appel au sursaut le Secrétaire général des Républicains (LR), Aurélien Pradier, au lendemain d’un second tour cataclysmique pour son parti dans les grandes villes. Mais alors quelles valeurs, et pour quel projet?
À droite, l’écologie divise, ou plutôt embarrasse. C’est qu’on ne sait l’appréhender, comment s’approprier un discours, une idée née de la critique des effets du marché et du progrès technique sur l’homme et son environnement. Ainsi se contente-elle, bien souvent, de dénoncer une écologie «punitive», attentatoire aux libertés individuelles. Un angle d’approche tout à fait recevable, sauf que la droite est, historiquement, plutôt convaincue du contraire ; que de la contrainte ou de la règle peut naître un ordre plus juste, une sécurité («première des libertés») plus grande. Ce qui est vrai pour la préservation de la société, la sécurité des biens et des personnes ne le serait-il pas pour la terre et la biodiversité? Quid, dans ce cadre, du «principe de précaution», inscrit dans notre constitution sous la présidence de Jacques Chirac? Ne constitue-t-il pas une entrave insupportable aux libertés individuelles, à l’initiative personnelle et à l’innovation scientifique, carburants du dynamisme économique? Même de son bilan (on a omis d’évoquer l’organisation du Grenelle de l’environnement par Nicolas Sarkozy), la droite ne sait que faire…
Elle a oublié qu’elle fut pionnière. Au début des années 1970, l’écologie fait son entrée en politique. Signe des temps: la présidentielle de 1974 voit le premier candidat étiqueté «écologiste», le sociologue René Dumont, se soumettre aux suffrages des Français. Mais le tournant a lieu plus tôt. On le doit au président gaulliste de l’époque, Georges Pompidou. Dans une France chamboulée par l’ «ardente nécessité» de poursuivre la «modernisation» du pays, Pompidou créa le premier ministère de l’environnement. Comme un contrepoids au tourbillon du changement, l’ancien Premier ministre du Général de Gaulle offrit au pays un ministère de la continuité, contre la course à l’innovation une politique de la préservation. Un choix somme toute logique pour cet agrégé de lettres classiques, ancien professeur de latin et de grec, qui n’ignorait rien des questions que le développement des sociétés industrielles posait à la condition humaine. En témoigne ce discours sur «la crise de la civilisation occidentale», prononcé en 1970 dans la tentaculaire ville de Chicago: «La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l’homme du début de ce siècle s’acharnait encore à maîtriser mais comme un cadre précieux et fragile qu’il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l’homme.»
L’écologie ne remet pas en cause le changement ou la possibilité d’un «progrès» (la capacité des hommes à mettre leur créativité au service d’une amélioration de leurs conditions d’existence). Elle questionne le «Progrès» (avec un grand «P») ; la croyance en un vaste mouvement qui ferait mécaniquement coïncider avenir et prospérité, transformation et amélioration. «Dans l’entassement des grandes agglomérations, poursuit Pompidou, l’homme se voit accablé de servitudes et de contraintes de tous ordres qui vont bien au-delà des avantages que lui apportent l’élévation du niveau de vie et les moyens individuels ou collectifs mis à sa disposition. Il est paradoxal de constater que le développement de l’automobile par exemple, dont chacun attend la liberté de ses mouvements, soit traduit en fin de compte par la paralysie de la circulation.» Un passage d’une étonnante actualité et qui révèle un des grands ressorts du vote écologiste à Lyon, Paris ou Bordeaux: non pas le désir de «revenir à la terre» (ce désir, nombre d’urbains le réalisent chaque année), mais un malaise plus profond, lié à la sensation d’étouffement éprouvée dans des transports bondés ; à la concentration, à la densité de population que la tertiarisation de l’économie et une politique d’aménagement du territoire centrée sur le développement des grandes métropoles ont accéléré dans des proportions jamais atteintes.
Plaidant pour la sauvegarde de «la maison des hommes», Pompidou fit voter en 1973 une loi sur «les espaces boisés à conserver», déclinée sous la forme d’une fameuse lettre adressée aux arbres du bord de la route. «La vie moderne dans son cadre de béton, de bitume et de néon créera de plus en plus chez tous un besoin d’évasion, de nature et de beauté. L’autoroute sera utilisée pour les transports qui n’ont d’autre objet que la rapidité. La route, elle, doit redevenir pour l’automobiliste de la fin du XXe siècle ce qu’était le chemin pour le piéton ou le cavalier: un itinéraire que l’on emprunte sans se hâter, en en profitant pour voir la France. Que l’on se garde donc de détruire systématiquement ce qui en fait la beauté!»
«Fragile», «précieux», «beauté», «nature»… le champ lexical de l’écologie pompidolienne ne remit pas pour autant en cause le colbertisme triomphant des débuts de la Vème République, qui devait donner à la France les industries stratégiques nécessaires à la préservation de son rang et à la consolidation de son indépendance. C’est sans doute ici, dans la conciliation - que d’aucuns jugeront «contre-nature» - de l’écologie et d’une certaine industrie, de l’impératif de sauvegarde de la beauté du monde et de souveraineté, de décarbonation (de l’économie) et de réindustrialisation (du pays), qu’une ligne de crête se dessine pour la droite. Et se livre sous le nom de «transition énergétique».
Pensons à l’hydrogène. À terme, cette énergie doit contribuer à la décarbonation d’industries fortement consommatrices d’énergies (aciéries, raffineries…) et de nombreux transports, ferroviaires notamment, comme en région Grand Est ou en Occitanie, où la SNCF, Alstom Transport et l’agence environnementale d’Etat (l’Ademe) oeuvrent à la construction de trains à hydrogène pour revitaliser les petites lignes de la France périphérique. Sur l’ensemble de la chaîne de valeurs, la filière hydrogène française dispose de fleurons de premier plan (Air Liquide, Engie, EDF, Alstom, Michelin…). Mais une chose déterminante manque au déploiement des potentialités de cet ensemble: un investissement public massif. Car le marché, seul, ne suffit pas. Pour décoller, une filière industrielle a besoin de propulseurs publics. Vieux réflexe français? C’est peu connaître l’histoire de l’industrie et les pratiques contemporaines de nos voisins et concurrents internationaux.
Soucieux d’inscrire ses pas dans ceux de son prédécesseur, Valéry Giscard d’Estaing entreprit une action réformatrice importante dans le domaine de l’environnement. Citons, à titre d’exemple, la loi sur la protection de la nature, qui instaura une liste nationale d’espèces protégées, un statut pour l’animal domestique et la création d’études d’impact avant la construction d’infrastructures. Ou celle de 1975 portant création du Conservatoire de l’Espace Littoral, en vue de sanctuariser les côtes françaises face aux menaces d’urbanisation. Interrogé par un journaliste jugeant cette politique ancrée «à gauche», le président Giscard d’Estaing eut cette réponse: «L’écologie, c’est avoir peur pour ce qui existe… c’est aussi ça, être de droite.» Une réponse qui mérite qu’on s’y attarde. Car elle résume à elle seule la disposition d’âme au fondement de la pensée conservatrice.
Le conservatisme, explique le regretté Roger Scruton, auteur de Green philosophy en 2012, c’est «ce sentiment que toutes les personnes d’âge mûr partagent sans mal: le sentiment que les choses bonnes peuvent être aisément détruites, mais non aisément créées». La «peur» dont parle Giscard d’Estaing n’est donc pas cet épouvantail qui paralyse et pousse à céder aux sirènes du repli. Elle est ce sentiment que l’essentiel (la faune, la flore, tel paysage, tel art de vivre, telle langue, tel patrimoine… tout ce qui donne sens et substance à notre présence sur Terre) est sujet à caution, vulnérable, car dépendant de notre capacité à l’entourer d’une attention sans cesse renouvelée. Elle rappelle que l’écologie est une éthique de la responsabilité, alliant souci des conséquences et conscience des permanences sans lesquelles l’avenir aurait le goût insipide de la fatalité. Une éthique qui entrave une conception dévoyée de la liberté, synonyme d’adaptation effrénée à un sens de l’Histoire que l’absence de résistance intérieure de l’homme moderne pousse à épouser sans précaution. Cette éthique, il ne tient qu’à nous de l’ériger, comme nous y enjoignait Hans Jonas: «Le Prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais encore connues et l’économie son impulsion effrénée, réclame une éthique, qui par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l’homme de devenir une malédiction pour lui.»
Les «entraves» évoquées par le grand penseur de l’écologie doivent être - notons-le - «librement consenties». Elles ne sauraient donc être imposées du dehors, par un pouvoir tutélaire s’affirmant au mépris des aspirations populaires. Elles ne sauraient non plus être érigées sans souveraineté. Car ce n’est que dans le cadre d’une nation souveraine, maîtresse de ses destinés, qu’un peuple peut consentir à de telles entraves ; édifier des parcs naturels et des zones protégées du tourisme de masse, limiter l’exploitation de ses forêts, soutenir une agriculture raisonnée, taxer les importations de produits ne respectant pas les normes environnementales qu’il s’est à lui-même fixées…
On ne saurait enfin être complet sans évoquer l’écologie humaine, qui n’est pas un gros mot, surtout à l’heure où le Parlement s’apprête à détricoter notre code bioéthique. Contrairement à ce qu’affirme le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, cette écologie ne met pas «la nature au-dessus de l’homme» mais l’humain au-dessus de la technique. L’homme n’est pas un matériau malléable, le cobaye des expérimentations sociétales du progressisme. Il réclame lui aussi une éthique, qui ne saurait simplement correspondre «aux évolutions de la science et de la société», comme le préconise le professeur Jean-François Delfraissy. La bioéthique est une boussole, un point d’ancrage. Elle existe pour fixer des «repères» aux citoyens, face aux «avancées parfois vertigineuses des sciences», et répondre aux demandes «des chercheurs et des praticiens qui se sentent souvent trop seuls face aux conséquences gigantesques de leurs réflexions et de leurs travaux», expliquait non pas La Manif pour Tous mais François Mitterrand, lors de la création du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) en 1983. Mais sans doute parce que lui aussi était, au fond, un homme de droite…
Max-Erwann Gastineau (Figaro Vox, 8 juillet 2020)