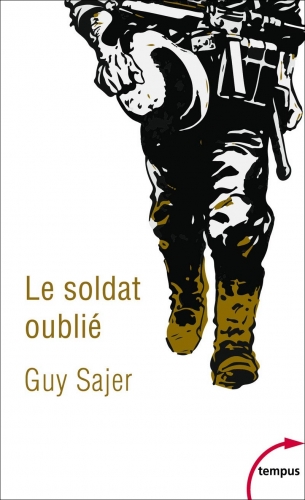Jean-Claude Michéa : « Il n’existe pas de lien philosophique indissoluble entre le libéralisme politique et la démocratie »
Dissent : Vos écrits montrent que le capitalisme ne peut pas exister sans la quête inlassable de l’individualisme et des désirs individuels. Ce qui inclut donc des valeurs – qui pour beaucoup d’entre nous sont devenus une seconde nature – telles que la réalisation de soi et la critique des normes sociales. Vous en concluez que le libéralisme économique ne peut pas exister sans le libéralisme culturel. « Une économie de droite – écrivez-vous – ne peut pas exister sans une culture de gauche. »Est-ce que la principale leçon de vos livres c’est bien que la gauche doit rompre une fois pour toutes avec le libéralisme ?
Jean-Claude Michéa : Je suis toujours sidéré, en effet, par la facilité avec laquelle la plupart des intellectuels de gauche contemporains (c’est-à-dire ceux qui, depuis la fin des années 1970, ont progressivement renoncé à toute critique radicale et cohérente du système capitaliste) opposent désormais de façon rituelle le libéralisme politique et culturel − tenu par eux pour intégralement émancipateur − au libéralisme économique dont ils s’affirment généralement prêts, en revanche, à condamner les “excès” et les “dérives” financières. Non seulement, bien sûr, parce qu’une telle manière de voir invite inévitablement à jeter par-dessus bord, dans le sillage de Foucault, toute l’armature intellectuelle du socialisme originel (au sens où Marx, par exemple, soutenait que le système capitaliste était incompatible avec toute notion de « limite morale ou naturelle » et que sa véritable devise, loin d’être culturellement conservatrice, était en réalité « Liberté, Égalité, Propriété, Bentham »).
Mais aussi parce qu’elle conduit, dans la foulée, à oublier que pour Adam Smith et les premiers défenseurs du libéralisme économique (un courant idéologique dont, soit dit en passant, l’intelligentsia de gauche a toujours autant de mal à reconnaître la filiation logique avec la philosophie des Lumières) les progrès de la liberté économique et du “doux commerce” apparaissaient indissolublement liés à ceux de la tolérance, de l’esprit scientifique et des libertés individuelles. Ce qui se comprend du reste assez bien. Comme le rappelait en effet Hayek dans The Road to Serfdom, une véritable économie libérale ne peut fonctionner de façon à la fois cohérente et efficace − et contribuer ainsi à « libérer l’individu des liens traditionnels ou obligatoires qui entravaient son activité quotidienne » − que si « chacun est libre de produire, de vendre et d’acheter tout ce qui est susceptible d’être produit ou vendu », sans que ni l’État ni la collectivité n’aient à se mêler de ses choix.
Si l’on veut bien assumer jusqu’au bout l’ensemble des implications de ce postulat “émancipateur”, il est donc clair que toute prétention à limiter la liberté économique des individus au nom d’une quelconque “préférence” morale, religieuse ou philosophique (en s’opposant par exemple à la libéralisation du commerce des drogues, au droit de travailler le dimanche ou à la gestation pour autrui) ne peut que contredire ce droit naturel de chacun à “vivre comme il l’entend” qui constitue l’essence même du libéralisme politique et culturel. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ces deux versions parallèles et complémentaires de l’idéologie libérale – celle (version de “gauche”) qui privilégie le moment du Droit et celle (version de “droite”) qui privilégie le moment du Marché – trouvent leur point de départ dans la même fiction métaphysique : à savoir l’idée − anthropologiquement absurde − d’un individu “indépendant par nature” (et donc déjà pleinement humanisé avant même l’existence du langage et de la société !), “propriétaire absolu de lui-même” et censé n’agir, en dernière instance, que pour “maximiser son utilité”. Bref, une de ces « plates fictions du XVIIIe siècle » (« le chasseur et le pêcheur individuels et isolés par lesquels commencent Smith et Ricardo ») que Marx avait l’habitude de tourner en dérision sous le nom de “robinsonnades”.
Pour nous en tenir à des événements récents, quelle appréciation portez-vous sur le mouvement des “Gilets jaunes” ? Exprime-t-il une critique de la société contemporaine comparable à celle que vous avez formulée dans vos livres ?
J’ai bien entendu appelé à soutenir le mouvement des Gilets jaunes dès le premier jour, quand le clergé intellectuel − et notamment son extrême gauche − portait encore sur lui le même regard horrifié que les Elois de The Time Machine sur le monde des Morlocks ! Le premier mérite, à mes yeux, de cette révolte authentiquement plébeienne (dans laquelle les femmes, comme c’est le cas dans tous les grands mouvements populaires, ont joué un rôle déclencheur absolument décisif), c’est en effet d’avoir fait voler en éclats le mythe fondateur de la nouvelle gauche selon lequel le concept de “peuple” aurait définitivement perdu, de nos jours, toute signification politique, sauf à s’appliquer aux seules populations immigrées vivant à proximité immédiate des grandes métropoles mondialisées. Or c’est bien ce peuple théoriquement “disparu” qui non seulement fait aujourd’hui son retour en force sur la scène de l’Histoire mais qui a même déjà commencé à obtenir − grâce à sa spontanéité rafraîchissante et sa pratique obstinée de la démocratie directe (“nous ne voulons plus élire, nous voulons voter !” est l’un des slogans les plus populaires parmi les Gilets jaunes des ronds-points) − plus de résultats concrets, en quelques semaines, que toutes les bureaucraties syndicales et d’extrême gauche en trente ans.
Bien entendu, le fait que cette France de la ruralité, des villes petites et moyennes et des territoires d’outre-mer (cette France “périphérique”, en d’autres termes, sur laquelle un Bernard-Henri Levy vomit chaque jour sa haine de classe alors qu’elle subit de plein fouet, depuis plus de trente ans, toutes les conséquences pratiques de son évangile libéral, au point même de connaître dans ses régions rurales les plus déshéritées, des conditions de vie infiniment plus précaires et dramatiques que celles des banlieues “à problèmes”), le fait, donc, que cette France qui regroupe plus de 60% de la population ait fini par disparaître entièrement des écrans-radars de l’intelligentsia de gauche ne devrait étonner personne. Il n’est que la suite logique du processus qui a conduit la gauche moderne, depuis sa conversion accélérée aux principes du libéralisme économique et culturel, à liquider progressivement sa base sociale d’origine au profit de ces nouvelles classes “moyennes-supérieures” des grandes métropoles mondialisées – surdiplômées et hyper-mobiles – qui ne représentent pourtant que 10 à 20% de la population, tout en étant structurellement protégées contre les principales nuisances de la globalisation libérale (quand encore elles n’en profitent pas directement !). Inutile de préciser que c’est seulement au sein de ces nouvelles catégories sociales incroyablement imbues d’elles-mêmes, dont la bonne conscience “progressiste” n’est que l’envers logique de leur mode de vie privilégié et de leur pratique systématique de l’“entre-soi”, que pouvait fleurir l’idée profondément mystificatrice (quoique très réconfortante pour elles) que seuls les 1% les plus riches appartiendraient véritablement à la classe dominante !
C’est donc avant tout, selon moi, cette véritable “contre-révolution sociologique” qui explique qu’aujourd’hui les mouvements populaires les plus radicaux (ou ceux, du moins, dont le potentiel révolutionnaire est le plus prometteur) prennent presque toujours naissance en dehors du cadre traditionnel des syndicats et des partis de gauche (quand ce n’est pas contre eux !). À partir du moment, en effet, où les élites intellectuelles de la nouvelle gauche sont devenues désespérément incapables − une fois acté leur renoncement définitif à toute remise en question radicale de la logique capitaliste − de percevoir dans ceux qui produisent de leurs mains l’essentiel de la richesse collective (y compris les robes de soirée d’Hillary Clinton ou les costumes d’Emmanuel Macron !) autre chose qu’un sinistre et repoussant « panier de déplorables », « raciste, sexiste, alcoolique et homophobe par nature » (selon la description phobique que ne cesse d’en donner la nouvelle “minorité civilisée”), toutes les conditions se trouvent alors réunies pour favoriser, dans tous les milieux populaires, une prise de conscience de plus en plus nette du fait qu’à l’ère du capitalisme terminal (je reprends ici le concept d’Immanuel Wallerstein) le clivage gauche/droite a fini par perdre l’essentiel de son ancienne signification historique, pour ne plus recouvrir désormais que ce que Guy Debord appelait déjà, en 1967, les « fausses luttes spectaculaires des formes rivales du pouvoir séparé ».
C’est d’abord dans ce contexte historique en grande partie inédit (celui, encore une fois, où les contradictions internes du processus d’accumulation sans fin du capital − comme Marx l’avait prévu dans le Livre III du Capital − apparaissent de plus en plus insurmontables, du fait de la diminution constante et inexorable de la part du travail vivant dans le processus de production moderne) qu’il devient alors possible de comprendre dans toute son ampleur la thèse révolutionnaire que défendaient au départ les fondateurs de Podemos. Le clivage politique décisif – remarquaient en effet Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero et Inigo Errejon – ne peut plus être, aujourd’hui, celui qui oppose rituellement l’aile droite et l’aile gauche du château libéral (avec les brillants résultats que l’on sait !). C’est, au contraire, celui qui divise de façon infiniment plus tranchante – comme c’est d’ailleurs le cas dans toutes les sociétés de classe − “ceux d’en bas” (autrement dit, ces classes “subalternes” dont Machiavel rappelait qu’elles ont d’abord en commun le désir de « ne pas être commandé ni opprimé par les Grands ») et “ceux d’en haut” (autrement dit ces “Grands” que le souci permanent de maintenir et d’étendre leurs privilèges de classe contraint inexorablement à vouloir “commander et opprimer le peuple”).
De ce point de vue, le mouvement des Gilets jaunes marque clairement le retour au premier plan de cette insubmersible “question sociale” que la nouvelle gauche s’était pourtant efforcée de noyer, depuis plus de trente ans, sous le flot continu de ses revendications “sociétales” ( et on peut, par conséquent, être absolument certain que les “gardes rouges du capital” − Black blocs et “antifas” en tête − feront tout ce qui est en leur pouvoir, avec la complicité habituelle des grands médias libéraux, pour donner de cette révolte spontanée de la France périphérique et “provinciale” l’image profondément trompeuse d’un phénomène essentiellement parisien, pouvant même finir par trouver, à ce titre, un écho favorable chez certains universitaires de gauche). Et de fait, s’il est bien un point, depuis quelques semaines, qui saute aux yeux de tous les observateurs sérieux (et que confirme à chaque instant la moindre discussion politique entre parents, amis ou collègues de travail) c’est qu’il est devenu presque aussi difficile, à l’heure où je parle, de trouver de véritables partisans des Gilets jaunes chez ceux – qu’ils soient de droite ou de gauche – qui gagnent plus de 3000 € par mois (soit 17 % de la population française) que d’opposants résolument hostiles à ce mouvement populaire chez ceux ( plus de 60 % de la population) qui “vivent” avec moins de 2000 € par mois !
Très significative, de ce point de vue, est l’incroyable mésaventure survenue au journal Le Monde (le plus important quotidien de la gauche libérale française) le 16 décembre 2018. Ayant commis, en effet, l’imprudence de laisser passer un reportage plein d’empathie sur les conditions de vie incroyablement précaires et difficiles d’une famille de Gilets jaunes (« Arnaud et Jessica, la vie à l’euro près »), le quotidien libéral a aussitôt vu son site internet submergé de commentaires enragés et haineux de la part de ses lecteurs de gauche, littéralement scandalisés qu’on puisse ainsi éprouver une telle compassion pour ces “parasites sociaux” et ces “assistés” qui osaient se plaindre de leur sort alors qu’ils n’avaient même pas l’excuse d’avoir la bonne couleur de peau ! De quoi donner raison, en somme, au grand écrivain socialiste américain Upton Sinclair lorsqu’il notait, dans les années 1930, qu’il est toujours « difficile d’amener quelqu’un à comprendre une chose quand son salaire dépend précisément du fait qu’il ne la comprend pas ».
Quel que soit, par conséquent, le destin politique qui attend dans les mois qui viennent le mouvement des Gilets jaunes (car on ne doit pas oublier qu’Emmanuel Macron − en bon thatchérien de gauche − n’hésitera pas un seul instant à employer tous les moyens, y compris les plus sanglants, pour briser leur révolte et défendre les privilèges de sa classe sociale), il est d’ores et déjà acquis qu’il aura permis d’élever de façon spectaculaire − en seulement quelques semaines − le niveau de conscience politique de “ceux d’en bas” (notamment quant aux limites structurelles de ce système dit “représentatif” qui prend aujourd’hui l’eau de toute part). Autant dire que pour les classes dirigeantes − et malgré le soutien sans faille que continueront à leur apporter jusqu’au bout leurs fidèles blacks blocs et leurs grotesques foulards rouges (puisque c’est ainsi que s’auto-désigne, en France, la fraction de la bourgeoisie la plus impatiente d’en découdre avec les classes populaires) − la fin de la “fin de l’histoire” est d’ores et déjà à l’ordre du jour !
De nos jours, le libéralisme (au moins sous sa forme politique) semble menacé par le retour de l’autoritarisme. Dans un tel contexte, ne pourrait-il pas être nécessaire, au moins à court terme, de soutenir les individus et les forces sociales qui sont en position de protéger ce qui reste de la démocratie – même si ce sont des néolibéraux déclarés ?
« J’en sais assez sur l’impérialisme britannique pour ne pas l’aimer – écrivait Orwelldans sa lettre à Noel Willmett du 18 mai 1944 –, mais je le soutiendrai contre l’impérialisme nazi ou japonais, parce qu’il représente un moindre mal ». Honnêtement, je ne vois pas grand-chose à changer à cette analyse. Chaque fois qu’un mouvement totalitaire apparaît réellement sur le point de prendre le pouvoir dans une société libérale et d’y détruire, dans la foulée, tout ce qui peut encore subsister d’institutions libres (je laisse de côté la question cruciale de savoir quelle succession d’“erreurs” ont alors forcément dû commettre les élites de cette société libérale pour que la situation se dégrade à un tel point), il n’y a évidemment plus d’autre solution possible pour un ami du peuple que d’opter pour “le moindre mal”. Quitte, en effet, à s’allier provisoirement pour cela avec des “néolibéraux déclarés”.
Il y a néanmoins quelque chose qui me dérange un peu dans la manière dont cette question est formulée. Elle semble sous-entendre, en effet, qu’il existerait un lien philosophique indissoluble entre le libéralisme politique et la démocratie au sens strict, c’est-à-dire (car je ne connais pas d’autre définition) le “pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple”. Or cette thèse est contestable pour au moins deux raisons. La première, c’est que les libéraux − du fait de leur individualisme constitutif (l’individu comme “indépendant par nature” et “propriétaire absolu de lui-même”) − éprouvent habituellement une profonde méfiance envers les idées républicaines de “souveraineté populaire” et de bien commun” − qu’ils soupçonnent même, la plupart du temps, de contenir en germe la “tyrannie de la majorité” et le “collectivisme”. Telle est d’ailleurs la véritable raison d’être historique de ce système politique dit “représentatif” que les révolutionnaires de 1789 prenaient encore bien soin de distinguer de la démocratie radicale “à l’ancienne”. Il repose en effet sur la conviction − théorisée par Montesquieu – que le peuple a assez de sagesse pour choisir ceux qui le représenteront, mais pas pour se gouverner directement lui-même. Le libéralisme politique est donc clairement indissociable de cette professionnalisation de la vie politique (et du règne parallèle des “experts”) dont presque tout le monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître qu’elle joue un rôle essentiel dans le “déficit démocratique” grandissant qui caractérise les sociétés libérales.
Et la seconde raison, c’est que ce sont précisément les nouvelles contraintes qui pèsent à présent sur le processus d’accumulation mondialisée du capital – rôle démesurément accru, entre autres, du crédit, de la dette et des produits spéculatifs (tout ce que Marx, en un mot, rassemblait sous le concept de “capital fictif”) – qui conduisent de plus en plus les États libéraux à voir dans les institutions démocratiques traditionnelles, et tout particulièrement dans le principe même du suffrage universel, une véritable menace pour le bon fonctionnement de l’économie de marché (il suffit de lire, sur ce point, le témoignage hallucinant de l’ancien ministre grec Yanis Varoufakis sur les propos que peuvent tenir en privé les actuels dirigeants de l’Union européenne). Comme le fait ainsi remarquer le critique social allemand Wolfgang Streeck, lorsque l’“État fiscal” fordiste et keynésien (celui qui reposait, en dernière instance, sur l’impôt) doit progressivement céder la place à l’“État débiteur” néolibéral (celui qui doit emprunter sans cesse sur les marchés financiers), chacun devrait pouvoir comprendre immédiatement que tout gouvernement nouvellement élu – qu’il soit de droite ou de gauche – aura forcément beaucoup plus de comptes à rendre à ses créanciers internationaux (ceux-là mêmes que les États libéraux avaient pourtant contribué à sauver de la faillite en 2008 !) qu’à ses propres électeurs.
Telle est bien, du reste, l’une des raisons majeures de cet inquiétant mouvement de fond qui pousse depuis quelques décennies la plupart des gouvernements libéraux, à rétrécir sans cesse le champ d’application du suffrage universel, notamment en le plaçant de plus en plus sous le contrôle “constitutionnel” de “sages”, de juges ou d’“experts” (voire – avec les nouveaux traités de libre échange – de tribunaux privés) nommés directement par l’élite au pouvoir et donc dépourvus, à ce titre, de toute véritable légitimité populaire (en France, certains juristes de gauche et d’extrême gauche – idéologiquement très proches d’Emmanuel Macron − vont même, désormais, jusqu’à soutenir l’idée qu’un véritable “État de droit” est celui dans lequel ces juges supposés “impartiaux” et censés incarner mieux que le peuple lui-même les “valeurs ultimes de la démocratie” − auraient en permanence le pouvoir d’annuler ou de suspendre toutes les décisions “populistes” qui pourraient surgir des urnes !). Mais, après tout, n’est-ce pas Friedrich Hayek lui-même qui justifiait déjà, le 12 avril 1981, et au nom même de la défense de la démocratie et des libertés individuelles, le renversement du président populiste Salvador Allende – pourtant légalement élu – par ce disciple excité de Milton Friedman qu’était le tortionnaire Augusto Pinochet ?
Jean-Claude Michéa, propos recueillis Michael C. Behrent (Les Crises, 15 août 2019)