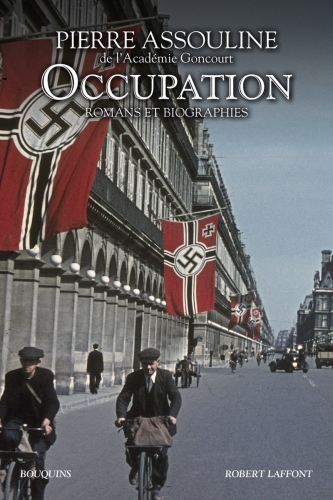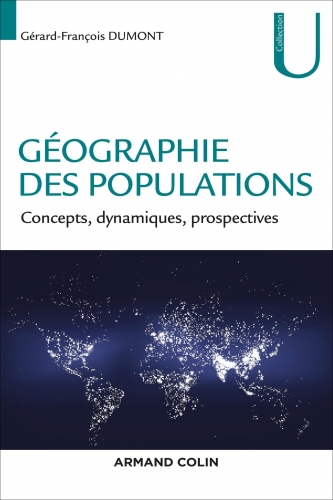«Bots russes» dans l'affaire Benalla : en finir avec la russophobie pavlovienne
Dans «The Manchurian Candidate», chef-d'œuvre du réalisateur américain John Frankenheimer sorti en 1962, des experts soviétiques élaborent une machination sournoise pour déstabiliser les États-Unis et y faire triompher l'idéologie communiste. Ceux-ci prennent en otage Raymond Shaw, un soldat américain combattant en Corée, et recourent à l'hypnose et aux drogues afin de le conditionner et de l'inciter à assassiner le président américain. Ce film est profondément révélateur de la paranoïa anti-russe qui sévit alors dans une Amérique tout juste sortie de l'épisode de la chasse aux sorcières sous le sénateur McCarthy.
Malgré le tournant historique de la fin de la guerre froide, les angoisses liées à la Russie persistent et l'époque tend à se prendre pour une autre. Dans le discours dominant, la Russie est ainsi très souvent présentée comme une puissance tentaculaire, toujours encline à conspirer contre des démocraties occidentales fragiles et fatiguées. La question des prétendues ingérences de Moscou se pose continuellement et les accusations sont légion: soutien à Donald Trump, contribution à la victoire du Brexit et à la montée des velléités indépendantistes en Catalogne, interférence dans la campagne présidentielle française en défaveur d'Emmanuel Macron, etc. À la suite de la publication d'une étude par l'ONG EU DisinfoLab, l'emballement autour de l'affaire Benalla a même été cette semaine imputé à l'activisme numérique de la Russie et d'une «sphère russophile» désireuse de gonfler artificiellement la polémique. Toutes les turpitudes qui frappent les élites occidentales et l'ordre néolibéral seraient ainsi la conséquence de manœuvres russes particulièrement sournoises.
Il ne s'agit pas évidemment d'être naïf et de nier l'existence de réseaux d'influences russes en Europe ou aux États-Unis. Cela serait d'autant plus absurde que toutes les grandes puissances s'appuient sur leur soft power pour défendre leurs intérêts vitaux à l'étranger et recourent pour cela à des procédés divers. Le problème n'est pas là.
Il réside tout d'abord dans le fait que les accusations pavloviennes envers la Russie sont souvent malhonnêtes. La capacité d'influence de la Russie, et plus largement sa puissance, sont en permanence surévaluées par les élites occidentales. Celles-ci font fi de toutes les limites de la Russie: budget militaire près de dix fois inférieur à celui de l'OTAN, déclin démographique, économie insuffisamment diversifiée et trop dépendante des hydrocarbures, etc. La Russie n'a ni les ambitions impérialistes qu'on lui prête trop souvent, ni les moyens de ces ambitions. Elle pratique plutôt une politique de défense de ses intérêts dans son voisinage et se veut une puissance d'équilibre dans l'ordre international actuel. D'autres pays vont par ailleurs bien plus loin qu'elle dans l'ingérence à l'étranger, dès lors qu'ils jugent que la direction prise par tel ou tel gouvernement est contraire à leurs intérêts, et ne reculent devant rien, pas même devant le droit international. Les exemples de l'invasion de l'Irak et du renversement de Kadhafi en Libye l'ont bien montré. Mais la force du deux poids deux mesures est telle que les élites occidentales sont plus enclines à fermer les yeux sur certains pays que sur la Russie.
Si l'on s'arrête par exemple sur la dernière campagne présidentielle américaine, il est raisonnable de penser que la Russie avait intérêt à ce que Donald Trump l'emporte. Son projet d'approfondir et de pacifier les relations russo-américaines contrastait drastiquement avec l'hostilité manifestée par Hillary Clinton à l'encontre de Moscou. Certains réseaux russes ont certes œuvré en faveur de la victoire du candidat républicain mais cela n'a eu qu'une incidence infime sur le résultat final. Rien qui justifiait en tout cas le poids politico-médiatique que l'affaire a pris. Comme le note le chercheur François-Bernard Huyghe, la seule conséquence de la diffusion de supposées «fake news» anti-Clinton a été de conforter dans leur intention de vote des électeurs qui étaient de toute manière déjà en rupture avec l'establishment américain et la candidate démocrate.
Dans le cas de l'affaire Benalla, les réactions de certains hommes politiques accusant la Russie, à l'image du groupe de centre droit «Agir», ont été tellement virulentes que EU DisinfoLab, l'ONG belge à l'origine de l'affaire, a tenu dans une étude définitive à nuancer ses conclusions initiales et à expliquer qu'il n'y avait pas de preuve d'une ingérence organisée.
Dans des situations si confuses, la stratégie d'accuser le Kremlin de tous les maux qui minent les «démocraties libérales» est extrêmement dangereuse. Cette propension vise souvent, par le recours à une grille d'analyse du réel bien commode, à absoudre les élites de leurs torts et à éviter que l'on s'interroge sur les conséquences des choix politiques faits par celles-ci au cours des dernières années. Le Brexit découle par exemple de problèmes très profonds et inhérents à la société britannique et à la structure de l'Union européenne: paupérisation de la classe moyenne et mécontentement face aux inégalités, insécurité culturelle et désarroi face à l'immigration, volonté de retrouver une indépendance politique dans une nation construite autour de la souveraineté du Parlement, etc. L'expliquer à travers le prisme des manœuvres russes, c'est faire preuve d'une malhonnêteté confondante.
Cette russophobie primaire pose enfin un dernier problème majeur dès lors qu'elle justifie que l'on s'attaque à nouveau à une liberté d'expression déjà fortement fragilisée en France depuis quarante ans. La proposition de loi sur les fausses nouvelles prévoit par exemple, dans son troisième article, de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sanctionner, notamment à coups de retraits de licences, les médias étrangers qui pratiquent la «désinformation». Il est évident que cette mesure n'a pas pour cible al-Jazeera mais bien RT et Radio Sputnik, c'est-à-dire des médias subventionnés par le Kremlin avec qui Emmanuel Macron a un contentieux personnel. Le président français les accuse en effet d'avoir comploté afin d'enrayer son ascension au pouvoir. Ainsi, à cause d'une paranoïa anti-russe et au nom d'un concept de «fake news» aux contours extrêmement flous, c'est à l'édifice permettant le débat démocratique et l'exercice des libertés fondamentales que l'on s'attaque. Alors même que le réel ne se laisse jamais saisir à travers un angle unique, des désaccords sur des faits et sur leur interprétation servent de prétexte au pouvoir en place pour incriminer une vision du monde ou pour disqualifier un adversaire idéologique. La politique est ainsi réduite à une lutte entre le camp du vrai, le fameux «cercle de la raison» d'Alain Minc, et des foules manipulées, par Moscou et plus largement par les populistes, et coupables de mal voter.
Ce dernier point est fondamental car la russophobie presque systématique qui se manifeste aujourd'hui en Occident nous raconte ce qu'est devenue la politique: un affrontement manichéen entre l'humanité et ses ennemis. Parer la Russie des attributs du mal dans sa forme chimiquement pure revient à nier à la fois l'essence de la politique et le fait que la tension entre le bien et le mal se manifeste de façon universelle. C'est peut-être d'ailleurs le penseur russe, Alexandre Soljenitsyne, qui retranscrit le mieux les dangers de cette dérive dans son œuvre L'archipel du Goulag: «Peu à peu, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les États ni les classes ni les partis, mais qu'elle traverse le cœur de chaque homme et de toute l'humanité.»
Ceux qui nient la complexité du monde, par inquiétude sincère sur l'avenir du libéralisme dans leurs sociétés ou par incapacité à supporter le fait que la Russie se soit relevée de la dislocation de l'URSS, ne servent donc pas le débat démocratique qu'ils prétendent aimer. Ils l'empêchent et contribuent par conséquent à rendre le réel plus obscur.
En 1991, le conseiller diplomatique de Gorbatchev, Gueorgui Arbatov avait mis en garde les Occidentaux avec la prédiction suivante: «Nous allons vous rendre le pire des services, nous allons vous priver d'ennemi!». Arbatov s'est trompé. L'ennemi russe est encore là. Le complotisme l'est aussi, et pas toujours là où on l'attend.
Joachim Imad (Figaro Vox, 9 août 2018)