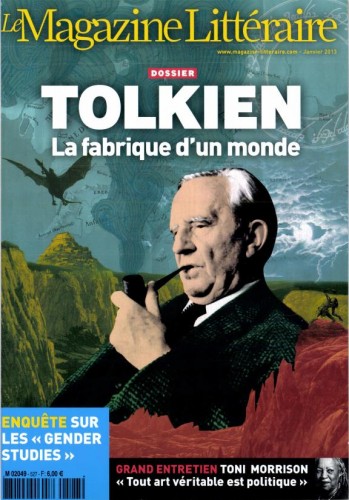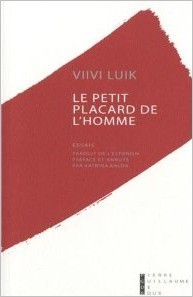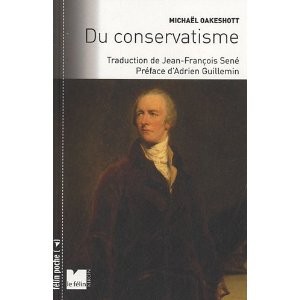De la violence en Amérique
Gil Mihaely : La récente tuerie dans l’école primaire de Newtown relance le débat sur le contrôle des armes à feu. La disponibilité de ces armes, notamment des armes de guerre, explique-t-elle ces épisodes meurtriers ?
Xavier Raufer : La dernière tuerie en date n’a “relancé le débat sur le contrôle des armes à feu” que dans les médias et, de façon factice, chez des politiciens américains incapables de résoudre ce problème. À ce propos, il est inquiétant que sans exception, les grands médias d’”information”, quotidiens, radios, télés, énoncent ensemble, au même instant et sans nulle nuance, précisément la même idée, formant ainsi une vaste Pravda collective.
GM : Même si certains médias le manipulent, le problème existe…
XR : Oui, et pas seulement aux Etats-Unis ! Mais pour les médias c’est toujours la même rengaine : les tueries entre gangsters à Marseille ? Les Kalachnikov ! On n’en sort pas. Les massacres de masse aux Etats-Unis : les armes ! Rien d’autre. Or les armes ne tuent jamais – une kalachnikov posée sur la table prend juste la poussière – ce sont ceux qui en usent : gangsters à Marseille, bombes humaines aux Etats-Unis, qui posent problème. Mais non : la fascination médiatique pour la quincaillerie est absolue.
GM : Des lois plus restrictives voire la « prohibition » des armes à feu ne feraient-elles pas baisser le nombre de tueries aux Etats-Unis ?
XR : Dans l’affaire des massacres de masse aux Etats-Unis, le paramètre des armes n’est ni l’explication, ni la solution. Que les médias d’information s’interrogent : pourquoi n’y a-t-il absolument aucun massacre de masse au Brésil et au Mexique, qui comptent vingt fois plus d’armes incontrôlées que les Etats-Unis ? Un autre phénomène devrait nous interroger : des massacres dans des écoles surviennent parfois en Chine – mais sans armes à feu, plutôt avec des explosifs ou des armes blanches.
GM : Certes, mais la disponibilité des armes à feu n’augmente-t-elle pas la gravité des autres crimes ?
XR : Bien sûr. Dans West Side Story, les bandes s’expliquent à coups de couteaux. Que ce soit désormais à l’arme de guerre ne fait aucun bien aux statistiques criminelles.
GM : Si ce n’est pas la disponibilité des armes, quel est donc le facteur déterminant dans les tueries de masse aux Etats-Unis ?
XR : Ce qui provoque ces massacres aux Etats-Unis ne tient pas à l’accessibilité des armes – qui est à l’évidence, un facteur aggravant – mais à l’essence de la société américaine en général, au psychisme de quelques individus en particulier. Esquissons une comparaison avec un drame psycho-social français : l’alcoolisme. Ce phénomène est très profondément enraciné, terriblement long et difficile à réduire. Pour autant, l’alcoolisme est-il réductible à la seule accessibilité de l’alcool ? Vous avez vu, les Etats-Unis et la prohibition ? Voilà ce qu’il faut méditer, au lieu de s’hypnotiser sur des outils homicides.
GM : L’existence de bombes humaines désocialisées comme Adam Lanza, le tueur de Newtown, est-elle un phénomène spécifiquement américain ?
XR : Là est le sujet. Pratiqué par des solitaires frustrés ou enragés, éduqués mais coupés de la société, le massacre de masse peut s’appuyer sur un prétexte idéologique ou millénariste. Certains vont aussi prendre pour objet phobique une école, des minorités, etc.
Mais l’origine psychologique n’est pas garantie : parfois, la biologie s’en mêle. Le premier massacre de masse moderne – 15 morts, 32 blessés – est perpétré en août 1966 à l’Université d’Austin (Texas) par Charles Whitman, 25 ans. Abattu par la police, Whitman évoque dans son testament d’étranges élans homicides. Son autopsie révèle une grosse tumeur dans un secteur cérébral régulant l’agressivité.
À ce jour, ces massacres de masse prennent l’ampleur d’un phénomène de société dans des pays riches marqués par un « protestantisme sociologique » provoquant un conformisme et une bienséance insupportables. Toute expression forte ou dissidente y fait horreur. Toute négativité en est bannie : les églises n’y montrent plus le Christ crucifié – odieuse vision d’une incorrecte torture. Exemple : l’Amérique blanche suburbaine du Colorado où, en 1999, deux élèves du lycée Columbine abattent 13 de leurs condisciples et en blessent 32, avant de se suicider. Désormais, Newtown.
GM : Une société trop policée est donc criminogène ?
XR : Evidemment ! L’être humain n’est pas un robot. L’homme jeune est aventureux, souvent outrancier de propos ou d’actes (“il faut bien que jeunesse se passe”…). Etouffez-le dans le politically correct et la bienséance gnan-gnan – vous aurez inévitablement 999 moutons bêlants – et une bombe humaine. Tout ca est su depuis des siècles – Pascal : “Qui veut faire l’ange, fait la bête” – mais plus présent dans la culture catholique que protestante – sans doute l’une des origines profondes de toute l’affaire.
GM : Dans les exemples que vous avez cités plus haut, les tueurs sont de jeunes hommes blancs. Peut-on établir le un profil de ces « loups solitaires » et des communautés ou des lieux qu’ils risquent de prendre pour cibles ?
XR : Impossible. Le FBI essaie depuis vingt ans d’établir un profil dans l’”active Shooter phenomenon” sans que cela ne donne rien. Des individus solitaires, d’apparence sombre et mutique, blancs, mâles et jeunes – il y en a vingt millions aux Etats-Unis, pouvant aussi bien être sujets à une sévère rage de dents, à une psychose homicide ou à un chagrin d’amour…
GM : Outre Atlantique, les faits divers, la télévision et le cinéma semblent illustrer une certaine obsession américaine pour le meurtre. Comme l’expliquez-vous ?
XR : L’acte fondateur des Etats-Unis, c’est la Guerre de sécession. Or, loin des superbes batailles bien rangées, des charges de cavalerie du général Lee, ce fut à 90% une atroce guerre de voisinage, terriblement sanglante et durable. Songez qu’elle s’achève en 1865 et qu’en 1882 encore, le soldat sudiste Jesse James braque toujours des banques, explicitement au nom de la “Lost Cause“ (sudiste) !
Avant cette guerre, il n’y avait que peu d’armes aux Etats-Unis. Le nécessaire pour les ours, les pumas – ou les Indiens. Que vos lecteurs anglophones lisent les deux fascinants livres mentionnés ci-après, ils seront édifiés. Ces massacres ont donc pour origine un séculaire traumatisme originel. L’arme à feu, la mort, sont enfouis au plus profond de la psyché américaine. Réduire ce drame à une simple affaire de quincaillerie est quand même désolant.
Xavier Raufer, propos recueillis par Gil Mihaely (Causeur, 20 décembre 2012)
Notes :