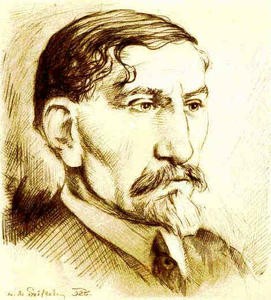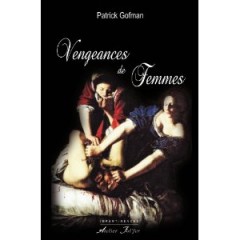Qu'est-ce que l'écologie ?
L’écologie comme science apparaît à la fin du XIXe siècle au carrefour de plusieurs disciplines scientifiques (la pédologie, la botanique, l’agrochimie, la phytogéographie et la biologie), de la nécessité d’étudier les espèces vivantes en contexte, c’est-à-dire sur leur lieu de vie et dans le réseau de liens qui les lient aux autres espèces. Cette méthode sera spontanément adoptée par les scientifiques qui, à partir du XVIIe siècle se lancent dans l’exploration du monde pour étudier et découvrir ce que ne pouvait leur révéler l’étude d’individus isolés dans des espaces artificiels. Il parut clair que cette approche offrait beaucoup plus de potentialités. Elle impliquait que les individus en question étant fortement dépendants de leurs communautés multiples d’appartenance, il n’était possible de comprendre certaines de leurs particularités physiologiques ou comportementales qu’en les replaçant dans le système naturel de relations complexes au sein duquel ils remplissaient des fonctions particulières et dont ils dépendaient par ailleurs pour leur survie, à savoir leur milieu. Leur milieu, c’est-à-dire le contexte le plus approprié pour leur fournir les informations nécessaires à l’adoption d’un comportement conforme à la préservation de leur équilibre.
Le mot « Oekologie » sera forgé par le biologiste allemand Ernst HAECKEL (1834-1919), et utilisé pour la première fois en 1866 dans la première édition de sa Morphologie générale des organismes . Il est formé de deux racines grecques : oïkos et logos, la science.
Le mot, « écologie » est construit comme « économie » et dérive comme le note Pascal ACOT , « pour une partie, du thème indo-européen weik, qui désigne une unité sociale immédiatement supérieure à la maison familiale. Ce thème donna, entre autres, le sanskrit veçah (maison), le latin vicus qui désigne un quartier, et le grec oïkos, l’habitat, la maison ».
L‘écologie signifie donc littéralement « la science de l’habitat » . Haeckel la définit ainsi : « par écologie, nous entendons la totalité de la science des relations de l’organisme avec l’environnement, comprenant au sens large toutes les conditions d’existence ». Cette définition constitue encore le fond de la plupart des définitions actuelles de l’écologie scientifique. L’écologie est une science tout entière tournée vers l’étude des relations entre les groupes. On pourrait presque dire que, pour les écologistes, et du point de vue de la priorité donnée dans l’approche de leur objet d’étude : la relation précède l’essence.
Victor Émile SHELFORD, pionnier de l’écologie américaine la définira lui comme “la science des communautés” et écrira : « Une étude des rapports d’une seule espèce donnée avec son environnement, qui ne tient pas compte des communautés et, en définitive, des liens avec les phénomènes naturels de son milieu et de sa communauté, ne s’inscrit pas correctement dans le champ de l’écologie »
De fait, biosphère, semble, à bien des égards engagée dans un processus dominant menant à une progressive et mortelle entropie sous la pression croissante de l’impact des activités humaines. Les exemples qui en témoignent sont nombreux :
La France comptait plus de 4000 espèces de pommes au début du siècle, Il est devenu difficile d’en recenser une centaine et 5 espèces assurent à elles seules 95 % de la consommation. En France, là où étaient répertoriées au XIXe siècles 88 variétés de melons, on n’en trouve plus guère que 5. Jacques Barrau, un ethnobotaniste, écrit, qu’en 1853, les frères Audibert, pépiniéristes provençaux offraient à la vente 28 variétés de figues, alors qu’on n'en trouve plus guère que 2 ou 3 aujourd'hui. On pourrait continuer comme cela durant des heures.
Le biocide est aussi à l’oeuvre pour écraser la diversité interspécifique et intraspécifique des communautés humaines. Pensons aux cultures, régionales, locales, en France, mais aussi partout en Europe et dans le monde. Nous pensons à ces communautés chassées de leurs terres par des projets pharaoniques imposés par les multinationales et leurs relais, en Inde, ou ailleurs. Pensons à ces peuples broyés par la mécanique implacable de la loi des marchés : Les indiens guaranis parqués comme du bétail et qui ne survivent plus qu’en louant leurs bras aux industries d’alcool qui les empoisonnent comme avant eux plus de 90% des indiens d’Amazonie ont déjà disparu. Ailleurs, ce sont Les Bushmen chassés de leur territoire pour faire place aux industries touristiques, Les Aborigènes déplacés de leurs terres ancestrales pour y effectuer des essais nucléaires, les paysans en Europe en Afrique ou ailleurs. Pensons encore aux tibétains dont les autorités chinoises organisent méthodiquement le génocide par l’assimilation, l’acculturation et la terreur policière, pendant que le chef de l’Etat français se fait en Chine le VRP d’une industrie qu’il croit encore nationale.
Cette homogénéisation culturelle conduit, précisément, par un significatif phénomène de rétroaction à l’accélération de l’homogénéisation et de la standardisation des paysages. Car les paysages que nous connaissons, en Europe en particulier sont le résultat d’une longue interaction entre les communautés humaines et l’ensemble des autres espèces vivantes qui composent son milieu, comme de la nature de ses sols et de son climat.
Et parce que l’homme est un être qui intervient sur son milieu, à la diversité des écosystèmes répond la diversité des cultures et des modes de représentation du monde et rétroactivement, à la diversité des modes de représentations du monde répond la diversité des écosystèmes.
Pour le dire autrement, lorsque les hommes vivent, parlent et pensent différemment, ils interviennent différemment sur leurs milieux, et leurs activités peuvent ainsi contribuer à renforcer la typicité d’un paysage.
La diversité des cultures participe ainsi de et à la diversité des écosystèmes. En conséquence, dans une vision écologiste qui reconnaît l’humanité comme espèce et comme partie de la nature, la diversité culturelle - et l’organisation spécifique qui lui correspond - sont à la fois une valeur et une nécessité.
Aujourd’hui, de nombreux penseurs écologistes défendent bien la thèse selon laquelle, un système, en augmentant sa diversité, élargit la gamme des pressions écologiques auxquelles il est capable de faire face. En un mot que la biodiversité accroît la stabilité d’un système en augmentant ses possibilités d’adaptation aux discontinuités qui le menacent.
Nous dirons plutôt que c’est l’accroissement de la complexité (à ne pas comprendre avec la diversité), qui augmente la stabilité du vivant. Même si, évidemment, la diversité des parties d’un ensemble est la condition sine qua non de sa capacité de complexification. Il faut comprendre le terme « complexe » dans son sens étymologique, « ce qui est tissé ensemble » , non pas les parties différentes d’un conglomérat aléatoire, mais les parties ordonnées d’un système vivant.
Pour être plus clair, la diversité n’est facteur de stabilité pour les systèmes vivants que si les parties sont complémentaires, homéothéliques c’est-à-dire de simplement différenciées, deviennent « complexes », organisées en écosystème, à l’intérieur duquel ils remplissent tous une fonction compatible avec la préservation de l’écosystème tout entier.
Jean DORST écrivait « Le maintien de la diversité de la nature et des espèces est la première loi de l’écologie ».
L’écologie, est une culture qui nous porte à vouloir connaître les lois à l’oeuvre dans le monde afin de mieux penser, de mieux comprendre et donc de mieux agir sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Aux antipodes des utopies économiques du XVIIIe, des utopies sociales du XIXE et des utopies politiques du XXe siècle, l’écologie s’oppose à toute réflexion décontextualisée, utopique.
Pour les écologistes et au contraire des libéraux, l’économie n’est pas une sphère d’activité humaine autonome, fonctionnant selon ses propres lois et pour ses propres fins, indépendamment des nécessités et des lois qui gouvernent tous les autres processus à l’oeuvre dans la nature.
Nous nous inscrivons en rupture avec l’économisme dans sa prétention à réduire notre rapport aux autres, humains où non, , à une somme d’intérêts matériels, à une marchandise et donc à une quantité de cet équivalent universel qu’est l’argent, et à l’aune duquel on veut saisir, mesurer, maîtriser, réquisitionner, instrumentaliser, la totalité du vivant.
Évidemment, nous ne nions pas pour autant l’importance et la nécessité des fonctions de production, d’échange et de consommation. Mais ces fonctions restent pour nous indissociables des rapports sociaux, politiques et culturels, bref d’une identité collective dans laquelle elles s’enracinent, se subordonnent et s’harmonisent.
Ainsi, la fonction économique reste « contextualisée », réaliste, c’est-à-dire insérée dans un espace social, politique, culturel, la Nation, mais aussi plus largement naturel et vivant.
Contrairement au libéralisme qui s’appuie sur un corpus scientifique obsolète, l’écologie cherche à établir des lois pour l’organisation des sociétés humaines en s’inspirant et en s’instruisant de l’observation scrupuleuse des lois de la biosphère. L’écologie comme mouvement culturel, consiste en une valorisation a priori de la diversité organisée du vivant (la biocomplexité), cette diversité menacée des espèces, des paysages et des cultures qui font la beauté et la richesse du monde que nous aimons. L’écologie ne consiste pas en une simple succession de revendications à caractère environnemental ou en on ne sait quel projet d’unification planétaire sous les auspices d’une spiritualité de pacotille. Elle est un mouvement de décolonisation intégral qui se propose de mettre fin à la colonisation multiforme (économique, culturelle et technologique) du monde par la civilisation industrielle et l’idéologie libérale pour que reprenne la poursuite de la différenciation et du perfectionnement de la vie sous toutes ses formes.
Laurent Ozon (Blog politique de Laurent Ozon, 5 juillet 2011)