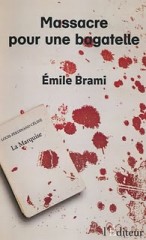Diversité et métissage : un mariage forcé. La pensée-slogan dans le débat sur l’identité française
Périodiquement, lorsqu’on redécouvre que l’identité française a perdu sa valeur d’évidence, on se met à en parler abondamment [1]. Phénomène éclairé depuis longtemps par ce célèbre proverbe russe : « On ne parle jamais tant de vodka que lorsqu’il n’y a plus de vodka. » La différence entre l’identité française et la vodka, c’est que celle-ci existe indépendamment de celui qui en boit, alors que celle-là n’existe que pour celui qui y croit. Dans les deux cas, le sentiment d’un tarissement ou d’une disparition prochaine pousse à en dire quelque chose. Et, concernant une identité nationale perçue comme menacée, tout peut s’en dire, selon l’idée qu’on s’en fait. De l’identité française, par exemple, les intellectualistes arrogants et les professionnels de la « pensée critique » ou de la « déconstruction » sans fin annoncent triomphalement qu’elle n’existe pas, qu’elle n’est qu’une « construction » douteuse ou une fiction trompeuse, et par là dangereuse, voire haïssable. Travers ordinaire des intellectuels occidentaux qui s’exercent pieusement à faire disparaître les objets qu’ils n’aiment pas ou qui ne font pas partie de leur paysage mental. La « nation » se réduit pour eux à un chaudron de sorcières, à un conservatoire de « vieux démons » (nationalisme, xénophobie, racisme, colonialisme). En quoi la pensée hypercritique, banalisée à la fin du XXe siècle et ainsi devenue vulgate à l’usage du grand public « culturel », s’avère une pensée aussi paresseuse que phobique. D’autres intellectuels, qui se veulent « patriotes » et « républicains » - dénoncés par les précédents comme « nationalistes » ou « réactionnaires » -, s’emploient naïvement à célébrer ladite « identité française » en sélectionnant ses traits positifs les plus remarquables, censés représenter autant d’« apports », aussi précieux qu’indispensables, à « la civilisation universelle ». Par de tels exercices d’admiration, ces intellectuels se classent parmi les héritiers du vieux progressisme républicain, postulant que, chez les Modernes, « la nation » est le cadre obligé de la démocratie. Une troisième catégorie d’intellectuels est repérable dans les milieux militants de gauche et d’extrême gauche en quête d’une « nouvelle France », d’une France future, refondue, améliorée. Ces intellectuels néo-progressistes, internationalistes ou « altermondialistes, s’engagent sur la voie d’un réformiste radical, impliquant une rupture avec la tradition nationale/républicaine. Ils communient dans une redéfinition politiquement correcte de l’identité française, que résume cette formule sloganique : la « France plurielle et métissée », à l’image du « monde possible » dont ils rêvent. Tel est l’objet métaphorique d’un désir d’avenir fonctionnant déjà comme un cliché.
« L’identité est le diable en personne, et d’une incroyable importance », notait Ludwig Wittgenstein. Sa démonie tient à ce qu’elle est insaisissable, toujours autre qu’elle n’est pour qui la définit. Entité individuée assimilable à un individu collectif, mais supra-individuelle, l’identité collective résiste à toute approche conceptuelle. Il n’y a toujours pas de science de l’individuel, en quoi l’on ne saurait s’étonner du fait que les identités nationales ne soient pas objets de science. En toute identité collective, le « ce qu’elle est » ne cesse de nous échapper. Mais ce n’est pas là une preuve de son inexistence. Le fait qu’elle résiste à la conceptualisation n’implique nullement qu’elle n’existe pas. Indéfinissable en elle-même, inconceptible, une identité collective quelconque existe sur un mode particulier, dans le monde des croyances et des représentations sociales : elle est le nom qu’on donne à la présupposition d’existence de tout groupe humain, dont la singularité échappe à l’analyse conceptuelle. Disons simplement qu’une identité collective, ethnique, culturelle ou nationale, est à la fois existante et ineffable. On pourrait s’en tenir là, et cesser les bavardages pour ou contre. Mais le bruit de fond de l’univers médiatique continue.
Le thème de « l’identité nationale » revenu dans le débat public, les donneurs de leçons se lèvent à gauche, du centre aux extrêmes, pour se lancer dans une nouvelle célébration confuse de la France future, à la fois « plurielle » et « métissée » comme il se doit, grâce aux bienfaits de « l’immigration ». On ne discute pas l’idéal du Nous : on l’affirme vertueusement. Sur le mode d’une prière tournée vers l’avenir. Un éditorialiste bien-pensant, lui-même expression ramassée de la « gauche plurielle », affirme ainsi péremptoirement : « La France est d’ores et déjà plurielle. On ne saurait le nier, à l’heure de l’Europe et de la mondialisation, qui sont par nature mélange et métissage. » Et le sous-entendu normatif va tout autant de soi : la France doit être toujours plus ce qu’elle est déjà, à savoir « plurielle » et « métissée ». On ne sait jamais exactement de quoi l’on parle : du métissage des corps (les croisements dits « ethno-raciaux ») ou du « métissage des cultures » (à travers le « dialogue interculturel »), de la « diversité » ou du « mélange », du « pluriel » ou du « métissé ». La question n’a plus d’importance dans la société de communication : le cliché a été forgé, il est désormais en circulation, il touche un maximum de récepteurs, il est donc légitime. Et la force des clichés est irrésistible, lorsqu’ils se diffusent autant sur Internet que sur les chaînes de radio et de télévision. Le nombre s’accroît donc de ceux qui veulent à la fois une « France plurielle » et une « France métissée » : qu’importe la confusion des désirs, si la diffusion du confus est en marche. Il s’agit de penser et de parler comme tout le monde, donc comme le monde des médias. La voix des médias est la nouvelle voix de Dieu. Tiraillé entre deux projets normatifs, le pluralisme et le mélangiste, le « bobo » grégaire – nouvelle figure du Français moyen - se refuse à choisir : il aspire à la synthèse pour la synthèse, il veut donc les deux, alors même qu’il perçoit vaguement leur incompatibilité de principe.
En construisant une belle image de la France, belle comme une métaphore embrumée, délivrant des éclairs d’équivoque, la bien-pensance nourrit la bonne conscience qui la supporte. Il est si doux de se rêver soi-même comme un sujet « pluriel » et « métissé », qu’il s’agisse de couleur de peau ou d’identité culturelle. Un sujet supposé plus « riche » que son contraire : le nouveau sujet désavantagé, identitairement pauvre, défavorisé. Un « pauvre » Français caractérisé par ce qui lui manque : une « diversité » interne. Un Français très à plaindre, car ni « pluriel », ni « métissé ». En effet, selon la langue molle d’un certain antiracisme, l’idéal humain vers lequel il faut tendre est clair : devenir un sujet « riche de ses différences ». Face à ce nouveau type positif, le Français monoethnique et monoculturel, le Français dit « de souche », apparaît comme un être inférieur, un handicapé, un « souchien », selon l’expression polémique méprisante (« sous-chien ») utilisée par les « Indigènes de la République ». La bonne voie serait celle qui va du mono-ethnique au pluri-ethnique, de l’identité culturelle homogène à l’identité culturelle « hybride ». Toutes ces intuitions vagues et ces aspirations confuses ne font certes pas une pensée. Encore moins une pensée politique, laquelle doit pouvoir être programmatiquement traduite. Il y a là pourtant au plus profond, inassumé, un sentiment qu’il faut bien dire « patriotique » : comment qualifier autrement le souci de projeter dans le monde l’image la plus attrayante possible de la France ? Un tel souci est certainement respectable. Le problème tient au choix des critères de ce qui est jugé attractif. En quoi le « pluriel » et le « métissé » sont-ils plus dignes d’admiration que ce à quoi on les oppose ? Pourquoi préférer la « diversité », source d’inégalité et de conflit, à l’homogénéité ou à l’unité ? Pourquoi prendre le parti du « mélange », promesse d’indifférenciation, contre celui de la distinction ou de la différenciation ? Un second nœud de problèmes surgit, dès lors qu’on érige la « diversité » et le « mélange » en principes normatifs : leurs logiques respectives sont-elles compatibles ? Ne se contredisent-elles pas ? Peut-on marier « diversité » et « métissage » pour en faire le couple fondateur d’un programme politique ? La synthèse est-elle possible ? Et, si oui, est-elle désirable ?
« Faire bouger les lignes » : la métaphore est devenue rituelle dans le langage médiatique « à l’heure de la mondialisation ». Elle y est même devenue ritournelle. Elle y définit la norme positive par excellence, celle du « bougisme », soit le culte du changement pour le changement, l’adoration du mouvement comme tel, supposé intrinsèquement bon. Appliquons-nous à reconstruire l’idéologie médiatiquement dominante, en risquant une plongée dans l’univers indistinctement « diversitaire » et « mélangiste ». Le « faire bouger » s’applique d’abord aux identités collectives, acceptables à la seule condition d’être « évolutives », « dynamiques », en perpétuel changement. Et, à suivre leurs louangeurs, elles ne sont « mises en mouvement » qu’en devenant « plurielles ». Mais le parti pris en faveur du « bouger » s’étend aussi au « métisser ». Les partisans du métissage généralisé ne cachent pas leur désir de « faire bouger les lignes » entre les « couleurs », de transformer les barrières de couleur en fils colorés servant à tisser et retisser les séduisantes « identités plurielles ». Cette vision d’un avenir radieux est fondée sur deux axiomes : le changement est amélioration, le mélange est « enrichissement » (métaphore utilisée aveuglément). Mais ces deux propositions ne font qu’exprimer des croyances, et, ainsi formulées, elles sont l’une comme l’autre fausses : tout changement n’implique pas une amélioration, tout mélange ne constitue pas un « enrichissement ». Comme l’a souvent suggéré Claude Lévi-Strauss, le mélange des cultures risque d’aboutir à un appauvrissement universel et irréversible, à une uniformisation mortelle.
L’idéal bougiste, engagé sur la voie de cet « antiracisme » reformulé, rejoint enfin à la fois l’idéal d’ouverture et celui d’échange illimité : ouvrir les frontières entre les identités collectives, pour que ces dernières échappent à la « crispation » (la fermeture craintive sur soi), se fluidifient et « s’enrichissent » mutuellement dans un libre échange qui, par ses effets d’« hybridation », définirait la globalisation comme étape décisive dans la marche vers la libération ou l’émancipation du genre humain. On retrouve ainsi, sous de nouveaux habits rhétoriques, le dogme central de la vieille « religion du Progrès ». On peut au passage s’étonner d’un paradoxe : les partisans de ce projet normatif d’un « dialogue » universel entre les groupes humains (nations, cultures, civilisations), impliquant un libre échange planétaire des mots et des idées, sont en général des adversaires déclarés du marché globalisé, du libre-échange sans frontières, du libre-échangisme comme idéologie du capitalisme sans entraves. Le propre - ou le travers - de cette rhétorique qui semble réfléchir les présuppositions de la globalisation telle qu’elle est rêvée, la globalisation comme Progrès (la « mondialisation heureuse », disent certains), c’est qu’elle ne comporte nulle interrogation sur la coexistence conflictuelle des normes « diversitaires » et « mélangistes » qu’elle s’applique à promouvoir. Comme si l’aveuglement face au conflit de ses normes fondamentales était une condition de son efficacité symbolique. « La diversité dans le mélange » : c’est ainsi qu’on pourrait définir l’idéal auto-contradictoire dont elle dessine les contours flous.
Ouvrons ici une parenthèse sur l’autre face de cet angélisme impolitique, sa face à la fois sombre et comique : le nihilisme militant des cyniques de la déconstruction sans limites, généralisée jusqu’à l’absurde, ou, comme disaient naguère les grands-mères, « en dépit du bon sens ». On les reconnaît à leur pose : ils se donnent pour de radicaux démystificateurs. Rien ne saurait résister à leur puissance de suspecter et de critiquer les phénomènes sociaux, jusqu’à ce qu’ils disparaissent de leur horizon. Ce qu’ils ont retenu de la leçon unique donnée à la fin du XXe siècle par les gourous de la déconstruction – philosophes, anthropologues, historiens -, suivis par les prolétaires des « sciences sociales » et autres adeptes besogneux de la « sociologie critique », c’est qu’il n’est qu’un péché capital : l’essentialisme. Un programme unique s’est imposé à eux, devenus des adeptes dogmatiques de la déconstruction généralisée : déréaliser, désontologiser, désubstantialiser, fluidifier. La peur de l’essentialisme les a conduits à aller jusqu’au bout du relativisme radical, jusqu’à faire disparaître le réel. Ils se sont ainsi laissé convaincre qu’il fallait surtout ne pas penser les identités collectives comme des entités réelles ou substantielles, que rien dans les entités supra-individuelles mais pourtant individuées n’était fixe, invariable, stable, homogène, etc. Que tout dans les identités collectives était construit et reconstruit en permanence, que tout était fluctuant, passager, éphémère, et, en dernière instance, simple illusion. Car, sous leur regard à qui on ne la fait pas, tout dans la socialité n’est qu’effet produit par des stratégies de pouvoir ou de domination, donc rapportable au pouvoir de tromper inhérent aux dominants. Qu’on ne leur parle surtout pas d’identité nationale : ils ricanent (« ça n’existe pas ») et sortent leurs revolvers, chargés de balles explosives. Chez eux, le plaisir de déconstruire, c’est la joie de détruire, avec un supplément notable : la satisfaction arrogante d’avoir tout compris. Ils ne croient à rien, parce qu’ils ne peuvent croire. Ils ne savent rien, puisque leur activité intellectuelle consiste à déconstruire tous les savoirs. Ils croient néanmoins être les plus malins, persuadés qu’il n’y a rien à savoir en dehors de ce qu’ils croient savoir. Et ils ne peuvent rien espérer, l’espérance ne pouvant être à leurs yeux qu’une variété judéochrétienne de l’illusion religieuse. Ce nihilisme de cyniques tristes et d’arrogants sans charisme se conjugue cependant fort bien avec l’optimisme angélique des nouveaux progressistes, portés par l’espoir d’un salut par la globalisation-hybridation. On rencontre ainsi des êtres mixtes : mi-nihilistes déconstructeurs, mi-utopistes rêveurs. C’est pourquoi tant de déconstructeurs radicaux sont en même temps des militants gauchistes en quête d’un « autre monde possible ». Le monstre « hybride » est parmi nous : les « Bourdieu-Derrida-Chomsky » sont légion.
Considérons plus précisément le projet normatif d’une ouverture totale de l’espace national, en tant que forme radicale de combat « antiraciste ». La différenciation entre « nous » et « les autres » est le présupposé inaperçu autant qu’inassumé de cette argumentation qui se veut à la fois morale et politique. La xénophobie, assurément condamnable, est naïvement inversée en xénophilie, comme si le renversement dans le contraire impliquait un « progrès ». C’est ainsi que, dans l’arène politique, la dénonciation de la « préférence nationale » aboutit à la célébration d’une préférence pour l’étranger ou l’immigré : la xénophilie de style antiraciste se traduit par un programme immigrationniste - l’utopie angélique interdisant toute sélection des candidats à l’immigration -, qui rend impossible la définition d’une politique de l’immigration. L’utopie de la préférence pour l’autre conduit à une impasse, à une paralysie de la capacité de choix des dirigeants politiques, à l’abolition de la souveraineté en matière de politique de la population, bref à l’impolitique. Cette rhétorique impolitique est fondée sur certaines valeurs, le plus souvent implicites, non thématisées comme telles. Ce qui est axiologiquement postulé, c’est d’abord que le rejet de soi est en lui-même respectable, alors que le rejet de l’autre est intrinsèquement intolérable. Le culte de la « diversité » dérive vers celui de l’altérité. L’adoration du « veau d’autre »… Un pas de plus, et la haine de soi devient objet d’éloge, tandis que la haine de l’autre illustre le mal absolu. Comme s’il était bon, dans tous les cas, de se dénigrer jusqu’à se haïr soi-même, et totalement condamnable d’abaisser ou d’exclure, quoi qu’il fasse, un quelconque représentant de la catégorie « les autres ». Nouveau manichéisme, qui surgit chez ceux-là mêmes qui font profession de dénoncer le manichéisme chez leurs ennemis désignés. On notera que la haine de l’autre porte différents noms idéologiques, tous équivalents pour ceux qui les utilisent en tant qu’armes symboliques : intolérance, exclusion, xénophobie, nationalisme, racisme. Il y a une ironie objective à voir les partisans inconditionnels de « la diversité » faire aussi peu de cas de la diversité sémantique, et donner ainsi dans l’amalgame polémique.
Cette confusion sémantique est hautement significative, en ce qu’elle indique obscurément un idéal régulateur : le cosmopolitisme postnational, noyau dur de l’idéologie médiatiquement dominante. Il s’organise autour d’un grand rêve, celui de l’abolition immédiate et définitive de toutes les frontières entre les groupes humains, et, plus avant encore dans l’utopie, celui de l’élimination totale et irréversible de toutes les barrières entre les humains. Rêve lui-même impolitique, qui dérive de la corruption idéologique d’une vision religieuse d’origine monothéiste (tous les hommes unis en Dieu). Disons, en termes soixante-huitards : « La fraternité universelle ici et maintenant ». Le métis nomade à l’identité instable dans un monde sans frontières serait l’image de l’humanité future. L’homme de l’avenir s’incarnerait dans le cosmopolite hybride et mobile. Tel est le bouillon de clichés et de slogans confus qui aujourd’hui tient lieu de pensée politique aux élites pressées et branchées, adeptes de la « pensée nomade ». On peut s’interroger sur l’avenir d’une telle confusion.
Mais, une fois envolées les nuées rhétoriques et dissipées les rêveries endormantes, la vraie question se pose : s’agit-il de défendre les identités ethnoculturelles au nom du « pluriel » ou de prôner leur « mélange » qui tend à les effacer ? Souhaite-t-on le bétonnage des différences ou leur dissolution dans un mélange sans frontières ? Veut-on une France de la « diversité » protégée, ou bien une France du « métissage » généralisé ? Et, plus largement, une humanité respectée dans sa diversité ethnique et culturelle, ou bien une humanité en marche vers son uniformisation ? Entre le respect absolu de la différence ou l’obligation inconditionnelle de métissage, il faut choisir. Or, les nouveaux bien-pensants veulent les deux. Pour ces amateurs de formules creuses, la France de l’avenir ne peut qu’être un mélange de diversité et de métissage, de différence et d’hybridation. Vision confuse d’une synthèse impossible. « Synthèse égale foutaise », disait le philosophe Jean Laporte. Cette « foutaise » synthétique pourrait être correctement dénommée : « divertissage ». Toute occasion est bonne à prendre quand il s’agit d’enrichir le verbiage contemporain. Ironie oblige.
Pierre-André Taguieff (Sur le ring, 23 novembre 2009)
[1] Dans les années 1980 et 1990, j’ai abordé à plusieurs reprises la question de l’identité, sous des angles différents. Sur la question de l’identité nationale, voir notamment Pierre-André Taguieff, « L’identité française au miroir du racisme différentialiste », in coll., L’Identité française, Paris, Éditions Tierce, 1985, pp. 96-118 ; « L’identité nationale saisie par les logiques de racisation. Aspects, figures et problèmes du racisme différentialiste », Mots, n°12, mars 1986, pp. 89-126 ; « L’identité nationaliste », Lignes, n° 4, octobre 1988, pp. 14-60 ; « Identité française et idéologie », EspacesTemps, n° 42, automne 1989, pp. 70-82 ; « L’identité nationale : un débat français », Regards sur l’actualité, n° 209-210, mars-avril 1995, Paris, La Documentation française, pp. 13-28 ; « Nationalisme et antinationalisme. Le débat sur l’identité française », in coll., Nations et nationalismes, Paris, Éditions La Découverte, 1995, pp. 127-135 ; La République menacée, Paris, Éditions Textuel, 1996, pp. 77 sq. Dans les années 2000, je suis revenu sur la question dans mon livre La République enlisée. Pluralisme, communautarisme et citoyenneté, Paris, Éditions des Syrtes, 2005.