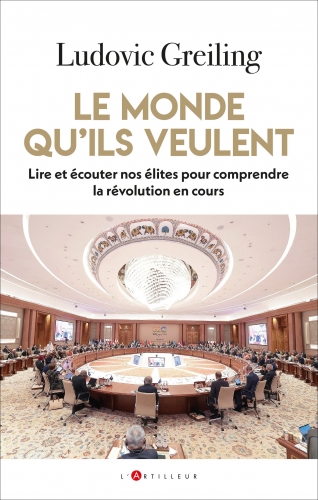Pourquoi les socialistes se sont-ils convertis au néolibéralisme peu après être arrivés au pouvoir, en 1981, se demande Jean-Pierre Chevènement dans son dernier livre, La France est-elle finie ? (Fayard, 315 pages, 19 euros). A l'approche de la présidentielle, l'ancien ministre socialiste explique pour L'Expansion les raisons de ce tournant dont ses anciens camarades ne sont jamais revenus. Au passage, il en étrille quelques-uns.
Pourquoi pensez-vous que la gauche doit réévaluer l'histoire du tournant économique du début des années 80 ?
A chaque étape, la gauche n'est repartie qu'en se mettant au clair avec elle-même. Or, en 1981, à l'instar de Christophe Colomb, la gauche française a cru découvrir les Indes - le socialisme -, et elle doit réaliser qu'elle a trouvé l'Amérique - le néolibéralisme. Même si l'environnement international n'était pas favorable, rien n'obligeait les socialistes français à opérer ce tournant néolibéral, ni à aller aussi loin : l'Acte unique européen, négocié par Roland Dumas, et la libération totale des mouvements de capitaux, y compris vis-à-vis de pays tiers, ou l'abandon de la clause d'harmonisation fiscale préalable qui figurait dans le traité de Luxembourg. Ou encore le Matif [Marché à terme international de France], créé en 1984, et la loi de libéralisation financière, en 1985. Tout cela était une manière de mettre Margaret Thatcher au coeur de la construction européenne, d'accepter d'abandonner l'Europe, pieds et poings liés, au capitalisme financier. En critiquant ces choix, je n'ignore pas l'existence du monde extérieur, mais on n'était pas obligé d'appliquer toutes les règles de la doxa néolibérale. On aurait pu maintenir quelque chose ressemblant à une économie mixte. L'Etat pouvait garder la maîtrise de quelques mécanismes de régulation essentiels. L'idéologie néolibérale a fait admettre comme vérité d'évangile que, grâce à la désintermédiation bancaire, les entreprises s'alimenteraient à plus faible coût sur les marchés financiers. L'entrée dans une mécanique irréversible en souscrivant à toutes les dérégulations prévues par l'Acte unique, la libéralisation des mouvements de capitaux, l'interdiction des politiques industrielles et des aides d'Etat, l'introduction de la concurrence dans les services publics, tout cela, personne ne nous le demandait vraiment.
Quels ont été les motifs des architectes de cette politique ?Robert Lion et Jean Peyrelevade, qui dirigeaient alors le cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy, Philippe Lagayette, qui était aux manettes de celui de Jacques Delors aux Finances, comme tous les hiérarques du ministère de l'Economie et des Finances, Michel Camdessus, directeur du Trésor, Renaud de La Genière, gouverneur de la Banque de France, et plus tard Jean-Claude Trichet, lui aussi à la tête du Trésor, ou Pascal Lamy, directeur de cabinet du président de la Commission européenne (1), tous croyaient fermement à la théorie de l'efficience des marchés. Ils étaient convaincus que tout ce qui était réglementation devait disparaître pour sortir de ce qu'ils appelaient l'"eurosclérose" et libérer l'économie des contraintes bureaucratiques qui l'empêchaient de se développer. Comment tant d'hommes dont je ne puis suspecter l'honnêteté ont-ils pu opérer pareille conversion ? Cette énigme doit être résolue.C'étaient des représentants de la haute fonction publique...
Haute fonction publique qui avait, pour l'essentiel, sa carte au Parti socialiste, où, il est vrai, elle était plutôt orientée "deuxième gauche". Personne parmi eux n'était résolu à mener une politique un tant soit peu volontariste. Tout s'est passé comme s'il leur fallait user la gauche au pouvoir et l'amener au "tournant libéral" que la technocratie bien-pensante avait, déjà avant 1981, imaginé pour elle. On les appelait "les rocardiens" ; en fait, ils étaient partout, et Rocard n'y était pour rien ! Tout cela a été conçu par des gens qui savaient où ils allaient et qui étaient décidés à se faire un allié de la puissance des marchés. Jacques Delors était cohérent. Il a passé consciemment un pacte avec ce qu'il appelle "les vents dominants" de la mondialisation. Très peu de gens dans l'administration, en dehors de ceux qui étaient avec moi à l'Industrie, s'opposaient à ce courant dominant, et la plupart de ceux qui avaient la charge d'appliquer le programme sur lequel François Mitterrand avait été élu, en 1981, n'y croyaient tout simplement pas. Il y avait une sorte de frénésie idéologique qui voulait que plus on libéralisait, plus on était "moderne".
Mais où était le Parti socialiste ?
Le Parti socialiste était presque absent sur les questions industrielles, monétaires et de régulation, qui lui paraissaient très techniques. Il estimait qu'il s'agissait d'une parenthèse qui ne changeait pas les orientations fondamentales, à commencer par le souci prioritaire de l'emploi. Le premier secrétaire du PS d'alors, Lionel Jospin, s'est porté garant de cette continuité politique et de l'absence de tournant réel, d'autant que François Mitterrand affirmait haut et fort ne pas avoir changé d'orientation. Le Parti communiste n'intervient pas non plus en 1983. Car il ne veut pas apparaître comme le parti de la dévaluation. L'affaire ne se joue finalement qu'entre un très petit nombre d'hommes.
C'est donc Jacques Delors qui a joué le rôle clé ?
Il était lié à François Mitterrand depuis les années 60. C'était un militant chrétien social, l'homme du dialogue social au cabinet de Jacques Chaban-Delmas. Je le reconnais comme un maître en idéologie. Il a toujours agi avec une bonne conscience inaltérable. Son discours pieux déconnectait parfaitement l'économique et le social, et, avec son disciple Pascal Lamy, il était sans doute convaincu que l'autorégulation des marchés tendait à favoriser la croissance. J'aime ces deux-là. Leur dogmatisme libéral sans peur et sans reproche, tout enrobé de bonne conscience chrétienne moralisante, fait plaisir à voir !
Delors jouait dans les médias le rôle de saint Sébastien, criblé de flèches par ses camarades de parti, alors qu'il organisait le désengagement de l'Etat et la désintermédiation bancaire. Mystification conceptuelle qui conduisit en fait à l'explosion des revenus financiers. Mais je ne crois pas qu'il ait bien vu monter le capitalisme financier à l'horizon de la société. A l'époque, très peu de gens avaient compris qu'on avait tourné la page de l'ère du New Deal et du keynésianisme. Ne mesurant sans doute pas ce qu'il faisait, c'est lui qui a mis en place la dérégulation sur le continent. Il a fait la politique que Margaret Thatcher et Ronald Reagan appliquaient en Angleterre et aux Etats-Unis.
Mitterrand n'y comprenait pas grand-chose, mais il souhaitait un accord européen, car il ne voulait pas que la France soit "isolée". Il raisonnait comme si elle était toujours le n° 1 en Europe. Quand il poussera à l'adoption de la monnaie unique, il ne verra pas non plus que la réunification allait faire de l'Allemagne le pays central, gouvernant l'euro comme un "mark bis".
Depuis, la conversion au néolibéralisme ne s'est plus démentie, puisque c'est Dominique Strauss-Kahn, ministre des Finances de Jospin, qui autorisera le rachat d'actions par les entreprises. Comment l'expliquer ?
Dominique Strauss-Kahn a théorisé la non-intervention de l'Etat dans l'économie lors d'un séminaire tenu à Rambouillet en septembre 1999. Je fus alors le seul, avec Martine Aubry, à le contredire. Deux semaines plus tard, Lionel Jospin dira que "l'Etat ne peut pas tout faire". Ce qui se jouait, c'était l'idée que l'Etat n'avait plus rien à faire dans l'organisation de l'économie et que les décisions de structures devaient être laissées à des autorités indépendantes. Dominique Strauss-Kahn en fut le théoricien, ce qui l'amena, par exemple, à liquider les dernières participations de l'Etat dans Usinor.
Si vous lisez son rapport à Romano Prodi en 2004, il est à mes yeux proprement confondant d'irréalisme. Il propose littéralement de former une nation européenne, de faire des listes plurinationales aux élections, de créer des médias transnationaux. On y sent à l'oeuvre la volonté de gommer la nation et d'en faire disparaître les repères. Comme chez Jean Monnet, qui est quand même, dès 1943, le grand inspirateur de cette construction d'une Europe par le marché. Vision purement économiciste, où la souveraineté populaire disparaît, happée par celle de l'empire (en l'occurrence américain).
Mitterrand ne s'est-il pas servi de la construction européenne comme d'un prétexte pour cacher ses abandons ?
Un prétexte, peut-être, mais aussi, chez lui, une conviction sincère. Je n'arrive d'ailleurs pas à rejeter sa vision, au moins quant à l'objectif final. L'idée que les peuples d'Europe doivent se rapprocher toujours plus me semble juste, surtout quand on est coincé comme aujourd'hui entre la Chine et les Etats-Unis. Le problème, ce sont les modalités de la construction européenne. Je ne crois pas que celle-ci impliquait un ralliement aussi complet au néolibéralisme. Pour construire une Europe "européenne", il ne fallait pas faire l'impasse sur les peuples, qui sont du ressort de la démocratie.
Pour vous, le socialisme n'a plus de sens aujourd'hui...
Je n'ai jamais beaucoup cru à l'autogestion. Mais je crois en la citoyenneté. Le socialisme, aujourd'hui, ça veut dire la perfection de la république, bref, la république sociale, comme l'avait pressenti Jean Jaurès. Le socialisme comme modèle de société toute faite dans laquelle on entrerait comme on enfile ses chaussures ne me séduit pas. Je n'aime pas me gargariser de formules dont je ne comprends pas le sens. Je suis viscéralement hostile à tout millénarisme et ne me range pas dans la catégorie des socialistes utopistes. "Aller à l'idéal, oui, mais comprendre le réel", disait Jean Jaurès.
Pourquoi les socialistes n'ont-ils pas refait cette histoire ?
Sans doute parce qu'ils restent prisonniers d'une confusion entre l'idée européenne et le logiciel néolibéral présent dans les traités qu'ils ont signés. Ils sont du parti du "Bien". Ils se veulent avant tout de "bons européens". L'Europe les sanctifie. Ils ne se rendent pas compte que l'Europe telle qu'ils l'ont façonnée est régie par des règles essentiellement néolibérales.
Ils ne sont pas idiots, quand même ?
Non, ils ne sont pas idiots, mais ils n'osent pas penser. Et puis leur ciment, c'est leur attachement au pouvoir. Etre "européen", c'est ce qui fait leur crédibilité vis-à-vis de gens qui ne pensent pas comme eux. François Mitterrand l'avait compris d'emblée en 1972 : je fais le Programme commun, disait-il, mais je suis européen, alors vous pouvez quand même me faire confiance.
Jean-Pierre Chevènement
Propos recueillis par Bernard Poulet (L'Expansion, 6 juin 2011)
(1) Jacques Delors à partir de 1984.