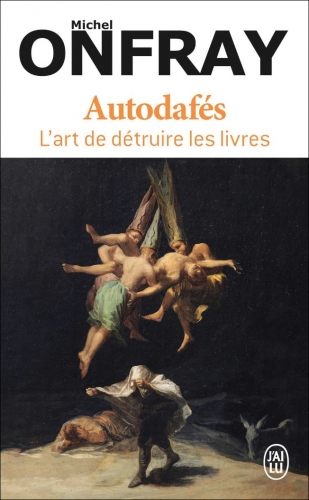Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Michel Festivi cueilli sur EuroLibertés et consacré à l'étranglement progressif de la liberté des peuples en Europe...
Avocat honoraire et ancien bâtonnier de l'ordre, Michel Festivi est l'auteur de plusieurs ouvrages historiques consacrés à l'Espagne de la première moitié du XXe siècle.

Les oligarchies contre les peuples, la menace du totalitarisme en Europe
Partout en Europe, dans une Europe passoire sans frontières protégées, submergée au demeurant par une immigration incontrôlée, le plus souvent illégale, gangrenée par une violence exponentielle, et livrée aux narcotrafics, les États profonds et les technostructures mondialisées recherchent par tous les moyens à empêcher la libre expression populaire, qui tente de s’opposer à la disparition de la civilisation millénaire, qui depuis Athènes et Rome, en passant par le Christianisme bâtisseur de nos Cathédrales, avaient façonné nos pays, nos lois, nos mœurs, nos coutumes, nos traditions et ont apporté au monde les splendeurs absolues de la littérature, de la peinture, des arts, de l’architecture, la France étant de surcroit « mère des arts, des armes et des lois », comme la décrivait Joachim du Bellay dans son recueils Les Regrets en 1558 .
Dans une envolée lyrique dont il avait le secret, Charles de Gaulle avait déclaré : « Il ne peut y avoir d’autre Europe que celle des États en dehors des mythes, des fictions, des parades ». Il avait rajouté : « Je ne crois pas que l’Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l’Allemagne avec ses Allemands, l’Italie avec ses Italiens, etc, Dante, Goethe, Chateaubriant appartiennent à toute l’Europe, dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment Italien, Allemand et Français. Ils n’auraient pas beaucoup servi l’Europe s’ils avaient pensé et écrit en quelque espéranto ou volapük intégré ». (Conférence de presse du 15 mai 1962).
Mais depuis, les temps ont bien changé. Désormais, c’est tout le contraire qui est entrepris, pour broyer les peuples, les supprimer, les nier, pour les agglomérer dans un magma informe et infect. Cette politique totalitaire se retrouve partout. En Roumanie, avec le scandale des annulations des élections qui allaient porter au pouvoir un anti-européiste convaincu largement gagnant dès le premier tour de scrutin. En Pologne, où la mobilisation bruxelloise a fini par faire revenir Tusk au pouvoir, mais heureusement n’a pas pu empêcher la victoire, à la présidentielle, du nationaliste Karol Nawrocki. En Géorgie, où tout est entrepris pour forcer la main mise de Bruxelles. En France, avec des tripatouillages électoraux entre les deux tours, qui ont empêché la victoire du RN en 2024, et la prise de pouvoir de juges non élus, qui entendent phagocyter la libre expression des citoyens par des révolutions institutionnelles et juridiques des plus dictatoriales, retoquant certaines lois sur des motifs les plus stupéfiants, et interdisant à certains candidats capables de parvenir au plus haut, de se présenter. Il faudra surveiller de près les prochaines élections en Moldavie, et l’an prochain en Hongrie, où les appareils internationaux se mobilisent comme jamais. La Grande Bretagne, pays à la pourtant longue tradition des libertés publiques, malmène ses opposants, n’hésitant pas à les emprisonner pour de simples délits d’opinion, même un comique, qui n’avait pas l’heur de plaire au pouvoir, avait été appréhendé à sa descente d’avion.
Mais c’est en Allemagne, où les éléments se déchainent avec le plus de force contre le peuple allemand. Et c’est l’AfD qui est au centre de toutes les attentions mortifères, pour l’éliminer, la dégager, et l’empêcher d’exister. Depuis sa création en 2013, elle est au centre d’une incroyable série de procédures policières, administratives et juridiques, car elle gène, elle dérange et ses immenses succès électoraux ravivent les intentions d’ostracisme à son égard.
J’ai décrit ici même, comment dans l’Ouest du pays, elle avait il y a quinze jours, triplée son score précédent à des élections locales en Westphalie. L’excellent site Breizh-Info nous apprend, qu’à Ludwigshafen, ville industrielle de Rhénanie-Palatinat, elle a été interdite de se présenter par le conseil municipal. L’argument sempiternellement avancé « la défense de la démocratie » ! Belle litote au demeurant, rejoignant celle du guillotineur Saint-Just, et préfigurant toutes les dictatures rouges « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Par tous les moyens, l’État allemand, avec la bénédiction des instances européennes, entend paralyser l’action de l’AfD, qui n’a qu’un tort, se présenter librement au suffrage des Allemands et y recueillir de plus en plus de succès, en luttant contre l’immigration invasive, la délinquance qui se multiplie, les escrologies climatiques et environnementales qui détruisent les industries, l’appauvrissement de ceux qui travaillent, la gabegie généralisée.
Le 2 mai 2025, l’Office de protection de la Constitution (sic), chargé du renseignement intérieur, a classé l’AfD comme un mouvement « extrémiste de droite confirmé », avec comme motif « les indices selon lesquels l’AfD aurait des aspirations contre l’ordre fondamental libéral et démocratique », sont devenus des « certitudes », pour cette police de la pensée, digne du ministère de la Vérité d’Orwell, dont son récit d’anticipation, 1984, n’a jamais été aussi près de la réalité. L’AfD a contesté cette décision, qui a été suspendue pendant la procédure d’appel, mais le risque est immense. En dernier ressort, c’est la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui tranchera.
Gageons que le combat, en Allemagne, comme partout en Europe est loin d’être fini. Les coups bas vont continuer à tomber comme à Gravelotte. Ainsi, on vient juste de l’apprendre, un tribunal du land de Berlin vient d’ordonner à l’AfD de quitter son siège national, donnant raison au propriétaire qui invoquait la violation par l’AfD de ses obligations lors de la soirée électorale de février 2025, célébrant son succès aux élections législatives. L’AfD devrait quitter les lieux à la fin de 2026, le motif invoqué, l’AfD avait projeté son résultat exceptionnel et son logo sur un des murs du bâtiment. Mais l’AfD a fait savoir, qu’elle avait acquis désormais de nouveau locaux. (En février 2025 L’AfD avait augmenté son score de 10,4%, passant à 20,80%, obtenant 152 députés contre 69 auparavant et devenant avec plus de 10 millions de voix le second parti du pays).
C’est le stalinien Bertolt Brecht, qui après la révolte ouvrière berlinoise du 17 juin 1953, réprimée dans le sang par les communistes de Berlin-Est, avait renouvelé son soutien au parti communiste Est-allemand, le SED, et dans une lettre adressée au tyran Walter Ulbricht avait affirmé : « puisque le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple ». C’est cette continuité historique qui se développe partout actuellement en Europe et singulièrement en Allemagne. Espérons que les peuples ne se laisseront pas faire.
Michel Festivi (EuroLibertés, 30 septembre2025)