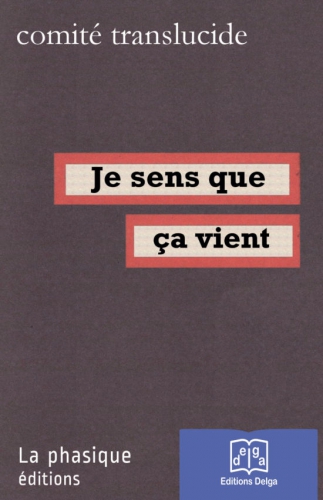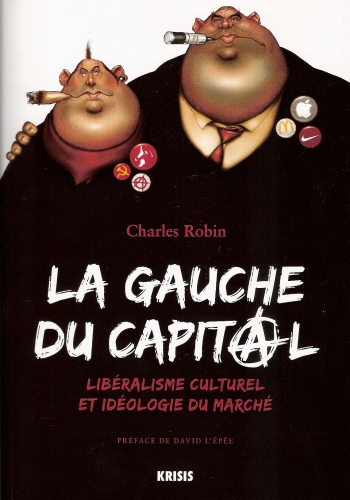Entretien avec Charles Robin, auteur de La gauche du capital (Krisis, 2015)
Vous accomplissez un travail fondamental de retour aux sources philosophiques du libéralisme, pourquoi ? En quoi la critique économique du libéralisme est-elle insuffisante voire inopérante ?
En bon disciple de Hegel, je suis absolument convaincu des vertus philosophiques de ce qu’on appelle la « phénoménologie », terme qui désigne – pour le dire vite – la recherche d’une logique sous-jacente aux phénomènes à l’œuvre (qu’ils soient d’ordres économique, politique, mais aussi culturel, moral ou anthropologique). Produire la phénoménologie du libéralisme, c’est donc tenter de remonter de ses effets quotidiens les plus manifestes (la précarité économique grandissante, la détérioration du lien social, Nabilla, etc.) à ses origines historiques et intellectuelles primordiales, pour espérer pouvoir en extraire – suivant la formule consacrée – la quintessence philosophique. Or, sur ce point, l’étude des auteurs libéraux classiques fournit à l’analyse de solides points d’appui. Ainsi, il est intéressant de noter que, dès le XVIIIème siècle, on trouve déjà formulées – notamment à travers la figure d’un Voltaire – les principales implications politiques et culturelles du projet libéral. Notamment (pour ne prendre que cet exemple) l’idée selon laquelle la libre poursuite par les individus de leurs intérêts et de leurs désirs (fondement pseudo-anthropologique de notre actuelle idéologie « libertaire ») constituerait le gage le plus puissant de la prospérité économique des nations capitalistes. L’exemple le plus emblématique (et aussi le plus caricatural !) étant probablement la fameuse Fables des abeilles (1714) de Bernard Mandeville, censée démontrer, sous une forme allégorique, que « les défauts des hommes, dans l’humanité dépravée, peuvent être utilisés à l’avantage de la société civile, et qu’on peut leur faire tenir la place des vertus morales ». Il s’agit donc, à travers cette image, de promouvoir la libre expression des égoïsmes comme source et condition de la croissance économique. Une allégorie écrite il y a trois siècles, et qui anticipait, de façon quasi prophétique, sur les métamorphoses contemporaines de nos sociétés. Soit – pour le dire d’une manière à la fois pédagogique et synthétique – la complémentarité et l’unité fondamentales du libéralisme économique et du libéralisme culturel, qui trouve son incarnation ultime dans l’actuelle fusion idéologique de la Gauche « internationaliste » et de la Droite « mondialiste ».
Le refus de toute verticalité est pour vous caractéristique de l’idéologie libérale, qui privilégie l’individu à la communauté, la logique de l’intérêt au sens du sacrifice. Pouvez-vous illustrer cette opposition entre transcendance et immanence ?
L’hypersensibilité hallucinante de la classe politique sur la question de la laïcité (loi de séparation de l’Église et de l’État adoptée en 1905) suffit à vérifier – de l’opportunisme politique d’une Marine Le Pen à la transe mystique d’un Vincent Peillon, pour lequel (rappelons-le tout de même) : « La laïcité [...], c’est une religion de la liberté, c’est une religion des droits de l’Homme » – l’allergie philosophique des libéraux à toute authentique notion de « transcendance », c’est-à-dire qui ne soit pas celle du fétichisme de la marchandise. Il faut en effet comprendre que, selon l’anthropologie libérale, l’Homme se définit d’abord comme un être sensible, c’est-à-dire capable d’éprouver du plaisir et de la douleur. Dans cette conception (fondement de l’empirisme de Locke, puis de l’utilitarisme de Bentham), c’est donc dans sa dimension corporelle et immanente que se situerait l’essence de l’être humain, quand les traditions philosophiques antérieures voyaient davantage dans sa dimension spirituelle et transcendante la qualité spécifique et le lieu d’accomplissement ultime de l’Homme. Par ce renversement dans la hiérarchisation classique des attributs humains (Corps/Esprit), c’est la vision de l’Homme elle-même qui allait se trouver transformée. En refusant d’accorder le moindre crédit philosophique à la notion de « sacré » (hormis à l’occasion de quelques processions sacrificielles telle que la dernière Charlie’s Pride nous en fournit le modèle), la doctrine libérale entérine ainsi, de fait, la réduction de l’être humain à un simple « carrefour de sensations », soumis aux seules lois gravitationnelles de l’intérêt et du désir. Un individu libéral atomisé, amputé de sa partie symbolique (celle qui produit du sens, c’est-à-dire à la fois une signification et une direction) au profit de l’Ego matérialiste triomphant. La transcendance n’est rien d’autre, sous cet angle de vue, que le surpassement effectif (c’est-à-dire réellement incarné) de la cellule de notre ego, condition constitutive de toute émancipation individuelle et collective. C’est la raison pour laquelle je pense qu’aucun socialisme authentique ne peut se concevoir sans cette assise symbolique primordiale, à défaut de laquelle rien ne viendrait justifier (conformément au mot d’ordre du NPA, auquel je souscris pleinement) que « nos vies valent plus que leurs profits ».
Dès lors, que vaut une société alternative qui ne serait pas portée par des hommes verticaux, c’est-à-dire structurés par une spiritualité forte ? Pour notre vieille Europe, le retour à ses racines ancestrales (un paganisme fécondé par le christianisme) n’est-il pas une condition nécessaire ?
Dans une perspective politique, la notion de « retour en arrière » n’a, à mes yeux, pas le moindre sens – du seul fait que le temps est un phénomène à sens unique ! En revanche, cela ne signifie pas qu’il faille vouloir refonder en faisant – comme le préconise le chant de l’Internationale – « table rase du passé ». À la suite des Humanistes, je suis profondément convaincu que la sagesse se trouve généralement plus près des enseignements des Anciens que de ceux des Modernes (lesquels n’ont d’ailleurs fait, le plus souvent, que les actualiser en les trafiquant).
De ce point de vue, il est indiscutable que l’élimination forcenée de toute trace de spiritualité antérieure au « post-modernisme » (dernière secte en date du libéralisme) représente une condition indispensable à la poursuite du projet du capitalisme planétaire.
Cela étant, je ne limite pas au seul christianisme – ni, d’ailleurs, à aucune autre religion référencée – le cadre d’expression de ce que j’englobe sous l’idée de transcendance. Pour le dire autrement, il n’est aucunement nécessaire de se définir comme « chrétien » pour faire partie de ceux qui, par leur comportement quotidien et leurs actes concrets (à quelque niveau que cela soit), contribuent à améliorer réellement l’état des choses. S’il y a un grand mérite aux travaux des anthropologues structuralistes, c’est d’avoir apporté la confirmation empirique que sous des modalités plurielles et spécifiques selon les cultures se manifestaient, la plupart du temps, des modes de représentation du monde similaires ou analogues. L’observation me semble, dans une large mesure, valable concernant l’identité ethnique ou confessionnelle. À savoir qu’il me paraît peu fondé (si ce n’est par l’inquiétude légitime – et savamment entretenue – de ceux qui voient progressivement leur cadre de vie se transformer sous leurs yeux) d’exclure du « camp des opprimés » des populations – croyantes ou athées, européennes ou extra-européennes – qui, si elles n’emploieront pas forcément le même « langage », pourront cependant signifier une vision du monde commune. C’est là un point crucial à retenir, pour qui s’interrogerait sur la signification de l’actuelle marche forcée vers la guerre civile idéologique inter-communautaire, à laquelle la classe dirigeante nous prépare.
Vous amenez le libéralisme sur un terrain qui lui est presque étranger, celui de la morale. Il est peut-être temps de revenir ici sur la notion orwellienne de « décence commune »…
On a souvent reproché à Michéa son usage de la notion de common decency empruntée à Orwell. Le fait est que cette idée d’une décence commune – c’est-à-dire d’une morale ordinaire et intuitive partagée par la plupart des gens, sans référence particulière à une idéologie du Bien ou de la Vertu – offre assez peu de prises à l’analyse conceptuelle (dont les universitaires sont d’autant plus friands qu’elle permet de légitimer leur anaptitude au réel). Pour ma part, je vois dans cette plasticité et ce caractère apparemment « vague » de la notion de common decency la traduction philosophique la plus juste de cette disposition morale des gens ordinaires, dont on ne connaît pas tant la nature et l’origine exactes que les effets quotidiens à travers lesquels elle se manifeste. En d’autres termes, quiconque chercherait à comprendre cette notion de common decency sans en éprouver directement les implications humaines profondes me semble condamné à errer éternellement dans les tunnels sombres du « positivisme », pour lequel seules importent les lois neutres et impersonnelles de la « rationalité ». Pour corriger votre question, je dirais donc que la question de la morale n’est, en réalité, pas étrangère au libéralisme, dans la stricte mesure où, précisément, le libéralisme ne peut espérer prospérer que sur les ruines d’une telle disposition à la common decency. Une morale ordinaire qui transcende, là encore, les appartenances confessionnelles et communautaires, et nous place face à notre propre responsabilité : celle qui consiste à entamer la lutte contre le libéralisme sur le terrain de notre propre conduite. Soit notre capacité à incarner, dans notre existence quotidienne et dans notre rapport à soi et aux autres, ces valeurs d’entraide, de bienveillance et de respect réciproque qu’une telle common decency préconise.
Mai 1968 a été un formidable point de convergence de l’extrême gauche libertaire et du capitalisme américanisé. Au-delà des slogans et de l’imagerie d’Epinal, quelle est l’importance réelle de ces « événements » ?
Dans son livre Néo-fascisme et idéologie du désir (1973), le philosophe Michel Clouscard décrivait les événements de Mai 68 comme une « contre-révolution ». Il voulait dire par là que ces événements avaient fourni au libéralisme l’occasion de sa mutation en une forme nouvelle, celle qu’il désigne sous le précieux concept de « libéralisme libertaire ».
Ainsi, à l’esprit du capitalisme autoritaire et traditionaliste hérité du fordisme et du taylorisme (marqué par la parcellisation des tâches et la mécanisation de l’industrie) allait désormais succéder un nouvel esprit du capitalisme, orienté non plus sur la répression du désir et l’interdit (incarné par le producteur), mais sur sa libération et la permissivité (incarné par le consommateur). En confondant ainsi tragiquement lutte anticapitaliste et lutte anti-autoritariste, les acteurs de Mai 68 allaient ainsi apporter une caution « libertaire » (donc « moderne ») à l’exploitation capitaliste de la liberté et du désir individuels. L’hypersexualisation de nos sociétés contemporaines (pour ce qui concerne, du moins, la présentation médiatique des choses) est évidemment symptomatique de cette opportunité du « lâcher-prise » pulsionnel pour la domination marchande. En sollicitant en permanence la participation à la machine capitaliste de notre bas-ventre, on s’assurait ainsi – si j’ose dire – de maintenir le centre gravitationnel de notre manière d’être et de notre rapport au monde en-dessous de la ceinture. Une forme paradoxale de la domination, puisqu’elle tend à convertir tous nos désirs individuels en ressource énergétique au service de l’industrie de la consommation.
Vous parlez d’économie libidinale pour caractériser l’étape d’extension du marché que nous connaissons actuellement. Que recouvre ce terme ?
Pour bien comprendre cette idée, il est absolument nécessaire de rompre avec cette opinion courante qui voudrait que toute domination politique emprunte obligatoirement les voies de l’autoritarisme et de la « soustraction de jouissance ».
En réalité, le libéralisme aura accompli cet exploit, inédit au regard de l’Histoire, d’avoir su articuler et tenir ensemble la plus complète des dominations avec la plus absolue – mais aussi la plus abstraite – des libertés pour les individus. Il aura suffi, pour ce faire, d’introduire méthodiquement dans nos esprits l’idée (héritée de la philosophie empiriste) que c’est dans la satisfaction de nos désirs pulsionnels que se manifeste le signe ultime de la liberté humaine.
Une réduction de la liberté à la pulsion, quand les Anciens voyaient justement dans la « retenue » à l’égard de ses passions et de ses affects la forme accomplie de la liberté et de la sagesse. Camus disait : « Un homme, ça s’empêche ». Autrement dit, un être humain se définit d’abord par sa capacité à dire « non », à refuser, à résister. N’est-il pas significatif, à cet égard, que le verbe « succomber » désigne à la fois le fait de céder à la « tentation » et de « rendre l’âme » ? L’économie libidinale du capitalisme – c’est-à-dire la stimulation et l’exploitation de notre libido au profit des intérêts du Marché – débordant évidemment le seul cadre de l’industrie du sexe, puisqu’il conditionne désormais l’ensemble de notre rapport à la marchandise : une marchandise déifiée, sacralisée et fétichisée, par laquelle se manifeste le règne de l’Avoir et du Signe, qui s’édifie sur les décombres de l’Être et du Sens.
Quelle dette a l’idéologie du marché envers les libertaires Bourdieu et Foucault ?
Le dénominateur commun des travaux de Bourdieu et de Foucault réside dans leur prétention commune à mettre au jour les mécanismes de la domination, tout en participant, dans les faits, à leur assomption et à leur légitimation. Ainsi, Foucault – qui ne dissimulait pas sa fascination pour la « fièvre généreuse du délinquant » – contribua-t-il, par ses travaux, à entretenir la conception d’un système capitaliste répressif et prohibitif, dont la prison, l’école et l’hôpital représenteraient les structures d’exercice privilégiées. Un capitalisme répressif et anti-hédoniste qui appellerait comme réponse philosophique la promotion d’un individualisme permissif et jouisseur comme horizon pratique de toute émancipation. De même, en faisant de l’École le lieu d’exercice d’une « violence symbolique » à l’égard de l’élève, Bourdieu allait apporter une caution « philosophique » et « libertaire » à la destruction de l’enseignement du savoir critique comme arme effective d’émancipation et de libération à l’égard de l’ordre « bourgeois ». D’où le développement, ces dernières années, des méthodes d’apprentissage basées sur le principe de la « pédagogie différenciée », à partir duquel les élèves sont désormais invités à « construire » leur propre savoir, à l’encontre d’un enseignement traditionnel fondé sur l’instruction et la transmission, vues comme intrinsèquement oppressives et contraires à l’individualité créatrice de l’enfant. Ce qui se vérifie dans ce constat simple que jamais les connaissances élémentaires n’ont été si peu maîtrisées par les jeunes générations, alors même que le savoir n’a jamais été aussi disponible et accessible par tous, le développement récent des technologies de l’information et de la communication – au premier rang desquelles Internet – permettant de vérifier qu’il n’est nul besoin de restreindre l’accès au savoir pour obtenir que la population s’en détourne.
Vous insistez sur le fait que la faillite de notre système éducatif ne doit rien au hasard. L’économie libidinale a-t-elle donc besoin de n’avoir face à elle que des individus déracinés et décérébrés, anomiques ?
L’intérêt principal de ce que Michéa nomme, dans l’un de ses livres, l’ « enseignement de l’ignorance », est qu’il tend à produire des individus déliés et amputés d’une part considérable de leur être, à savoir l’intelligence critique.
Qu’on le veuille ou non, l’enseignement « traditionnel » avait au moins cette supériorité sur l’enseignement « différencié » qu’il rendait possible l’accès de tous à une culture commune, à partir de laquelle seulement peut s’édifier un monde commun.
La séparation des individus de cette sphère immatérielle et transcendante par excellence que représente le savoir (au motif, par exemple, que la connaissance du théorème de Pythagore ou des règles de la conjugaison du subjonctif n’aurait, de nos jours, pas la moindre « utilité ») est parfaitement emblématique, de ce point de vue, de l’entreprise d’élimination systématique de tout savoir qui ne déboucherait pas directement sur un « profit » objectivement mesurable. Ce faisant, on fabrique à la chaîne des individus auxquels on aura préalablement inculqué le mépris de la culture, favorisant ainsi leur réduction à l’état d’« atomes » sensibles, coupés de leur passé et de leurs origines, réceptacles passifs et intégralement disponibles aux sollicitations de la marchandise.
Nous assistons à une accélération de l’extension du libéralisme : destruction de la famille traditionnelle, idéologie du genre, suppression de larges pans de l’enseignement de l’histoire, extension de la novlangue et de l’arsenal répressif contre ceux qui « pensent encore le réel ». Comment envisagez-vous les années à venir ?
Une autre vertu de la dialectique hégélienne est qu’elle permet d’envisager tout processus historique d’aliénation et de dépossession de soi à grande échelle comme engendrant de lui-même sa propre réfutation. Pour le dire simplement, je pense que l’accélération actuelle des mesures de libéralisation entraînera d’elle-même l’amplification des réactions à son encontre. C’est ce qu’on commence à voir un peu partout, avec l’émergence et la constitution de groupes de réflexion et d’action pour lesquels il apparaît désormais évident que la destruction libérale du monde doit appeler des modalités de résistance organisées et structurées, c’est-à-dire plaçant au cœur de leur engagement la notion de « lien ». Bien qu’un tel chantier puisse être vu comme « utopique » au regard de l’extraordinaire avancement du projet libéral d’atomisation, je suis personnellement convaincu qu’une telle entreprise de réunification porte les germes de notre salut collectif. À condition que nous soyons capables de sortir de cette tyrannie de l’Ego, qui constitue, à n’en pas douter, l’arme d’oppression la plus redoutable – car la plus invisible – du Système.
Charles Robin, propos recueillis par Pierre Saint-Servan (Novopress, 6 et 7 mars 2015)