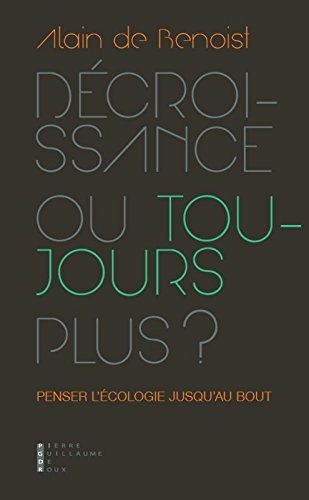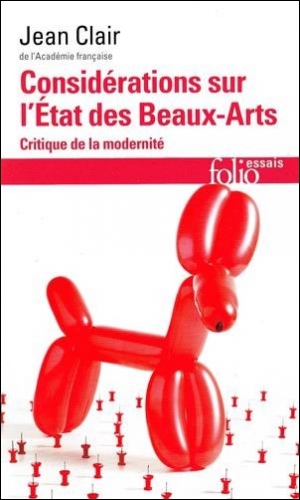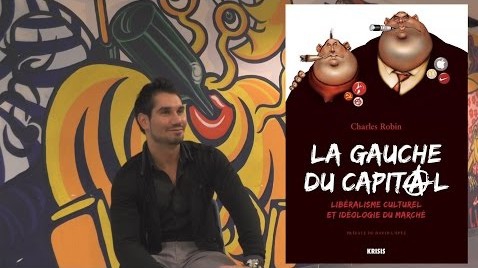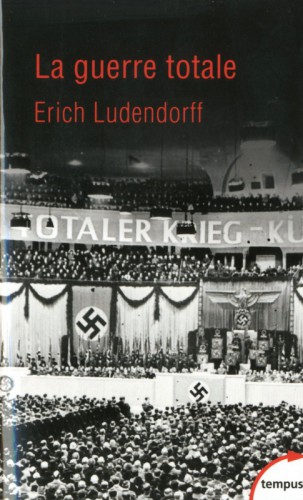« Cette culture libertaire du libéralisme est une nouvelle forme d’esclavage »
PHILITT : Vous rejetez les Lumières car vous voyez en elles l’origine du libéralisme. Cependant, les Lumières ont aussi été une source d’inspiration pour les premiers socialistes, notamment Rousseau et Montesquieu. N’est-ce pas paradoxal ?
Charles Robin : Résumer mon propos sur la philosophie des Lumières et ses liens avec le libéralisme à une position de « rejet » me semble relever, pour le moins, du raccourci philosophique ! Le fait est que le libéralisme, tel qu’il s’est formalisé au cours de l’histoire moderne (et, plus particulièrement, au XVIIIe siècle), s’appuie essentiellement sur cette vision de l’Homme – défendue à l’époque par la plupart des penseurs des Lumières – comme d’un individu rationnel, dont le sens et la finalité ultimes de l’existence se réduiraient à la recherche de l’intérêt. Je vous renvoie, à ce sujet, aux textes de Locke et de Hume (deux figures majeures des Lumières britanniques) qui, dans leurs traités d’anthropologie philosophique, s’accordent à voir dans l’homme « cette chose pensante, sensible au plaisir et à la douleur, apte au bonheur ou au malheur et portant de ce fait intérêt à soi ». Or, c’est de cette définition de l’homme comme être naturellement mu par son égoïsme que le libéralisme entend partir (définition supposée reposer sur l’ « expérience » et l’ « observation des faits ») pour concevoir un modèle de société rendant possible la coexistence pacifique des individus concurrents.
C’est là qu’interviennent les deux grandes instances de régulation, parallèles et conjointes, du système libéral : le Droit, censé garantir la liberté de tous les citoyens dans le cadre de la loi (je vous rappelle ici que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 stipule que « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ») ; et le Marché, censé résoudre mécaniquement l’antinomie des intérêts particuliers par un phénomène providentiel d’ « harmonisation spontanée » (je vous renvoie, sur ce point, aux textes fameux d’Adam Smith sur les vertus de la « main invisible » du Marché). On voit donc ici en quoi la philosophie des Lumières, en s’appuyant sur une vision de l’Homme comme être foncièrement « libre », « égoïste » et « rationnel » – aptitudes qu’il ne s’agit, du reste, aucunement de nier ou de minimiser –, a fourni aux théoriciens du libéralisme le matériau anthropologique à partir duquel le modèle d’une société libérale, c’est-à-dire d’une société qui fait de l’égoïsme des individus le moteur unique de son fonctionnement, allait pouvoir prospérer jusqu’à nos jours. Quant à votre remarque sur Rousseau et son apport dans la constitution de la pensée socialiste, je ne peux que vous rejoindre, dans la mesure où je reconnais moins dans l’auteur de L’Essai sur les sciences et les arts un philosophe des Lumières qu’un philosophe contre les Lumières (ses lignes sur la liberté et sur le désir lui vaudraient probablement, aujourd’hui, les plus violentes accusations de « totalitarisme », voire de « fascisme », de la part des descendants intellectuels d’un libéral comme Voltaire, son pire ennemi).
PHILITT : Rousseau ne s’inscrit donc pas, selon vous, dans le mouvement des Lumières ?
Charles Robin : En effet, contrairement aux Lumières – qui n’envisageaient la problématique de la liberté que du point de vue de l’individu – Rousseau, quant à lui, voyait essentiellement dans cette dernière une aspiration collective et un projet commun (ce en quoi il représente, selon moi, le dernier penseur véritable du problème politique). Je ne m’étendrai pas ici sur sa notion politique centrale d’ « intérêt général », qui ne pourra que heurter la sensibilité individualiste de tout libéral authentique, qui n’admet, par définition, que le bien-fondé et la toute-puissance du « droit privé ». Daniel Cohn-Bendit n’est-il pas celui qui nous a rappelé, récemment, que la démocratie consistait dans « la défense des minorités contre la majorité » ? Lorsque de telles insolences dialectiques se retrouvent permises, on n’ose à peine imaginer le sort qu’aurait réservé notre intelligentsia libérale à ce pauvre Rousseau !
PHILITT : Selon vous, le libertarisme est, dès le départ, un élément constitutif du libéralisme. Mais peut-on vraiment mettre Proudhon, Bakounine et Kropotkine dans le même sac que Serge July et Daniel Cohn-Bendit ?
Charles Robin : Il convient d’abord de s’entendre sur le sens des mots. Par l’adjectif « libertaire », j’entends caractériser le discours qui érige la « liberté individuelle » et le « droit privé » au rang de norme politique, sociale et culturelle suprême, et qui, partant, fait de la contestation de toutes les structures et de toutes les normes symboliques et collectives existantes un idéal anthropologique et un impératif pratique. Or, ce qu’il me semble important de noter, c’est que dès lors qu’on redéfinit la liberté comme le droit offert à l’individu de satisfaire sa tendance – supposée naturelle et inévitable – à poursuivre son intérêt et son désir, il est clair que le but atteint n’est pas ce que Marx nommait, à son époque, la « liberté réelle ». C’est, au contraire, la soumission grandissante des individus aux exigences capitalistes de « libération pulsionnelle » et de « satisfaction libidinale », en vue d’une extension indéfinie des sphères de la consommation. Soit l’exact antithèse de la conception des sages grecs de l’Antiquité, qui voyaient dans la liberté cette capacité proprement humaine à la retenue et à la « maîtrise des passions » (ce que les philosophes grecs appelaient la sophrosyne : la tempérance, et qu’ils opposaient à l’hybris : la démesure). On est donc loin, selon ce critère, de ce que notre cher Rousseau appelait, dans ses Lettres écrites de la montagne, un « état libre », dans lequel, disait-il, la liberté de chaque individu est subordonnée à la liberté du groupe !
Philitt : C’est donc l’illusion de liberté de nos sociétés libérales que vous souhaitez dénoncer ?
Charles Robin : Oui, le philosophe Dany-Robert Dufour n’hésite d’ailleurs pas à parler, au sujet de cette culture « libertaire » du libéralisme, d’une nouvelle forme d’esclavage, en tant qu’elle fait de l’individu consentant (c’est-à-dire de celui qui a définitivement intériorisé l’idée que le droit et le désir devaient constituer l’unique moteur de tous ses agissements) le complice inconscient de sa propre servitude – celle de son souverain désir. Une servitude objective aux attentes du Marché vécue subjectivement comme une liberté et un droit (d’où l’urgence de réintroduire dans la réflexion philosophique le concept d’ « aliénation »), alors même qu’elle participe de la dépossession des sujets de leur dimension supra-matérielle, celle par laquelle nous pouvons accéder à la sphère, abstraite et immatérielle, du « don » et de la « gratuité » (vérifiable au fait, par exemple, qu’il puisse nous arriver d’agir sans rien attendre en retour). Difficile, dans ce contexte, de déceler une quelconque parenté philosophique entre un tel libéralisme libertaire (expression forgée par Michel Clouscard en 1973, pour lequel, au passage, Daniel Cohn-Bendit représentait déjà l’emblème incandescent), qui fait de l’atomisation des individus et de la promotion de l’idéologie du désir son armement idéologique privilégié, et le socialisme libertaire d’un Proudhon ou d’un Bakounine, qui voyaient dans le lien à autrui – le lien représentant, dans la doxa libérale, la marque caractéristique de la « dépendance » et de la « servitude » – la condition profonde de toute liberté réelle, puisqu’elle conditionne l’existence du groupe. Une idée que le NPA semble décidément avoir le plus grand mal à entendre…
PHILITT : Vous faites du NPA l’un des plus grands promoteurs actuels du capitalisme. Or, il s’agit également d’un parti fortement influencé par Daniel Bensaïd, un grand disciple de l’École de Francfort, et où on trouve encore aujourd’hui des intellectuels comme Michael Löwy. Votre analyse ne gagnerait-elle pas à être plus nuancée ?
Charles Robin : Sans doute ! Mais, comme l’écrivait déjà Günther Anders, « s’il peut y avoir la moindre chance d’atteindre l’oreille de l’autre, ce n’est qu’en donnant le plus de tranchant possible à son propos ». On pourra toujours me reprocher certaines généralisations ou approximations – qui n’en fait pas ? Je réponds que toute théorisation est à ce prix. Or, au-delà des quelques exemples que vous me citez (auxquels, par ailleurs, je souscris en grande partie), je constate une tendance générale à l’œuvre dans le discours politique et « sociétal » du NPA, et des représentants de la « gauche libertaire » en général – dont, par exemple, le philosophe « hédoniste » Michel Onfray a longtemps fait partie –, que je tiens pour infiniment plus influente sur l’air du temps médiatique et le « débat public » (comme l’on doit dire de nos jours) que ne pourraient l’être les réflexions rigoureuses d’un théoricien du mouvement communiste révolutionnaire comme Daniel Bensaïd. Si je focalise mon attention critique sur le cas spécifique de cette « extrême gauche », c’est dans la mesure exacte où celle-ci symbolise, selon moi, le contresens idéologique moderne qui fait obstacle à toute approche pertinente (et, partant, à l’analyse qui en découle) de la question de la domination. En articulant sa lutte contre l’hégémonie capitaliste et l’injustice sociale à une disqualification systématique de toute notion de « norme », d’ « autorité » ou de « limite » (ces notions étant, bien entendu, à définir), l’extrême gauche s’interdit ainsi par avance de défendre les conditions symboliques et anthropologiques d’institution réelle d’une société juste et égalitaire, qui ne peut espérer s’édifier que sur la base d’un « monde commun » – ne serait-ce que celui des règles minimales de la morale commune et de la décence.
Pour le dire d’une manière simple, on ne peut à la fois s’élever contre la logique de marchandisation et de réification croissantes de l’existence humaine par le libéralisme triomphant (l’exploitation salariale, l’anéantissement des acquis sociaux, l’augmentation du coût de la vie) et encourager, dès que l’occasion s’en présente, la déliaison des individus de toutes les attaches symboliques, culturelles et morales qui empêchent, précisément, la réduction de l’existence humaine à la seule dimension matérielle du désir et de l’intérêt (comme l’œuvre radicale et cohérente du Marquis de Sade l’a brillamment illustré). Si l’on admet cette idée que le capitalisme ne peut espérer se maintenir qu’avec la participation des sujets qu’il englobe et asservit, on doit, du même coup, consentir à l’examen de ce qui, dans nos propres schémas d’action et de représentation, rend encore possible l’emprise sur notre économie, mais aussi sur nos vies, de la domination libérale. Ce qu’on appelle, communément, prendre le mal à sa racine. Et qu’aucun militant anticapitaliste authentique ne saurait, a priori, me reprocher !
Charles Robin, propos recueillis par Benjamin Fayet (Philitt, 1er février 2015)