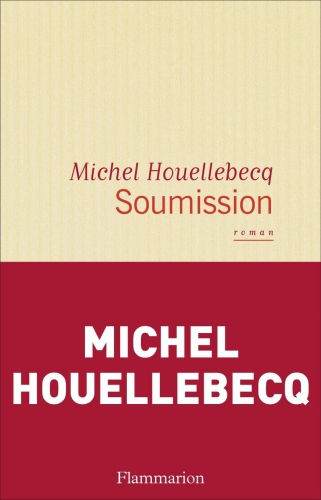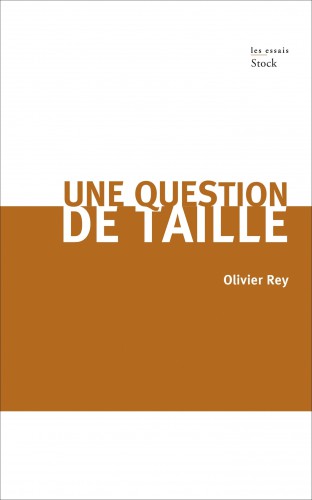Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné à Figaro Vox par Benoît Berthelier et consacré à la pensée de Nietzsche abordée sous l'angle de l'écologie. Diplômé de l'École normale supérieure et agrégé de philosophie, Benoît Berthelier vient de publier Le sens de la terre - Penser l'écologie avec Nietzsche (Seuil, 2023).

Nietzsche et le nihilisme à l'heure de la crise écologique
FIGAROVOX. - Vous écrivez dans votre livre «Contrairement à beaucoup de lecteurs environnementalistes de Nietzsche, nous ne croyons pas que Nietzsche puisse être tenu pour un défenseur de la nature». Qu'est-ce que sa pensée peut apporter aux combats écologistes, s'il n'est pas un défenseur de la nature ?
Benoît BERTHELIER. - On ne peut pas dire que Nietzsche ait été un défenseur de la nature, au sens où pour lui il n'y avait pas besoin de la défendre. Il était évidemment ignorant des problèmes écologiques que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas non plus chez lui de culte romantique de la nature, comme c'est le cas chez Rousseau par exemple. La divinisation de la nature lui semble suspecte, dans la mesure où elle conduit à voir la nature comme un lieu de rédemption.
Cependant, on trouve dans son œuvre une vraie pensée de la vie, de son histoire, de ses conditions d'organisation et de croissance. Il nous invite à regarder de plus près l'ancrage de la vie dans certaines conditions naturelles et culturelles, ce qu'il appelle parfois des «climats». Il souligne l'importance d'apprécier tout ce qui peut nourrir la vie, de toutes les «choses proches» que la métaphysique a tendance à oublier.
Alors que Nietzsche critiquait le nihilisme, vous blâmez vous le «nihilisme environnemental». De quoi s'agit-il ? En quoi est-ce un danger ?
La véritable cible de Nietzsche est en effet le nihilisme. Et malgré ses avertissements, nous n'en sommes pas encore guéris. Je fais l'hypothèse, dans mon livre, que nous faisons face à une nouvelle étape du nihilisme, à savoir le nihilisme environnemental. Il s'agit d'un approfondissement de la perte de nos valeurs, d'une détresse devant l'absence de sens et de buts de notre existence terrestre, qui peut prendre des formes très diverses. J'en distingue quatre formes, quatre manières de réduire à «rien» le sens de la terre. Le «nihilisme réducteur» anime ceux qui voient la terre comme un simple stock de ressources à exploiter et à s'approprier, dont la valeur est déterminée par le seul marché. Le «nihilisme dénégateur» renvoie à toutes les formes de déni ou de relativisation de la crise écologique.
Le «nihilisme exténuateur» concerne ceux qui ont une conscience lucide de la crise mais qui se sentent écrasés par l'urgence d'y répondre, qui souffrent d'une sorte d'épuisement, de découragement ou de déception. Ils en viennent à ressasser un amer «à quoi bon ?». Enfin, le «nihilisme négateur» est l'accomplissement du nihilisme comme volonté de néant, il s'agit du rêve d'une terre sans hommes ou des multiples visages du ressentiment, de la vengeance, de la culpabilisation de soi et des autres. L'un des objectifs de ce livre est de montrer que le nihilisme, la perte de sens, travaille les deux côtés du débat écologique : le côté des «climato-sceptiques», des «éco-modernistes» prétendument optimistes et le côté des personnes les plus sensibles aux problèmes écologiques. Je crois qu'au lieu de déplorer et de stigmatiser «l'indifférence» présumée des citoyens aux questions écologiques, on gagnerait à penser la situation en termes de nihilisme.
Nietzsche redoutait l'avènement du «dernier homme», au sens d'un homme médiocre incapable de donner un sens aux choses. Et vous écrivez à propos de ce dernier homme «Son ultime fierté, la fine pointe de son orgueil, c'est d'être capable de renoncer à l'homme, à la vie humaine». Faut-il voir dans les mouvements écologistes radicaux qui refusent de perpétuer l'espèce et d'avoir des enfants, au nom de la nature, l'avènement de ce «dernier homme» ?
On pourrait sans doute trouver des similitudes avec le «dernier homme» de Nietzsche dans certains de ces mouvements. Mais mon livre n'a pas une ambition sociologique ou politique, je ne cherche pas à décrire de manière systématique la société actuelle. La pensée de Nietzsche reste cependant utile pour discerner des grands types d'affectivité, différentes manières dont nous pouvons être affectés aujourd'hui par le non-sens de notre existence terrestre. Le dernier homme, selon Nietzsche, considère l'humanité comme le terme de l'évolution de la vie sur terre, c'est l'homme qui a pour idéal d'être le «dernier».
Il est clair que Nietzsche s'oppose à cet anthropocentrisme maladif, il lui oppose un antidote, le surhumain. Nietzsche ne considère pas l'espèce humaine comme un fléau pour la nature. Certes, il dit dans Ainsi parlait Zarathoustra que l'homme est la «maladie de peau» dont souffre la terre, mais on peut supposer qu'il parle à ce moment-là des hommes modernes, qui veulent justement être les «derniers hommes». Il ne souhaite pas que l'homme s'anéantisse lui-même, mais qu'il se dépasse vers le surhumain, qu'il prépare la terre à l'accueil de multiples formes de vie.
Que signifie cette «surhumanisation» de la terre que prône Nietzsche ?
Pour redonner un sens à notre habitation de la terre, il faut se défaire de l'idée d'un «retour à la nature» idéalisé. Nietzsche défend d'abord la nécessité d'une «déshumanisation de la nature» et d'une «naturalisation de l'homme». Pour penser adéquatement le «surhumain», il faut produire une nouvelle pensée de ce qu'est l'être humain, en le naturalisant. C'est-à-dire en le réinscrivant dans l'histoire de la vie et dans les dynamiques de la volonté de puissance.
Parallèlement, il est nécessaire de déshumaniser la nature, autrement dit de trouver une interprétation de la réalité qui ne soit pas anthropomorphique, qui ne soit pas seulement guidée par les préoccupations étriquées du type humain dominant. Cette tâche de déshumanisation de la nature doit aboutir à retrouver ce que Nietzsche appelle le «pur concept de la nature» et que l'on peut identifier à la volonté de puissance. C'est à partir de ce concept que l'on peut établir une interprétation de la nature que Nietzsche juge plus honnête, plus riche et plus stimulante que celle des scientifiques positivistes de son époque, des romantiques ou des philosophes qui l'ont précédé.
Dans un passage sur le christianisme, vous écrivez «Pour redonner un sens à la terre, il faut donc déterminer comment ne plus être chrétien, c'est-à-dire déterminer comment renverser la haine de la terre et du terrestre que le christianisme a infusée dans nos corps pendant deux millénaires». Mais le christianisme en plaçant l'homme «au centre de la création», ne l'a-t-il pas au contraire doté d'une responsabilité vis-à-vis de celle-ci ? Dans la Genèse, Dieu considère que la création est bonne et place l'homme au milieu du jardin d'Éden pour le «cultiver et le garder». (Genèse 2 :15).
En effet, la terre est une notion qui a une importance cruciale dans le christianisme, et il y aurait beaucoup à dire du rapport entre écologie et christianisme. Dans ce livre, j'ai surtout essayé d'identifier le type précis de christianisme qui était la cible de Nietzsche, pour mieux comprendre le nouvel «amour de la terre» qu'il a en vue. Cette cible, c'est le christianisme luthérien et paulinien (NDLR, inspiré de l'apôtre Paul), avec la figure médiatrice d'Augustin entre les deux. Dans un tel christianisme, l'amour de Dieu suppose une renonciation à l'amour terrestre. Pour comprendre ce que peut vouloir dire aujourd'hui «aimer la terre», il faut donc regarder de très près notre histoire chrétienne. La critique de Nietzsche n'est pas une critique athée qui considère que le christianisme n'a rien d'important à nous apprendre. Au contraire, il considère qu'il faut relire les textes de l'histoire chrétienne, pour parvenir à la dépasser et à nous extraire d'une forme de religiosité maladive.
Pour revenir à votre question, le problème de la conception biblique de la nature, notamment dans la Genèse, est qu'elle reste anthropocentriste. C'est l'homme qui nomme les animaux, qui est le bon intendant de la terre, qui en est le gardien et le maître, même si c'est un maître responsable qui ne tire sa position privilégiée que du service qu'il rend à Dieu. Nietzsche nous enseigne que l'humain doit, certes, endosser la charge de la terre, mais que celle-ci ne dépend pas d'une place particulière qu'occuperait l'homme dans la création, ou dans une échelle des êtres instituée par Dieu.
Mais peut-on redonner un «sens à la terre» sans aucune forme de sacralité ?
Cela dépend des formes de sacralité et des types de vie qu'elles engagent. On trouve aussi des dieux chez Nietzsche. Certes Dieu est mort pour lui, mais du début à la fin de son œuvre, il fait notamment une large place à la figure de Dionysos. Dionysos est une autre figure de la divinité, qui renvoie à la vie surabondante. Le rapport de Nietzsche au divin et au sacré est complexe. Sa philosophie est une manière de remplacer ou de réinterpréter les affects chrétiens et non de les congédier simplement. Tout l'enjeu est que cette sacralité ne soit pas tributaire d'un idéal ascétique, c'est-à-dire négateur de la vie et de la terre.
Benoît Berthelier, propos recueillis par Pierre-Alexis Michau (Figaro Vox, 27 avril 2023)