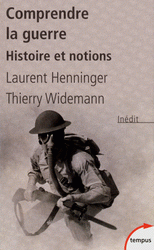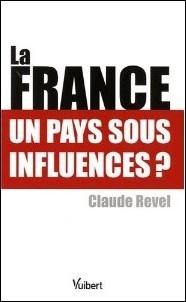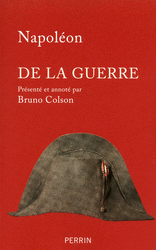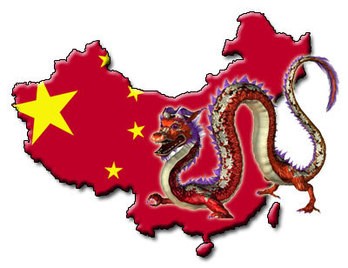Journaliste et économiste, Jean-Michel Quatrepoint vient de publier Mourir pour le yuan? (chez François Bourin Editeur), une analyse de la stratégie de puissance de la Chine face au déclin consenti des puissances occidentales. Il explique les profonds déséquilibres, aggravés par la crise, qui se creusent au détriment de celles-ci.
La question du yuan est au menu des discussions du G20 à Washington. Quel est le problème avec la monnaie chinoise?
Le yuan est la monnaie de la seconde puissance mondiale, du premier pays en termes de détention de réserves de change. Or cette monnaie n'est pas convertible: la Chine exerce un contrôle des changes pour en contrôler strictement la valeur. Le yuan est considérablement sous-évalué. De plus, depuis trente ans, la stratégie de Pékin est d'indexer le yuan sur le dollar, pour que les évolutions de ces deux monnaies soient synchronisées.
Quels sont les avantages de cette stratégie monétaire?
Elle permet d'attirer les multinationales sur le sol chinois. Garder la monnaie sous-évaluée permet de produire moins cher. Les Chinois se souviennent qu'en 1985, Washington avait forcé les Japonais à réévaluer le yen, tordant le cou à l'industrie japonaise. Ils ne laisseront pas la même chose leur arriver.
Par ailleurs, indexer le yuan sur le dollar, c'est garantir aux multinationales qu'elles ne prennent pas de risques de change. En retour, la Chine demande à celles-ci de produire pour l'exportation, pas pour le marché local. C'est une stratégie géniale, un pacte gagnant-gagnant: les multinationales engrangent les bénéfices, et la Chine les excédents commerciaux. Aux dépens de l'industrie et des balances commerciales de l'Europe et des Etats-Unis, qui perdent des emplois et des capitaux.
Quel est l'intérêt pour la Chine d'accumuler ces excédents?
D'abord, le pays ne peut pas basculer brutalement d'un modèle mercantiliste, basé sur l'exportation, à un modèle de consommation intérieure. Ensuite, la Chine vieillit, comme l'Allemagne: dans 20 ou 30 ans, il faudra financer un grand nombre de retraites. D'où le besoin d'engranger des recettes à l'export.
Enfin, celles-ci permettent de racheter des actifs. Par exemple des bons du Trésor américain, c'est-à-dire la dette publique des Etats-Unis. Pékin se tourne aussi de plus en plus vers des actifs tangibles: telle ou telle entreprise qui dispose d'une technologie convoitée, telle autre, point d'entrée pour un marché particulier. On s'attend aussi à une importance croissante de la Chine dans la finance.
Quelles sont les conséquences de cette politique pour les économies occidentales?
Elle entraîne pour l'Europe et les Etats-Unis des déficits commerciaux considérables. Non seulement les emplois, mais aussi les capitaux sont délocalisés en Asie. Les multinationales n'investissent plus en Occident. Qu'est-ce qu'il reste? Des emplois publics, avec lesquels on espère masquer l'hémorragie d'emplois marchands. Tandis que l'on fait des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux super-riches.
Est-il impossible de faire pression sur la Chine pour qu'elle infléchisse sa politique monétaire?
L'erreur a été de l'admettre à l'OMC, en 2001, sans lui demander de renoncer au contrôle des changes. Entre 2005 et 2008, la Chine a procédé à une réévaluation par petites touches, 1% de temps de en temps, sous la pression internationale. Avec l'arrivée de la crise, ils se sont complètement réindéxés sur le dollar. Depuis quelques mois, ils ont repris leurs petites réévaluations. Mais pour mettre le yuan à son niveau réel, il faudrait le réévaluer de 30 ou 40%. D'un autre côté, on peut comprendre les Chinois, qui ne veulent pas alimenter l'inflation par une hausse importante.
Mais, en l'absence d'une forte demande intérieure, la Chine n'a-t-elle pas intérêt à la prospérité de ses principaux partenaires commerciaux?
Elle est obligée à un pilotage assez fin. Mais globalement, on est à un moment où la machine économique échappe à ses acteurs. Plus personne ne maîtrise plus rien, et Pékin ne peut pas racheter les dettes de tous les Etats européens. Les Chinois se sont déclarés prêts à aider, mais c'est surtout un effet d'annonce.
Peut-on espérer un front uni des Occidentaux sur le yuan lors du G20 de Cannes, début novembre?
Je crains que les Européens ne soient pas unis. Le principal partenaire de la Chine en Europe, c'est l'Allemagne, qui a adopté la même stratégie mercantiliste en réalisant ses excédents sur la zone euro. Le fait que l'euro soit trop fort par rapport au yuan, les Allemands s'en fichent: ils occupent la niche du haut de gamme. Le taux de l'euro, ça joue peu quand on vend des Mercedes. C'est plutôt nous, Français, qui sommes concernés par la question. Quant aux Américains, qui seraient les seuls à pouvoir faire pression sur la Chine, ils ne remettent pas en cause son adhésion à l'OMC, par attachement au libre-échange. Ils n'ont pas compris les problèmes que pose leur déficit commercial, alors que l'Amérique s'appauvrit.
Il ne faut donc pas trop compter, selon vous, sur les grands changements annoncés?
Non. Les Chinois veulent que leur monnaie devienne à terme la seconde devise mondiale, voire la première. Ils ont déjà suggéré aux autres puissances émergentes de ne plus utiliser le dollar pour leurs échanges entre elles, mais une monnaie commune, et pourquoi pas le yuan...
Que peut faire l'Europe face à cette nouvelle super-puissance chinoise?
L'Europe à 27 est une hérésie. La France doit se mettre à table avec l'Allemagne et discuter d'une nouvelle étape de la construction européenne. Peut-on continuer à vivre ensemble, avec les compromis que cela implique? Il faut alors construire une vraie puissance européenne, avec une vraie géostratégie. Les brésiliens ont créé des taxes à l'importation, obligent Apple à produire sur place, idem pour les voitures. L'Europe doit y venir aussi.
Pourquoi avoir titré votre livre «Mourir pour le yuan»?
A la longue, si rien ne se passe, si on continue à accumuler les déséquilibres, comme au début du XXe siècle, l'issue sera la même: la guerre.
Propos recueilli par Dominique Albertini
Libération (24 septembre 2011)