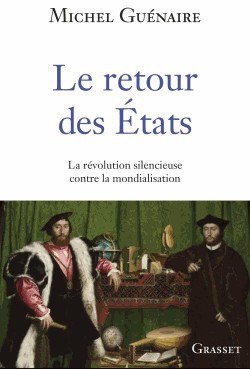Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire et consacré au Front national de Marine Le Pen...
Alain de Benoist vient de publier un essai important, Les démons du Bien, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, dans lequel il se livre à une brillante analyse de l'enfer postmoderne.

Pour s'imposer, le FN doit liquider l'UMP !
Les médias continuent de classer le Front national à droite ou à l’extrême droite de l’échiquier politique. Est-ce toujours pertinent ? D’ailleurs, cela l’a-t-il jamais été ?
Le Front national est à l’origine un mouvement d’extrême droite qui s’est mué progressivement en mouvement national-populiste. Le populisme est un phénomène complexe, que les notions de droite et de gauche ne permettent pas d’analyser sérieusement. Non seulement le FN est aujourd’hui une force montante, qui touche les hommes aussi bien que les femmes et marque des points dans toutes les catégories d’âge ou professionnelles, mais il arrive maintenant en tête des intentions de vote aux élections européennes, loin devant le PS ou l’UMP, ce qui revient à dire qu’il est en passe de s’imposer comme le premier parti de France. Par ailleurs, Marine Le Pen est aux yeux de 46 % des Français la personnalité politique qui incarne le mieux l’opposition (sondage CSA/BFMTV). Comme l’a reconnu Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l’IFOP, « il n’y a plus désormais de sympathisants types du Front national ». Dès lors, son assignation à l’extrême droite relève d’une simple paresse intellectuelle ou d’une propagande qui ne vise qu’à le délégitimer (les deux n’étant pas incompatibles). Mais cette catégorisation n’est plus crédible aujourd’hui. Elle repose sur des arguments qui ont fait long feu.
Un boulevard s’ouvre aujourd’hui devant le Front national, car il n’est pas de jour que les événements ne creusent encore un peu plus le fossé béant qui sépare désormais la Nouvelle classe et le peuple. Dans une telle situation, il n’est plus de « cordon sanitaire » ou de « front républicain » qui tienne. Pas plus qu’on ne fera croire aux Français qu’ils sont devenus « racistes » parce qu’un hebdomadaire a fait une comparaison déplorable qui diffamait stupidement nos amis les singes et les guenons.
On dit que Marine Le Pen a « dédiabolisé » le Front. Il faudrait plutôt dire qu’elle s’est affirmée comme une véritable femme politique – j’entends par là quelqu’un qui a compris ce qu’est la politique : un moyen d’accéder au pouvoir, pas une façon de « témoigner » ou de rassembler une « famille ». C’est ce qui la distingue de son père, et plus encore du brave Bruno Gollnisch. Personnellement, je porte à son crédit d’être restée sourde aux piaillements des excités de tout poil, des anciens combattants des guerres perdues, des revenants de ceci ou de cela, des nostalgiques des régimes d’avant-hier et des époques révolues. C’est dans cette voie qu’elle doit persévérer si elle veut doter son mouvement de cadres dignes de ce nom.
Marine Le Pen semble avoir opéré un virage « à gauche ». Certes, dans les années 80, son père se présentait comme le « Reagan français ». Mais, dès 1972, année de sa création, le Front national publiait un programme économique éminemment « social », voire « socialiste ». Gérard Longuet en fut l’un des principaux signataires. Alors, « virage » ou « retour aux sources » ?
Quelle importance ? L’important est que ce tournant « à gauche » ait été pris. C’est dire que je ne suis pas de ceux qui, devant le programme économique et social du Front, parlent de « démagogie gauchiste ». Que le FN semble avoir compris que la priorité est de lutter contre l’emprise du système capitaliste libéral, contre la logique du marché, contre la globalisation libre-échangiste, contre la colonisation des imaginaires par les seules valeurs commerciales et marchandes, est d’une importance que je n’hésiterai pas à qualifier d’historique, après quarante ans d’« orléanisation » des milieux « nationaux ». C’est ce qui lui permet de toucher les classes populaires, les ouvriers, les artisans, les anciens communistes que scandalise le ralliement au système dominant des anciens révolutionnaires « repentis ».
Pour s’imposer définitivement, le FN doit en priorité liquider l’UMP. C’est la condition première pour que Marine Le Pen soit présente au deuxième tour en 2017. Notons que, de son côté, François Hollande a lui aussi tout intérêt à affronter Marine Le Pen à la prochaine présidentielle plutôt qu’un Sarkozy, un Fillon ou même un Copé. C’est donc là que les choses se joueront.
Certains, souvent dans les milieux identitaires, reprochent à Marine Le Pen sa fibre jacobine. Est-ce aussi simple ? Est-ce aujourd’hui une priorité que d’aller chercher un clivage entre régionalistes et colbertistes ?
Européen et régionaliste, antijacobin dans l’âme, je suis moi-même en désaccord avec Marine Le Pen sur ce point. Mais je suis également conscient que l’Europe politiquement unifiée, l’Europe puissance autonome et creuset de civilisation que je souhaite n’est pas pour demain. L’Union européenne n’est aujourd’hui qu’une caricature d’Europe. À bien des égards, c’est même le contraire de l’Europe. Cela dit, je crois que le souverainisme jacobin demeure une impasse. Voyez la révolte des « Bonnets rouges » en Bretagne : on ne peut rien comprendre à ce mouvement si l’on ne prend pas aussi en compte sa dimension identitaire et régionaliste.
En 1995, Samuel Maréchal, patron du Front national de la jeunesse, publiait un ouvrage intitulé Ni droite ni gauche, Français ! La présidente du Front national semble avoir fait évoluer ce concept en ce que l’on pourrait résumer par un autre slogan : « À la fois de droite et de gauche, mais Français ! »… Progrès ou régression ?
Outre qu’il a déjà une histoire, le slogan « ni droite ni gauche » ne veut pas dire grand-chose. « Et droite et gauche » est bien meilleur. À un moment où de telles notions ne sont plus opérationnelles pour analyser les nouveaux clivages qui se mettent en place, il s’agit de rassembler des idées justes d’où qu’elles viennent. Au lendemain de l’élection présidentielle de 2007, j’avais écrit ceci : « L’avenir du FN dépendra de sa capacité à comprendre que son “électorat naturel” n’est pas le peuple de droite, mais le peuple d’en bas. L’alternative à laquelle il se trouve confronté de manière aiguë est simple : vouloir incarner la “droite de la droite” ou se radicaliser dans la défense des couches populaires pour représenter le peuple de France. » J’ajoutai « qu’il reste au FN à apprendre comment devenir une force de transformation sociale dans laquelle puissent se reconnaître des couches populaires au statut social et professionnel précaire et au capital culturel inexistant, pour ne rien dire de ceux qui ne votent plus ». Cette alternative est toujours présente. Le FN n’a de chances de l’emporter que s’il devient le parti du peuple. C’est même le nom que j’aimerais lui voir porter.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 3 décembre 2013)