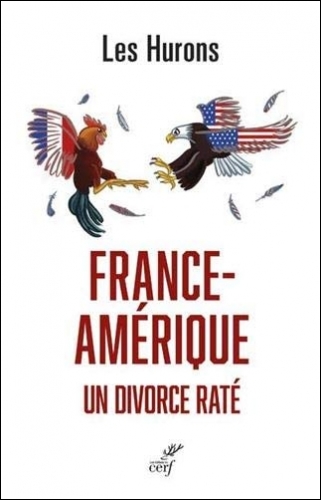Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Héléna Perroud, cueilli sur Geopragma et consacré à la fracture qui s'élargit entre Russie et Europe, fruit d'une politique de long terme menée par les stratèges occidentistes. Russophone, agrégée d'allemand, ancienne directrice de l'Institut Français de Saint-Petersbourg et ancienne collaboratrice de Jacques Chirac à l'Elysée, Héléna Perroud a publié un essai intitulé Un Russe nommé Poutine (Le Rocher, 2018).

Russie-Europe : le grand écart
Un Européen perspicace, Winston Churchill, avait dit en 1939 de la Russie qu’elle est « un rébus enveloppé de mystère au sein d’une énigme ». On oublie souvent la deuxième partie de sa phrase car il ajoutait : « Mais il y a peut-être une clé. Cette clé c’est l’intérêt national russe. » Les malentendus et l’incompréhension entre l’Occident et la Russie ne datent hélas pas d’hier mais ont atteint ces dernières semaines un point dangereux, se muant en franche hostilité : les bruits de bottes en Ukraine, la valse des renvois de diplomates, les soubresauts de l’affaire Navalny, les accusations de cyberattaques et les nouveaux trains de sanctions contre la Russie…
L’épisode qui a commencé en 2014 autour de la Crimée et de l’Ukraine a ouvert une période dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. La Russie dans le rôle de l’agresseur, annexant la Crimée et voulant la partition de l’Ukraine est une des lectures possibles des événements qui se déroulent depuis 2014. Il est étonnant toutefois que dans les analyses faites dans les médias occidentaux, américains et européens, très peu d’observateurs se réfèrent à un ouvrage qui fait pourtant référence et que l’on doit à l’un des plus grands experts américains en matière de géopolitique : Le Grand Echiquier de Brzezinski, dédié à ses « étudiants, afin de les aider à donner forme au monde de demain ». Les dates ont leur importance. Cet ouvrage est sorti en 1997, à un moment où la Russie était à terre. Mal réélu en 1996, Eltsine était un intermittent du pouvoir et ne contrôlait plus grand chose, accaparé par ses ennuis de santé. Les salaires n’étaient pas payés, l’espérance de vie était au plus bas et des séparatistes tchétchènes faisaient la loi. Le fil directeur de l’ouvrage est qu’il faut contenir la Russie dans un rôle de puissance régionale pour asseoir la « pax americana » dans le monde et pour ce faire détacher d’elle un certain nombre de pays satellites : les républiques d’Asie centrale et les pays d’Europe de l’Est, le rôle principal revenant à l’Ukraine. Brzezinski l’écrit sans ambages : « L’Ukraine constitue cependant l’enjeu essentiel. Le processus d’expansion de l’Union européenne et de l’OTAN est en cours. L’Ukraine devra déterminer si elle souhaite rejoindre l’une ou l’autre de ces organisations. Pour renforcer son indépendance, il est vraisemblable qu’elle choisira d’adhérer aux deux institutions dès qu’elles s’étendront jusqu’à ses frontières et à la condition que son évolution intérieure lui permette de répondre aux critères de candidature. Bien que l’échéance soit encore lointaine, l’Ouest pourrait dès à présent annoncer que la décennie 2005-2015 devrait permettre d’impulser ce processus. »
Si on connaît cet ouvrage, si on en comprend la philosophie, il est une autre lecture possible des événements de 2014 : l’application à la lettre de l’agenda défini par les stratèges américains, depuis la révolution orange de 2004 jusqu’aux événements de Maidan à l’hiver 2013-2014 avec la suite que l’on connaît et les 13000 morts du Donbass que l’on oublie trop souvent.
Le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov le citait encore le 1er avril dans un entretien d’une rare franchise accordé à la Première Chaîne de la télévision russe, en réponse aux accusations de Joe Biden traitant Poutine de « tueur ».
Dans la crise qui a éclaté ces jours-ci entre Prague et Moscou, on voit que les projecteurs sont braqués sur l’entreprise Rosatom et le vaccin Spoutnik V. Le motif officiel de la brouille réside dans les soupçons pesant sur l’implication de la Russie dans une affaire d’explosion dans un stock d’armement en République tchèque qui remonte à 2014 et qui éclate curieusement aujourd’hui. S’agissant du vaccin, si l’Union européenne rechigne à lui accorder droit de cité (même si trois pays de l’UE l’ont adopté à ce jour), il est autorisé dans une soixantaine de pays qui représentent un quart de la population mondiale. Son efficacité, d’abord évaluée à 91,6 % par une étude publiée dans le Lancet se monterait aujourd’hui à 97,6 % sur la base des données provenant de 3,8 millions de personnes ayant reçu les deux doses, d’après une étude de l’Institut Gamaleïa qui l’a mis au point. A côté des déboires des vaccins occidentaux, on peut comprendre l’intérêt de certains à barrer la route au vaccin russe. Pour ce qui concerne Rosatom, qui était en lice avec d’autres concurrents pour une centrale nucléaire dans ce pays, il vient d’être exclu de l’appel d’offres. Peut-être faut-il regarder là du côté de l’Arabie Saoudite et de la tournée qu’a entreprise Sergueï Lavrov dans les monarchies du Golfe courant mars. Ce traditionnel allié des États-Unis resserre ses liens avec la Russie depuis quelques années, notamment depuis la visite historique – la première du genre – du roi Salman à Moscou à l’automne 2017. Et là aussi Rosatom est dans la course pour construire une centrale nucléaire et a passé avec succès les premières étapes, même si le terrain est bien occupé par la Chine, dont l’entreprise publique CNNC est engagée avec le ministère saoudien de l’énergie dans un programme d’extraction d’uranium. La Russie va ouvrir une représentation commerciale à Riyad à l’automne, une offre d’achat du système antimissiles russe S-400 est sur la table et l’inauguration du troisième réacteur de la centrale nucléaire d’Akkuyu en Turquie, dont le chantier a été confié à Rosatom, a eu lieu en grandes pompes en présence des présidents turc et russe le 10 mars, le jour même où Lavrov rencontrait son homologue saoudien… peut-être plus qu’une simple coïncidence.
Le résultat de cette stratégie occidentale au long cours – américaine d’abord mais suivie à la lettre par les Européens – est maintenant là. Les Russes se sentent de moins en moins Européens. Un diplomate russe m’avait fait part en 2019 de sa préoccupation devant le gouffre qui s’élargissait entre l’Europe et la Russie depuis 5 ans, le temps moyen, disait-il, qu’un étudiant passe dans l’enseignement supérieur et se forge sa vision du monde. Un sondage du centre Levada (institut indépendant du gouvernement) rendu public le 18 mars dernier, sept ans après « l’annexion » ou « le rattachement » de la Crimée – à chacun de choisir sa vision – confirme cette tendance. Aujourd’hui 29% seulement des Russes disent que leur pays est européen. Ils étaient 52% en 2008. Fait notable : chez les plus jeunes ce sentiment d’éloignement de l’Europe est plus fort que chez leurs aînés : les plus de 55 ans sont 33% à estimer que la Russie est un pays européen, un taux qui tombe à 23% chez les 18-24 ans. Alors qu’en 2000, Poutine écrivait sans sourciller, en répondant à des questions de journalistes dans le premier ouvrage biographique qui lui était consacré en Russie « Première personne » : « Nous sommes Européens » – c’était le titre d’un chapitre entier . En août 2019 encore, il recevait au Kremlin l’homme fort de la Tchétchénie en le félicitant pour l’inauguration dans la ville de Chali de « la plus grande mosquée d’Europe » même si sur ces terres du Caucase on est un peu éloigné de l’univers mental européen.
Vu de France, où un ennemi bien identifié nous a déclaré la guerre, emportant encore une vie innocente vendredi 23 avril à Rambouillet, en privant deux enfants mineurs de leur mère qui s’était engagée au service de ses compatriotes en choisissant d’entrer dans la police, il serait temps de changer de regard et de ne plus se tromper d’ennemi. Et même de comprendre que dans ce combat-là la Russie, dont 15% de la population est de confession musulmane, et dont le caractère multi-ethnique et multi-confessionnel échappe très largement au regard occidental, a peut-être quelque chose à dire aux vieux pays d’Europe de l’Ouest.
Héléna Perroud (Geopragma, 26 avril 2021)