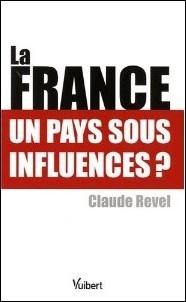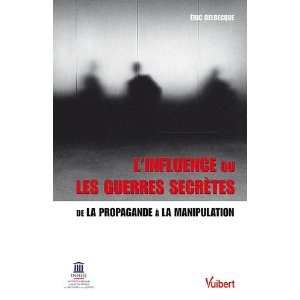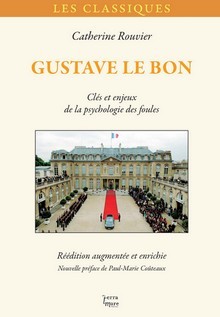Nous reproduisons ci-dessous un éditorial du quotidien Le Monde consacré à l'effondrement des budgets de défense en Europe et à ses conséquences...

Danger : l'Europe renonce à se défendre
Supprimons carrément une arme : l'infanterie, la marine ou l'armée de l'air ! C'est le choix volontairement provocateur qu'a proposé il y a six mois le chef d'état-major suédois, le général Sverker Göranson, pour alerter sur le prix à payer de la réduction de moitié des dépenses militaires, opérée par la Suède depuis quinze ans.
Faute d'être entendu, le bouillant militaire récidive. Il vient de lancer un cri dans la presse : ses moyens actuels, écrit-il, ne lui permettraient pas de défendre le pays plus d'une semaine si d'aventure la Suède devait être attaquée.Le général Göranson pourrait faire école, car cet autre " modèle suédois " - celui de budgets militaires peau de chagrin - s'est tellement répandu en Europe que les secrétaires américains à la défense, de Robert Gates à Leon Panetta, ne cessent de déplorer ce qu'ils considèrent comme une automutilation de la part d'un continent sur le point de se priver des moyens stratégiques nécessaires pour préserver la petite part d'influence qui lui reste.
L'Europe de la défense n'existe pas, faut-il se résigner au fait que la défense en Europe n'existe plus ? De Londres à Rome et à Madrid en passant par Berlin et Paris (les autres pays ne comptent guère en termes de capacités militaires à part la Pologne), le rabot de la rigueur fait son œuvre.
En ces temps d'incertitude stratégique, l'Europe désarme.L'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright avait fixé, dans un rapport publié en 2010, à 2 % du produit intérieur brut le seuil au-dessous duquel les pays membres de l'OTAN seraient avisés de ne pas aller, sous peine de compromettre un niveau de sécurité commune crédible.C'est peu dire qu'elle n'a pas été entendue. En 2012, face aux États-Unis, qui concentrent 46% des dépenses militaires mondiales, et alors que la Chine et la Russie investissaient massivement, l'Italie était à 0,84 %, l'Espagne à 0,65 % et la France à 1,7 %. Seul le Royaume-Uni remplissait sa part du contrat.
L'enjeu est pourtant stratégique à un autre titre, qu'a rappelé le rapport remis par l'ancien ministre des affaires étrangères Hubert Védrine à François Hollande en novembre 2012. A ce rythme, il est en effet plus que probable que les industriels européens de la défense disparaîtront définitivement des appels d'offres des pays émergents, comme ce fut le cas dans ce qui apparaîtra vite comme une butte témoin du passé pour les avionneurs suédois et français au Brésil.Cette spirale d'attrition ne pourra qu'emporter les industries de la défense du Vieux Continent et placer définitivement les Européens dans l'orbite d'un complexe américain sans doute avide de compenser au-delà de ses frontières les coupes budgétaires qu'il doit également subir chez lui. La baisse des budgets de la défense ignore les retombées civiles du militaire ; elle accélère la désindustrialisation que l'on prétend combattre.
Perte d'influence, d'emplois et d'autonomie, c'est à ces autres aunes que les coupes budgétaires dans la défense doivent également être examinées. Quitte à passer pour d'éternels râleurs, les généraux ont raison : alors que le Sud émergent réarme à grande vitesse, l'Europe va trop loin dans les coupes dans la défense.
Elle risque de sortir de l'Histoire.
Editorial du Monde (5 janvier 2013)