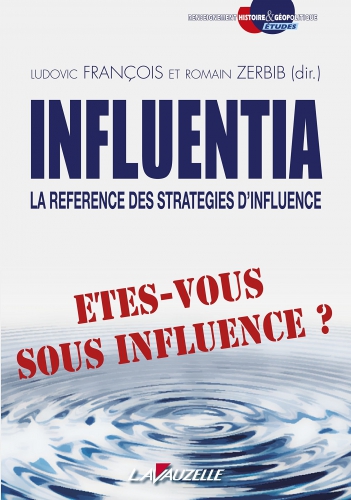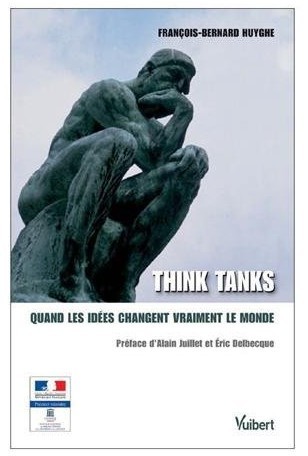Opérations extérieures et opérations d'influence: le décryptage du Général Vincent Desportes
Somalie, Centrafrique, Mali… à des titres divers, l'armée française intervient sur bien des fronts. Il ne s'agit plus seulement de frapper l'ennemi, il faut aussi gérer les conflits informationnels et anticiper les réactions, le tout en intégrant de multiples paramètres. Comment percevez-vous cette imbrication des hard et soft powers ?
Nous assistons indéniablement à un affrontement des perceptions du monde. Les terroristes cherchent à faire parler d'eux, à faire émerger leur perception du monde à travers des actions militaires frappant l'opinion, actions dont la finalité est d'abord d'ordre idéologique. Ils inscrivent leurs actions de terrain dans le champ de la guerre informationnelle. Ils font du hard power pour le transformer en soft power. Les opérations militaires qu'ils conduisent le sont en vue de buts d'ordre idéologique. Ils ne recherchent pas l'effet militaire immédiat. Ils agissent plutôt en termes d'influence, à mesurer ultérieurement. Dans cette configuration, il y a une interaction permanente entre le militaire stricto sensu et le jeu des idées qui va exercer une influence sur les opinions publiques. La guerre est alors vue comme un moyen de communication, qui a pour but de faire changer la perception que le monde extérieur peut avoir de celui qui intervient.
Notons que cela ne joue pas que pour les terroristes. La France intervient au Mali et elle a raison de le faire. En agissant ainsi, de manière claire et efficace, elle modifie la perception que le monde pouvait avoir d'elle, à savoir l'image d'une nation plutôt suiveuse des États-Unis, comme ce fut le cas en Afghanistan. En intervenant dans des délais très brefs et avec succès loin de ses bases, en bloquant les colonnes terroristes, en regagnant le terrain perdu par les soldats maliens, et surtout en ayant agi seule, elle ressurgit d'un coup sur la scène médiatico-politique comme un leader du monde occidental. Était-ce voulu au départ ? Je ne sais pas. Mais le résultat est là. La France retrouve sa place dans le jeu complexe des relations internationales à partir d'une action militaire somme toute assez limitée. En conséquence, si l'on veut avoir une influence sérieuse dans le monde, nous devons conserver suffisamment de forces militaires classiques relevant du hard power, pour pouvoir engager des actions de soft power. L'un ne va pas sans l'autre. Le pouvoir politique doit bien en prendre conscience.
Justement, à l'heure où s'achève la réflexion sur le futur Livre blanc, quid des armes du soft power dans le cadre de la Défense ? La France n'est-elle pas en retard dans ce domaine ? N'est-il pas grand temps, comme vous le suggériez dans La guerre probable, de commencer enfin à "penser autrement" ?
"Toute victoire, disait le général Beaufre, est d'abord d'ordre psychologique." Il ne faut jamais perdre de vue que la guerre, c'est avant tout l'opposition de deux volontés. En ce sens, l'influence s'impose bel et bien comme une arme. Une arme soft en apparence, mais redoutablement efficace, qui vise à modifier non seulement la perception, mais encore le paradigme de pensée de l'adversaire ou du moins de celui que l'on veut convaincre ou dissuader. Dans la palette qui lui est offerte, l'homme politique va ainsi utiliser des moyens plus ou moins durs (relevant donc de la sphère du hard power) ou au contraire plus ou moins "doux" (sphère du soft power) en fonction de la configuration au sein de laquelle il évolue et des défis auxquels il se trouve confronté.
Le problème de la pensée stratégique française est justement qu'elle éprouve des difficultés à être authentiquement stratégique et donc à avoir une vision globale des choses. Notre pays a du mal à construire son action en employant et en combinant différentes lignes d'opérations. L'une des failles de la pensée stratégique française est de n'être pas en continuité comme le percevait Clausewitz, mais une pensée en rupture. C'est-à-dire qu'au lieu de combiner simultanément les différents moyens qui s'offrent à nous, nous allons les employer successivement dans le temps, au cours de phases en rupture les unes avec les autres. On fait de la diplomatie, puis on a recours aux armes du hard power, puis on revient à nouveau au soft power. Cette succession de phases qui répondent chacune à des logiques propres n'est pas forcément le moyen idoine de répondre aux problèmes qui se posent à nous. Utiliser en même temps ces armes, en les combinant intelligemment, me paraîtrait souhaitable et plus efficace. Notre pays a malheureusement tendance à utiliser plus facilement la puissance matérielle que la volonté d'agir en douceur pour modifier ou faire évoluer la pensée – et donc le positionnement – de celui qui lui fait face.
Notre tradition historique explique sans doute pour une bonne part cette réticence à utiliser ces armes du soft power. Pour le dire plus crûment, nous nous méfions des manœuvres qui ne sont pas parfaitement visibles. L'héritage de l'esprit chevaleresque nous incite plutôt à vouloir aller droit au but. Nous sommes des praticiens de l'art direct et avons beaucoup de mal à nous retrouver à agir dans l'indirect, le transverse. À rebours par exemple des Britanniques, lesquels pratiquent à merveille ces stratégies indirectes, préférant commencer par influencer avant d'agir eux-mêmes. Prenons l'exemple de leur attitude face à Napoléon. Le plus souvent, au lieu de chercher l'affrontement direct, ils ont joué de toutes les gammes des ressources du soft power et engagé des stratégies indirectes. Ils ont cherché à fomenter des alliances, à faire en sorte que leurs alliés du moment, les Russes, les Prussiens, les Autrichiens, s'engagent directement contre les armées françaises. Ils ont su susciter des révoltes et des révolutions parmi les populations qui étaient confrontées à la présence ou à la menace française, comme ce fut le cas en Espagne. Le but étant à chaque fois de ne pas s'engager directement mais de faire intervenir les autres par de subtils jeux d'influence.
Cette logique demeure toujours d'actualité ?
Indéniablement. Même sur le plan strictement opérationnel, cette même logique perdure sur le terrain. Les travaux de l'historien militaire Sir Basil Henry Liddle Hart dans l'entre-deux guerres mondiales en matière de promotion des stratégies indirectes sont particulièrement édifiants. Liddle Hart prône le harcèlement des réseaux logistiques de l'adversaire, des frappes sur ses réseaux de ravitaillement, et dans le même temps recommande de contourner ses bastions plutôt que de l'attaquer de front.
En ce sens, nous avons un retard à combler. Comme les Américains, au plan militaire, nous préférons l'action directe. Nous avons la perpétuelle tentation de l'efficacité immédiate qui passe par le choc direct. Pour preuve nos combats héroïques mais difficiles d'août 1914. On fait fi du renseignement, on croit que l'on va créer la surprise, on préfère agir en fondant sur l'adversaire, en croyant benoîtement que la furia francese suffira à l'emporter. On sait ce qu'il advint… Le fait est que nous préférons le choc frontal aux jeux d'influence. Nous comprenons d'ailleurs mal les logiques et rouages des stratégies indirectes. Nous cherchons à attaquer la force plutôt que la faiblesse, ce qui est à l'exact opposé de ce que prône Sun Tzu. Comme on le sait, pour ce dernier, l'art de la guerre est de gagner en amenant l'ennemi à abandonner l'épreuve engagée, parfois même sans combat, en utilisant toutes les ressources du soft power, en jouant de la ruse, de l'influence, de l'espionnage, en étant agile, sur le terrain comme dans les têtes. En ce sens, on peut triompher en ayant recours subtilement aux armes de l'esprit, en optimisant les ressources liées à l'emploi du renseignement, en utilisant de façon pertinente les jeux d'influence sur les ressorts psychologiques de l'ennemi.
Jusqu'à ces dernières années, on hésitait à parler d'influence au sein des armées, principalement à cause des séquelles du conflit algérien. Les blocages mentaux sont encore très forts. Cependant, les interventions conduites par les Anglosaxons en Irak et en Afghanistan ont contribué à tourner la page. Nos armées doivent-elles, selon vous, se réapproprier ce concept et les outils qui en découlent ?
Dans les guerres de contre-insurrection que nous avons eues à conduire, nous avons compris que l'important était moins de détruire l'ennemi que de convaincre la population du bienfait de notre présence et de notre intervention. Ce sont effectivement les Américains, qui ont redécouvert la pensée française de la colonisation, de Lyautey et de Gallieni, qui privilégiaient la démarche d'influence à la démarche militaire stricto sensu. Notre problème dans les temps récents est effectivement lié aux douloureuses séquelles du conflit algérien, où nous avions cependant bien compris qu'il fallait retourner la majorité de la population pour stabiliser le pays et faire accepter la force française. Ce qui, dans les faits, fut réussi. Le discrédit jeté sur les armées et certaines méthodes ayant donné lieu à des excès, ont eu pour conséquence l'effacement des enjeux de la guerre psychologique et des démarches d'influence.
Avec l'Afghanistan, les choses ont évolué. Au début, nous considérions que l'aide aux populations civiles avait d'abord pour but de faire accepter la force. Ce fut peut-être un positionnement biaisé. Nous n'avions sans doute pas suffisamment intégré le fait que les opérations d'aide aux populations étaient primordiales, puisqu'il s'agissait d'opérations destinées à inciter les populations à adhérer à notre projet. Les Américains ont compris avant nous que les opérations d'influence étaient faites pour faire évoluer positivement la perception de leur action, en gagnant comme ils aimaient à le dire, les cœurs et les esprits de ces populations.
Dans Le piège américain, vous vous interrogez sur les raisons qui peuvent amener les États-Unis à perdre des guerres. Accorde-t-on une juste place aux opérations d'influence ? Comment voyez-vous chez nous l'évolution du smart power ?
Premier constat, la force est un argument de moins en moins utilisable, car de moins en moins recevable dans les opinions publiques. Si nous voulons faire triompher notre point de vue et imposer notre volonté, il faut s'y prendre différemment et utiliser d'autres moyens. Et d'abord s'efforcer de trouver le meilleur équilibre entre les outils qu'offre le soft power, avec une juste articulation entre les moyens diplomatiques ou d'influence, et les outils militaires. Ces derniers ne peuvent plus être employés comme ils l'étaient avant, l'avantage comparatif initial des armées relevant de l'ordre de la destruction.
Ce bouleversement amène naturellement les appareils d'État à explorer les voies plus douces présentées par les opérations d'influence, lesquelles sont bien sûr davantage recevables par les opinions publiques. Or, pour en revenir à votre question, la puissance militaire déployée par les Américains est par nature une puissance de destruction, donc de moins en moins utilisable dans le cadre évoqué ici. Sinon, comment expliquer que la première puissance mondiale, qui rassemble plus de la moitié des ressources militaires de la planète, n'ait pu venir à bout des Talibans ?
C'est bien la preuve que le seul recours à la force brute ne fonctionne pas. Les États doivent donc chercher dans d'autres voies que celle de la pure destruction, les moyens d'assurer la poursuite de leurs objectifs politiques. Même si nous devons garder à l'esprit que ce moyen militaire stricto sensu reste essentiel dans certaines configurations bien définies. Il ne s'agit pas de se priver de l'outil militaire, qui peut demeurer déterminant sous certaines conditions, mais qui n'est plus à même cependant de résoudre à lui seul l'ensemble des cas auxquels les États se trouvent confrontés.
Vous qui avez présidé aux destinées de l'École de guerre, quelle vision avez-vous de l'influence, des stratégies et des opérations d'influence ?
L'enseignement à l'École de guerre évolue. Même si nous nous efforçons de penser avant tout sur un mode stratégique, néanmoins, nous travaillons toujours sur les opérations relevant prioritairement du hard power.
Nous intégrons bien sûr les opérations relevant du soft power, mais elles ne sont pas prioritaires. L'élève à l'École de Guerre doit avant tout savoir planifier - ou du moins participer à des équipes de planification - dans le cadre de forces et d'opérations d'envergure. Il y a un certain nombre de savoir-faire techniques à acquérir, lesquels reposent davantage sur l'usage de la force que sur celui de l'influence. Pour les élèves, c'est là un métier nouveau à acquérir, complexe, très différent de ce qu'ils ont connu jusqu'alors, qui se trouve concentré sur l'emploi de la force militaire à l'état brut. Cependant, dans tous les exercices qui sont conduits, il y a une place pour les opérations d'influence. La difficulté est que l'on ne se situe pas là dans le concret, et que c'est délicat à représenter. Les résultats sont difficiles à évaluer, ils ne sont pas forcément quantifiables, ils peuvent aussi être subjectifs. Alors, peut-être d'ailleurs par facilité, on continue à faire ce que l'on sait bien faire, plutôt que de s'aventurer à faire ce qu'il faudrait réellement faire.
L'Armée de Terre n'a pas à définir une stratégie d'ensemble. Elle doit simplement donner une capacité opérationnelle, maximale à ses forces. Une Armée se situe au niveau technique et opérationnel. Le niveau stratégique se situe au niveau interarmées. Et c'est là que doit s'engager la réflexion à conduire en matière de soft power. Ces précisions étant apportées, il n'en demeure pas moins que – tout particulièrement au sein de l'Armée de Terre – il est nécessaire d'avoir recours à la doctrine qui porte sur les actions à conduire en direction des populations, puisque l'on veut influer sur la perception qu'elles ont de notre action. Reconnaissons pourtant que nous sommes moins avancés que les Américains en ce domaine. Un exemple: un général américain qui commandait la première division de cavalerie en Irak, m'a raconté comment, avant de partir, il avait envoyé tous ses officiers d'état-major à la mairie de Houston pour voir comment fonctionnait une ville. Car il savait bien qu'il allait acquérir le soutien de la population irakienne non pas en détruisant les infrastructures, mais au contraire en rétablissant au plus vite les circuits permettant d'assurer les besoins vitaux, comme les réseaux d'eau ou d'électricité. Il a donc travaillé en amont sur une opération d'influence, qu'il a su parfaitement intégrer à sa manœuvre globale. De la sorte, la manœuvre d'ordre strictement militaire ne venait qu'en appui de la démarche d'influence.
A-t-on agi de même en Afghanistan?
En Afghanistan, on a travaillé sur trois lignes d'opérations: sécurité, gouvernance, développement. On a compris que l'on ne pouvait pas travailler de manière séquentielle, (d'abord sécurité, puis gouvernance, puis développement), mais que l'on devait travailler en parallèle sur les trois registres, avec une interaction permanente permettant d'aboutir harmonieusement au résultat final. Si les lignes gouvernance et développement relèvent peu ou prou de la sphère de l'influence, il faut cependant reconnaître que le poids budgétaire de la ligne sécurité est de loin le plus important.
Pourquoi ?
Au niveau des exécutifs gouvernementaux, on considère que les opérations militaires sont du ressort du hard power. Or, l'action sur les autres lignes d'opération est au moins aussi importante que sur la ligne d'opération sécurité. De fait, au moins dans un premier temps, les militaires sont d'autant plus à même de conduire les opérations d'influence qu'ils sont les seuls à pouvoir agir dans le cadre extrêmement dangereux où ils sont projetés. Mais ils ont effectivement une propension à penser prioritairement les choses selon des critères sécuritaires. Autre point à prendre en considération, les États ont des budgets limités pour leurs opérations. Les opérations militaires coûtent cher. La tendance naturelle va donc être de rogner sur les autres lignes qui n'apparaissent pas – à tort sans doute – comme prioritaires. Concrètement, influence, développement, gouvernance se retrouvent ainsi être les parents pauvres des opérations extérieures.
N'y-a-t-il pas également un problème de formation?
Dans les armées, on est formé comme lieutenant, capitaine, commandant pour parvenir d'abord à l'efficacité technique immédiate. On est ainsi littéralement obsédé par cet aspect des choses et son corollaire, à savoir le très rapide retour sur investissement. On concentre ainsi nos ressources intellectuelles sur le meilleur rendement opérationnel des forces, en privilégiant le budget que l'on consent à une opération. N'oublions pas que nous évoluons aujourd'hui au sein de sociétés marchandes qui veulent des retours sur investissement quasiment immédiats. Nous sommes ainsi immergés dans le temps court, à la différence par exemple des sociétés asiatiques qui, elles, ont une perception radicalement différente du facteur temps. Elles savent qu'à long terme, il est infiniment moins onéreux de laisser le temps au temps, de laisser les transformations se faire progressivement, d'accompagner par l'influence ces transformations. La Chine se vit et se pense sur des millénaires, elle connaît la force des transformations silencieuses qui atteignent leur objectif par le biais de savantes et patientes manœuvres d'influence. Nous cherchons le rendement immédiat à coût fort. Ils visent le rendement à long terme et à faible coût.
En guise de conclusion, peut-il y avoir une communication d'influence militaire ?
C'est un peu la vocation du Centre interarmées des actions sur l'environnement, créé en juillet dernier de la fusion du Groupement interarmées actions civilo-militaires (GIACM) et du Groupement interarmées des opérations militaires d’influence (GI-OMI). Sur les théâtres où nous opérons, nous mettons naturellement en place des vecteurs destinés aux populations locales, visant à mieux faire comprendre notre action, à faire percevoir en douceur les raisons pour lesquelles nous agissons. En un mot, nous nous efforçons de jouer sur les perceptions et sur l'image. Mais ce jeu assez fin sur l'influence reste le parent pauvre de l'action militaire.
L'influence est tout en subtilité. On ne la perçoit pas comme on peut percevoir un tir d'artillerie ou une frappe aérienne. Même si nous sommes persuadés du bienfondé des opérations d'influence, nous ne parvenons pas à faire d'elles des priorités, donc à dégager suffisamment de budgets et de personnels à leur profit. En outre, les configurations actuelles privilégient plutôt les projections de puissance pour faire plier l'adversaire. Or, dans l'histoire et en prenant les choses sur le long terme, on constate que l'utilisation de la seule force pure ne marche pas dès lors qu'on examine les choses dans la durée. La projection de puissance ou l'action brutale sont capables de faire plier momentanément l'adversaire. Mais tant que l'on n'a pas changé les esprits, l'adversaire va revenir à la charge, quitte à contourner les obstacles. D'où l'importance capitale des opérations d'influence quand on embrasse une question dans son ensemble. Sur ces questions, je renvoie volontiers au remarquable ouvrage du général Sir Rupert Smith, L'utilité de la force, l'art de la guerre aujourd'hui (Economica, 2007). Pour lui, désormais, les opérations militaires doivent être considérées moins pour ce qu'elles produisent comme effets techniques que pour ce qu'elles produisent sur l'esprit de l'autre. C'est là une préoccupation relativement récente. Ainsi, les dommages collatéraux se révèlent contre-productifs et viennent miner le résultat militaire que l'on vise. Il nous faut bien plutôt réfléchir en termes d'effets à obtenir sur l'esprit de l'autre. C'est là que l'influence s'impose comme une démarche capitale, qu'il nous faut apprendre à maîtriser. Si l'on fait l'effort de mettre les choses en perspective, sur le long terme, on voit bien que toute action militaire, au fond, doit intégrer pleinement la dimension influence, jusqu'à être elle-même une action d'influence.
Général Vincent Desportes, propos recueillis par Bruno Racouchot (Communication & Influence, janvier 2013)