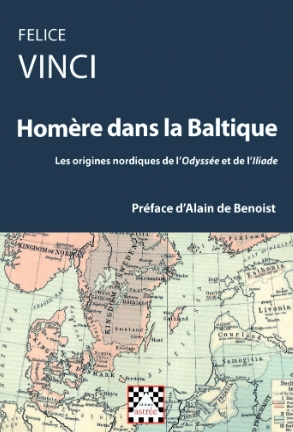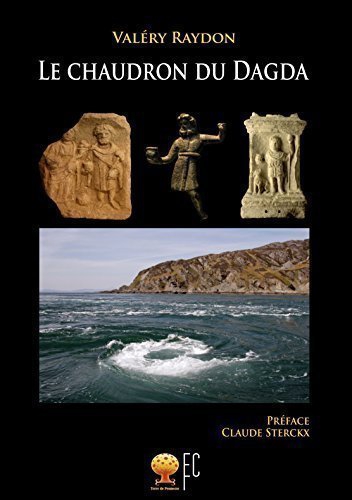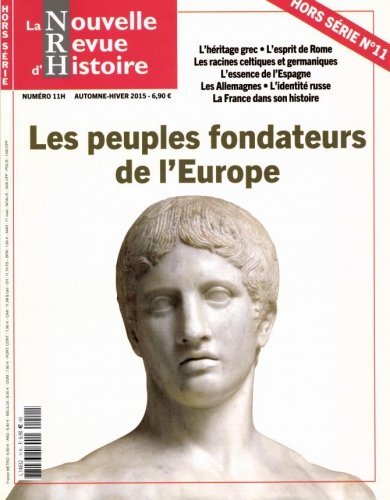Les éditions Les belles Lettres viennent de publier un ouvrage de Bernard Sergent, intitulé Le Dieu fou - Essai sur les origines de Siva et Dionysos. Chercheur au CNRS, docteur en histoire ancienne, président de la Société de Mythologie Française, Bernard Sergent est spécialiste des Indo-Européens et est notamment l'auteur de Les Indo-Européens - histoire, langue, mythes (Payot, 1995) et de Celtes et Grecs - Le livre des héros et Le livre des dieux (Payot, 2000 et 2004).
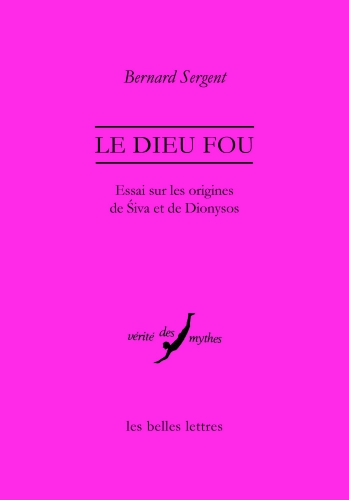
" Ce livre revient sur une comparaison entre deux grands dieux, l'un, grec, Dionysos, l’autre, indien, Śiva. En tenant compte des travaux antérieurs et en apportant un nouveau matériel, l’auteur montre que ces deux figures remontent à une seule et même, celle d’un dieu auquel sont attribués tous les excès (débauche, consommation d’alcools ou de drogues, etc.). Ce dieu lié au monde des morts entraîne ses fidèles et adorateurs au-delà des limites communément admises par la société. Dionysos et Śiva possèdent un grand nombre de mythes en commun, et globalement ce qui est dit en Grèce ancienne de Dionysos était dit de Śiva en Inde ancienne et médiévale.
La recherche comparative révèle que d’autres figures divines chez les Germains, les Baltes, les Anatoliens, les Thraces, les Phrygiens, les Celtes se rattachent à Dionysos et Śiva. Cela confirme que Śiva et Dionysos représentent un héritage religieux indo-européen. Inde et Grèce se caractérisent, par rapport aux autres nations de langue indo-européenne, par l’extrême richesse du matériel qu’elles offrent.
C’est donc tout un pan de l’idéologie indo-européenne qui se distingue et se met ici en exergue. "