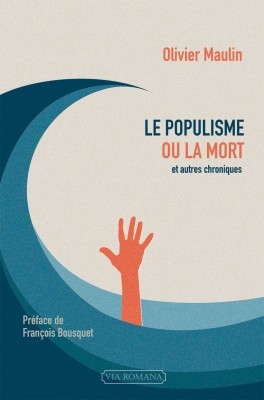Immigration : « Oser combattre, oser vaincre » (2)
Les bonnes raisons de s’opposer au droit à l’immigration qu’institue le droit à la mobilité individuelle sont multiples. Il faut s’en saisir et les utiliser comme des armes pour construire un ordre du monde qui remplace le désordre actuel. Pas pour nous ; pour tous. Car l’immigration est une somme de malheurs dont les migrants font les frais autant que les populations dites d’accueil qui subissent leur arrivée – et dont les bénéfices sont tout entier pour un capitalisme global qui ne connaît ni les uns ni les autres.
1 — « Un million de migrants, c’est un million d’individus »
L’individualisme rend fous ceux qu’il veut détruire ! Quel mépris de l’histoire, des cultures et des religions qu’une telle affirmation ! Ceux qui viennent ne sont pas des individus de droit, fiction juridique qui naît sur les rives du nord de la Méditerranée ! Ils viennent comme Afghans, comme Kurdes, comme Maliens, comme Soudanais. Ils viennent comme musulmans, comme chrétiens orthodoxes, comme Coptes. Et avec eux, selon leur nombre, la force de leurs convictions ou de leurs combats, c’est un peu d’Afghanistan, d’Irak, de Mali ou de Soudan qui s’installe avec eux.
Des langues, des cultures, des modes de vie, qui peuvent se dissoudre dans le bain européen quand leurs porteurs sont peu nombreux, qui peuvent au contraire s’imposer sur le territoire européen quand leurs porteurs se regroupent en communautés soudées et homogènes. Le nombre compte. Et dix, cinquante, cent migrants sont autant d’individus ; un million de migrants méritent un autre nom, et appellent d’autres moyens.
2 — « Tous les hommes aspirent à devenir comme nous ! »
La « fin de l’histoire » s’est fracassée avec les avions rentrant dans les tours de Manhattan, mais le mensonge proféré par Tony Blair est un refrain qui dure. Ici encore, quel mépris pour ces civilisations, pour ces sociétés qui vivent avec d’autres règles que les nôtres, d’autres modèles que les nôtres, qui s’en trouvent bien, et qui n’en vont point changer ! Et quel réductionnisme que cette affirmation ; s’ils trouvent le gîte et le couvert, ils deviendront comme nous ! La grande surprise du XXIe siècle, c’est que ces Chinois qui mangent à leur faim, ces Hindous qui maîtrisent l’informatique, et ces milliards qui ont accès à Internet, demeurent chinois, demeurent Hindous, demeurent des Autres, bien dans leurs mœurs, bien dans leurs lois, bien dans leur foi, et qu’ils ne vont pas devenir comme nous, même s’ils entendent tirer tout le parti qu’ils peuvent de notre incurable naïveté et du grand mensonge universaliste. Et pourquoi ne pas dire comme eux que nous sommes bien décidés à rester Français, Italiens ou Autrichiens, et que nos différences elles aussi méritent de demeurer ?
3 — « Tous les hommes sont les mêmes »
Rien ne peut mieux nier la culture, cet effet du génie et de la liberté humaine confrontée à la singularité des territoires, des climats, et des histoires des sociétés des hommes. Les dauphins parlent le dauphin, les hommes ne parlent pas l’humain. Le propre de l’homme, animal politique, c’est la diversité des formes que l’exercice de sa liberté, à travers la culture, donne à ses modes de vie. Les ethnologues s’en sont émerveillés ; dans les mêmes conditions écologiques, deux sociétés humaines vont développer des institutions, des mœurs et des lois différentes. La nature rapproche des hommes que leur culture distingue. Une fois encore, sous couvert d’idéal, c’est à un abaissement général de la personne humaine que l’idéologie immigrationniste se livre.
Et c’est à une attaque contre la civilisation elle-même, puisque, selon le mot de Claude Lévi Strauss, « il n’est pas de civilisation s’il n’est des civilisations ». Si tous les hommes sont les mêmes, culture et civilisation sont de vains mots, qui font entre les sociétés humaines les différences, les écarts et les séparations que la nature ne fait pas. Et si tous poursuivent les mêmes désirs, c’en sera bientôt fini de l’expérience humaine ; pour que 8 milliards d’êtres humains accèdent au modèle de vie qu’impose le soft power américain et tous les zélés du développement forcé, quatre ou cinq planètes ne suffiraient pas !
4 — « L’aide aux migrants est un sujet humanitaire »
L’immigration est devenue l’une des premières activités criminelles au sud et à l’est de la Méditerranée. Son chiffre d’affaires ne cède qu’au trafic de drogue. Le crime organisé a compris le parti qu’il pouvait tirer des offres d’assistance inconditionnelle libéralement offertes par l’Europe, et accessibles à tous par Internet, et de l’assistance opérationnelle qu’offraient à ses services de passage à travers la Méditerranée le sauvetage assuré par les bateaux des ONG, puis par Frontex. Le message de l’Union européenne n’est pas ; « on ne passe pas ! », c’est ; « venez, on vous fournira le passage ! » L’Union européenne se rend coupable de prêter la main au trafic des esclaves, à a fois parce qu’elle fournit de la main-d’œuvre bon marché, inorganisée, aux exploitants européens, et parce qu’elle détruit peu à peu les mutualités entre citoyens à l’intérieur de chaque Nation — elle fait exploser des systèmes sociaux qui ne survivent que s’ils demeurent des systèmes fermés. La fermeté à l’origine aurait été la véritable réponse humanitaire à une pression que les passeurs et les trafiquants d’hommes ne savent que trop bien exploiter.
5 — « Les migrations sont une réponse au sous-développement et aux régimes autoritaires »
Dire que ce qui peut arriver de meilleur à un Malien, un Malgache ou un Afghan est de devenir européen est d’un mépris total. Le meilleur est qu’ils travaillent, agissent, aident leur pays à devenir ce qu’il veut être. La réalité des migrations est le pillage de la ressource humaine des pays qu’elle touche. Et c’est la paralysie politique ; certaines des dictatures les plus sévères ont sciemment encouragé le départ des meilleurs des plus actifs et des plus remuants — de l’étranger, ils ne pourront agir. Si l’Union soviétique avait organisé le départ à l’Ouest de ses plus remuants opposants, elle serait toujours là.
Pour ceux qui rêvent d’en finir avec le politique, de désarmer leur opposition et de livrer la société à l’économie, les migrations sont un moyen rêvé d’en finir avec la citoyenneté, cette prise en charge des affaires publiques qui unit ceux qui veulent décider ensemble de leur destin — ce qui s’appelle démocratie. Pourquoi ne pas inciter les « gilets jaunes » à migrer pour qu’ils ne troublent pas la « start up économie » ? S’ils ne sont pas contents, qu’ils partent ! Et voilà comment l’idéologie du nomadisme assure la mainmise totale de l’économie sur la société et les territoires.
6 — « Les migrations stimulent l’économie »
Que de belles âmes volontiers dites humanistes évaluent les bénéfices et les coûts de l’immigration renouvellent sans le mot, les discours lénifiants sur les trafics d’esclaves de jadis. L’argumentation poussive qui veut que les migrations rapportent aux pays dits « d’accueil » est indécente. Les esclaves aussi étaient la condition d’économies agricoles florissantes.
Considérer les hommes, évaluer les hommes, comptabiliser les hommes, selon leur compte de résultat et décider selon le solde s’il faut ou non accueillir les migrants, et combien, et qui, renouvelle l’esclavage, le trafic des hommes, et crée sans le dire un marché mondial des hommes. Une Europe qui a compté par dizaines de milliers les siens vendus comme esclaves par les Barbaresques devrait le savoir ; le retour du commerce des hommes signifie un retour historique de grande ampleur, dans lequel ce qui s’est appelé civilisation, démocratie, et citoyenneté, se dissoud en même temps que la sécurité morale, culturelle et civique que les Nations prodiguaient à leurs citoyens.
7 — « Un homme est partout chez lui »
L’air conditionné, l’énergie à bon marché et l’eau au robinet produisent cette illusion ; l’homme est sorti de la géographie. Cette illusion est aussi une négation, celle de la culture, cette médiation entre la liberté humaine et les conditions que le climat, la végétation, les animaux, le relief et les saisons imposent à son établissement comme Philippe Descola la si bien illustré. La technique prétend assurer le triomphe de l’histoire sur la géographie et assurer l’avènement de ce monstre ; l’homme de nulle part, l’homme hors sol, qui est aussi l’homme des droits de l’homme. La réalité est que l’homme est un animal territorial. La réalité est que la vie humaine dépend de l’invisible et permanente tâche de celles et ceux qui travaillent à transmettre à leur enfant et leurs petits-enfants une terre plus belle, plus riche et plus vivante que celle qu’ils ont reçue de leurs parents. Voilà qui avertit ; l’homme qui est partout chez lui n’est un homme ni de culture ni de conscience, c’est l’homme de ses intérêts, un homme sans responsabilité et sans engagement, un homme de rien, que le vent de l’histoire balaiera comme il réduira les capitales du désert aux carcasses d’acier et de verre qu’elles sont déjà.
8 — « Nous sommes tous nomades »
C’est le rêve du capitalisme mondialisé ; faire de chacune, de chacun, des nomades, afin que la terre, l’air, l’eau, la vie, les hommes, soient des actifs comme les autres, à vendre à leur prix sur le marché mondial. Ce rêve a une réalité ; le nomade est l’homme de la terre brûlée, celui qui épuise les ressources d’une terre à laquelle rien ne l’attache, pour aller plus loin réaliser le même exploit. Le nomade n’assume aucune responsabilité territoriale. Il détruit ce que le sédentaire conserve. Voilà un idéal moderne ; que plus rien nulle part n’échappe à la loi du rendement maximum !
Le véritable ennemi de la finance mondialisée n’a rien à voir avec les figures du socialisme, du révolutionnaire, de l’anarchie. Bien au contraire ! C’est l’homme de chez lui et des siens, l’homme d’une foi, d’un honneur et d’une fidélité. Celui qui sait que les choses qui comptent n’ont de prix sur aucun marché du monde, mais que ce sont les choses qui se donnent et se transmettent, les choses pour lesquelles tuer ou mourir, celui qui sait ce que signifie le sacré, celui-là est l’ennemi final. Et rien n’est épargné pour faire de nous des hommes hors sol, pour nous arracher à nos territoires, à notre identité, et à l’idée folle que nous nous devons d’abord de demeurer ce que nous sommes.
Hervé Juvin (Site officiel d'Hervé Juvin, 26 avril 2019)