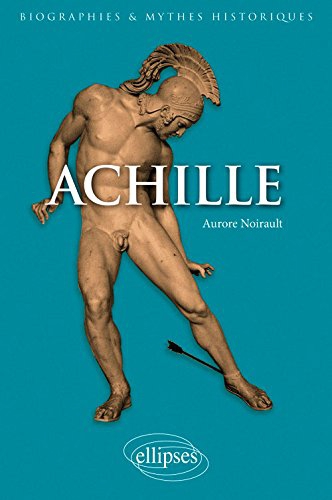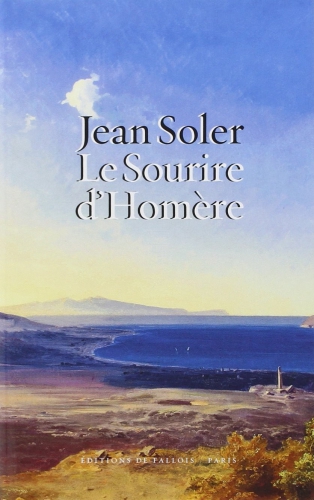L’idéologie Big Other, les autres avant les nôtres
Vous connaissez le Big Brother de George Orwell – il a acquis une notoriété mondiale ; vous avez entendu parler de Big Mother qui décrit indifféremment les nouvelles sociétés matriarcales ou la sollicitude maternante de l’Etat poule ; mais si vous n’avez pas lu la réédition du Camp des saints, vous ne connaissez peut-être pas Big Other, le Grand Autre, le Tout Autre. Big Other, c’est le nom que Jean Raspail a donné à la nouvelle religion des temps modernes : la religion de l’Autre, du lointain, de la différence.
Comme dans 1984, Big Other s’est doté d’une novlangue – la rhétorique des droits de l’homme –, d’un parti – le parti du Bien – et d’un système de surveillance : l’implacable surmoi antiraciste que nous sommes censés avoir intériorisé et qui fonctionne comme un tribunal de la conscience. Le tout dessine la religion de l’Autre, ce qu’on appelle en philosophie l’altérité. L’altérité, c’est l’autre compris comme ce qui est extérieur à soi.
Mais c’est là justement où le bât blesse : l’autre n’est désormais plus extérieur à soi, c’est nous-mêmes qui sommes devenus extérieurs à notre propre tradition, à notre nature historique, à notre être authentique, étrangers, pour ainsi dire, à notre propre culture. L’amour de l’autre – un amour excessif, malsain, morbide – est exclusif : il implique de renoncer à la possession de soi pour adopter, sinon épouser, le seul point de vue de l’autre.
L’étranger élevé au rang de modèle
Il ne s’agit pas de le nier, cet autre. C’est à lui que nous devons d’exister en tant que communauté singulière, en tant que non-autre, selon l’arithmétique de l’identité, qui procède par discrimination et retranchement, mais de constater que lui seul a désormais droit de cité. Il a pris toute la place. C’est la seule parole autorisée. Assorti d’une majuscule, l’Autre est devenu, sous les espèces de l’idéologie des droits de l’homme et de l’antiracisme, une logomachie d’autant plus tyrannique qu’elle est philosophiquement inconsistante. Il y a un enfer et un paradis. Il y a la haine de soi et son corolaire l’amour de l’autre, l’une étant la condition de l’autre.
C’est là un nouveau chapitre du nihilisme européen, le « plus inquiétant de tous les hôtes », dit Nietzsche. C’est une maladie létale qui s’est emparée de l’âme européenne. La haine de soi en est le principe actif : idéalisation du non-identique, survalorisation de l’étranger, fétichisation de l’Autre. Dans tous les cas, Big Other est notre créancier et nous lui sommes indéfiniment redevables. Tel est désormais « le fardeau de l’homme blanc », non plus la responsabilité endossée par Kipling, mais la culpabilité. Résultat : on va passer notre temps à nous excuser et à les excuser.
Car il ne faut pas se leurrer. Si la discrimination positive n’existe pas encore formellement dans les textes, elle est omniprésente dans les têtes, consciemment ou inconsciemment. L’étranger a été élevé au rang de modèle. Toute la société est traversée par un désir de l’Autre. Ce désir se traduit de mille façons. Aujourd’hui, la mode est de dire qu’il y a trop d’hommes blancs partout, dans le cinéma, aux Oscars, à la télévision, dans le monde de l’entreprise ou de la politique. Hier, c’était de s’extasier sur Obama, qui, sur la seule couleur de sa peau, bénéficiait d’une présomption d’innocence et d’un préjugé d’excellence. Tous les mois, c’est le baromètre des présumées personnalités préférées des Français (les Omar Sy, Yannick Noah et autres Zinedine Zidane). Ce sont des baromètres prescripteurs : ils ne disent pas la température qu’il fait, mais celle qu’il doit faire.
La société est obsédée par les minorités visibles, sans voir que ce sont les majorités qui deviennent invisibles. De fait, plus du quart du corps électoral n’a aucune représentation médiatique sans que cela offusque les belles âmes. Et que dire du quasi-monopole de la gauche culturelle dans les médias ? Le problème n’est donc pas savoir s’il y a trop de Blancs ou non à la télévision, c’est qu’ils professent tous les mêmes idées.
Quelles sont-elles, ces idées ? L’antiracisme, l’hypertolérance, la xénophilie – en un mot, l’amour de l’Autre. Même un chercheur comme Pierre-André Taguieff a été jusqu’à parler d’une disposition xénophile érigée en norme par les formes contemporaines de l’antiracisme. Mais Taguieff est bien seul. Autant le racisme a été décrypté de long en large, désossé, psychanalysé, pathologisé et même et surtout judiciarisé, autant l’antiracisme est resté vierge. C’est une terre inconnue pour la recherche universitaire. Ce qui fait qu’on a étudié jusqu’à la nausée la haine des étrangers, mais pas l’amour de l’étranger. Il y aurait pourtant fort à faire, tant cette xénophilie a pris dans notre monde un caractère hégémonique.
La religion de l’antiracisme
Car qui préside aux destinées morales de notre monde, qui contrôle nos consciences ? L’antiracisme, rebaptisé par Alain Finkielkraut « le communisme du XXIe siècle ». Il fonctionne comme une idéologie de rechange au marxisme. La continuation du trotskisme par d’autres moyens. Construire une société sans race (et non plus sans classe), dans laquelle l’homme serait un agneau pour l’homme. Un vrai conte de fée. La Fontaine se serait contenté d’en tirer une fable. Nous, on en a fait une religion.
C’est Hitler qui l’a ironiquement inventée. Sans lui, pas de sociétés multiraciales. C’est l’épouvantail qu’on agite sans cesse pour faire plier les peuples. En le mettant à mort rituellement, hystériquement, en l’exorcisant sans cesse, on n’en finit pas de ressusciter son fantôme. Ce qui fait que Hitler est devenu plus important mort que vivant. C’est « la deuxième carrière » du chancelier, dont Renaud Camus a jeté les contours dans un texte magistral. Sa carrière posthume, de loin la plus remplie, celle qu’il a commencée comme revenant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, venu hanter les consciences européennes. L’astre noir qui a entraîné une longue éclipse de la raison et du sens commun – et qui nous enjoint d’accueillir l’Autre – en l’occurrence les migrants – comme une armée de libérateurs, au cri de « willkommen » !
De quoi nous libère-t-il ? De notre mauvaise conscience. C’est la première fois qu’une armée d’occupation est reçue en libératrice. Les journalistes, les artistes – les « artistrocrates », disait Philippe Murray, qui méprisent le tiers état que nous sommes –, les enseignants, les travailleurs sociaux, tout ce pandémonium de traîtres de comédie, de démons de petite envergure, de pharisiens de la bonté, de gnous interchangeables, en appellent à l’esprit d’humanité, au besoin devant les tribunaux. Impossible d’allumer son poste sans tomber sur l’un d’entre eux. On se croirait au prêche et à confesse. Quand on a entendu l’un, on a entendu l’autre. C’est le conformisme à tous les étages. Ils raisonnent comme les bancs de sardines se déplacent, sans dévier d’un iota de la ligne du Parti. Pas un pour racheter l’autre. C’est la pensée gramophone, disait Orwell. Ils tournent en boucle, ils récitent leur gloubi-boulga sur la diversité, leur prêchi-prêcha « citoyen ». Un embouteillage de bons sentiments et d’idées courtes. La combinaison moléculaire de l’ignorance et de l’arrogance. Tout y passe. Un vrai défilé. Les tartes à la crème de l’antiracisme, les lieux communs victimaires, les clichés sur le misérabilisme et j’en passe.
Alors, d’où vient cette langueur qui s’est emparée de l’âme européenne, cette mollesse dans laquelle elle se dissout comme dans une solution émolliente ? Eh bien, Big Other, ce que Jean Raspail a récemment appelé Big Other, a une longue et vieille histoire, mais jusqu’à peu cette histoire n’avait pour ainsi dire aucune incidence. Ce n’est que depuis un demi-siècle qu’elle a pris une importance démesurée.
Généalogie du mal
Quitte à remonter loin dans le temps, difficile d’occulter le début de notre ère, marqué par l’avènement du christianisme, qui va donner lieu à une première expression de l’autre contenue dans l’amour évangélique du prochain. Mais on fera justement valoir que le prochain n’a jamais exclu l’amour du proche, ni l’amour du même. Et du reste, cette nouvelle religion – l’idéalisation de la figure de l’autre, qui emprunte indiscutablement de nombreux motifs au Nouveau Testament – s’est déployée dans un monde tardif, crépusculaire, largement postchrétien, en tout cas déchristianisé ou en passe de le devenir.
Je crois plutôt, s’il faut assigner un commencement à cette histoire, qu’il faut la faire démarrer au choc qu’a constitué la découverte de l’Amérique. Il y avait certes jusque-là des étrangers sous les traits du barbare : le Romain pour le Grec, le Germain pour le Romain, le Maure pour le chrétien, le Mongol pour le Vénitien Marco Polo. Mais pour découvrir l’Autre, le tout autre, l’altérité radicale, il faut attendre 1492 et Christophe Colomb : la découverte, au sens fort du mot, de l’Amérique, laquelle a produit en retour un électrochoc. C’est dans ce contexte, celui de la découverte du Nouveau Monde, qu’il faut se situer pour comprendre comment la figure de l’autre est entrée en collision avec la conscience européenne, ou plutôt l’inverse. Pour le meilleur et pour le pire.
En France, c’est Montaigne, le grand Montaigne, qui en sera le premier interprète – on pourrait presque dire le premier théoricien. Montaigne renverse, et il a quelques raisons de le faire, le couple du civilisé et du barbare, du Même et de l’Autre, dans un célèbre passage de ses Essais, intitulé « Des cannibales » (notez qu’en Espagne, vous avez un peu plus tôt Bartolomé de Las Casas, qui se range du côté des Indiens, lors de la controverse de Valladolid). Montaigne s’inspire d’un bref épisode de la colonisation française du Brésil, ce qu’on appelait alors la « France antarctique », pour démontrer combien l’Europe civilisée plongée dans les guerres de religion n’est pas moins barbare que les peuplades anthropophages du Sud, sinon plus, parce que celles-ci se contentent de rôtir occasionnellement des corps pour les manger, alors que nous dressons des bûchers pour les brûler, en attendant qu’ils rôtissent en enfer.
Montaigne pose les éléments de langage de ce qui deviendra bien plus tard, en philosophie et en anthropologie, l’altérité. Ils fleuriront au XVIIIe siècle, second acte de naissance, quand les Lumières – et avec elles la bonne société – vont broder autour du thème du bon sauvage, des bergeries champêtres et des robinsonnades à la Paul et Virginie. Des rêveries de songe-creux, ce qu’étaient alors les salons de l’aristocratie. C’est ce monde-là que Rousseau a pris pour cible dans son Émile : « Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres des devoirs qu’ils dédaignent de remplir autour d’eux. Tel philosophe aime les Tartares, pour être dispensé d’aimer ses voisins. »
Les XIXe et XXe siècles vont poursuivre ce rêve de virginité et d’innocence aux antipodes. Songez à Gauguin en Polynésie, Stevenson aux Samoa, au stupéfiant et si ironiquement prémonitoire Les Immémoriaux de Victor Segalen qui retrace la façon dont les Tahitiens ont trahi leurs dieux pour épouser les nôtres (en vérité, c’est ce qui menace de nous arriver, à nous Européens, d’épouser le Dieu, les us et les coutumes, le langage, de notre colonisateur – l’Autre). On peut ajouter à cela la découverte des arts primitifs en pleine crise des arts au début du XXe siècle.
Les effets pervers du relativisme culturel
Mais toute cette généalogie de l’Autre serait restée sans conséquence, politiquement parlant, si on s’en était tenu à un éloge de l’exotisme, du bucolique et du lointain. Dans l’opération, on aurait découvert non seulement l’Autre, mais aussi l’existence d’une pluralité des mondes. En sortira la notion de relativisme culturel. Vous la connaissez. Toutes les cultures se valent. Le relativisme culturel, la critique de l’ethnocentrisme, n’appartiennent en propre qu’à l’espace occidental. Vous n’entendrez aucun natif, aucun indigène, de quelque culture qu’ils soient, affirmer que toutes les cultures se valent. Au contraire, ils discriminent les cultures suivant un ordre de préférence. D’ordinaire, les sociétés ont tendance à valoriser leur propre culture et à dévaloriser celles de l’étranger (sauf rares cas de fascination).
A bien des égards, ce relativisme culturel fonde la supériorité de l’Occident. Cette supériorité, c’est de douter de sa propre supériorité. C’est là un trait éminemment socratique. Au commencement de la philosophie grecque, il y a une démarche critique, elle-même à l’origine de la méthode scientifique. Elle arrache la communauté au cycle des déterminations, au risque de se perdre dans un relativisme ambiant. Toute la philosophie grecque est traversée par la tentation du scepticisme, même chez Socrate. Mais Socrate nous met néanmoins en garde contre le scepticisme des sophistes. Son doute sera de bon aloi. Il consistera à dire qu’il sait qu’il ne sait pas. Il faut retenir la leçon. Si le propre de l’Europe, c’est la démarche critique (et par là même autocritique), cette démarche doit rester positive, constructive et s’arrêter au seuil de l’autodénigrement. « Il est bon qu’une nation soit assez forte de tradition et d’honneur pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs, disait Albert Camus dans ses « Chroniques algériennes ». Mais elle ne doit pas oublier les raisons qu’elle peut avoir encore de s’estimer elle-même. Il est dangereux en tout cas de lui demander de s’avouer seule coupable et de la vouer à une pénitence perpétuelle. »
Cette pénitence affectera les sociétés européennes après 1945. En marge du marxisme et à la veille des décolonisations, un nihilisme textuel, sous les traits de la théorie critique, gagne les esprits. L’altérité et la différence envahissent peu à peu le champ philosophique. Dans la foulée, la théologie devient expiatoire, la sociologie misérabiliste, l’ethnologie doloriste.
L’Université se met au goût du jour, avant de diffuser ce nihilisme textuel dans la sous-culture médiatique. Mention spéciale à la sociologie, qui va traquer les représentations et les stéréotypes de l’étranger, sans voir qu’elle va elle-même construire de nouvelles représentations et imposer un stéréotype positif de l’étranger, pour en dernière analyse célébrer l’étranger en nous. Car nous sommes tous des immigrés, nous sommes tous des étrangers.
Un homme va jouer un rôle de premier plan, par le prestige dont il jouit : Jean-Paul Sartre. Il va complaisamment endosser le rôle naguère tenu par les frères flagellants qui sévissaient au Moyen Age aux marges de l’hérésie. Mais Sartre ne pouvait pas se flageller longtemps, il lui a fallu flageller les autres. C’est lui qui va populariser un thème à la riche postérité, celui de la dette, « nouvel œcuménisme de la pénitence » (George Steiner). Des croisades jusqu’aux colonisations, l’Europe aurait contracté une dette infinie à l’égard du reste du monde. Il ne fait aucun doute que l’irruption de la civilisation technicienne a été une catastrophe pour l’ancien monde. Qui le niera ! L’ancien monde a disparu, mais il a disparu ici et là-bas, non pas seulement aux antipodes, mais en Europe aussi. Or, l’ethnologie ne pleure que le deuil du lointain, pas celui de la civilisation rurale et paysanne européenne, pas l’ancien monde féodal et plébéien d’Europe. C’est bien simple : cet univers n’existe pas dans cette vision du monde ethno-décentrée.
Sartre et les autres…
Il n’est qu’à lire la préface de Sartre aux Damnés de la terre de Frantz Fanon. Un monument de haine de soi et d’insincérité. L’homme blanc y est essentialisé, lié par une chaîne de responsabilité collective, et finalement crucifié. Repens-toi, leucoderme. Au besoin, disparais, comme Sartre l’y invite : « abattre un Européen, c’est faire d’une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé : restent un homme mort et un homme libre ».
Sartre tourne autour du thème de la felix culpa, de la « faute délicieuse » avec une sorte d’exaltation morose. C’est ce que le psychanalyste Daniel Sibony appellera plus tard la « culpabilité narcissique » : on affiche une culpabilité superlative, mais c’est précisément pour s’en exonérer à titre individuel et afficher une générosité sans égale, au-dessus de tout soupçon. Ainsi conçue, la haine de soi donne à celui qui la professe un sentiment de supériorité. Sartre excellera dans ce registre. A sa décharge, il avait beaucoup à se faire pardonner, son amour de Heidegger et ses pièces de théâtre sous l’Occupation.
La question qu’on est en droit de se poser, c’est celle de l’authenticité de leur engagement. Y croient-ils réellement, Sartre et les autres ? Comment démêler la part de comédie et de sincérité dans leur célébration de l’Autre – et aujourd’hui dans la rhétorique pro-migrants ? J’écarte les militants de terrain, qui, eux, sont politiquement identifiés. Ce sont les métastases du trotskysme, les mouvements « sans » (sans-papiers, sans logement, etc.), le reliquat des chrétiens de gauche. Le gros des troupes est ailleurs, parmi les bobos. On peut parier que les bobos se jouent une comédie et que cette comédie est devenue à l’usage pareille à une seconde nature. Elle les installe dans le confort des positions moralement irréprochables, des postures exemplaires. De là à dire que c’est une culpabilité frelatée, une fiction de culpabilité, il n’y a qu’un pas… qu’il faut franchir pour la majorité d’entre eux. Voici ce que dit Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem, son tonitruant reportage, à propos de l’anti-antisémitisme des jeunes Allemands après-guerre (et sa remarque est plus que jamais d’actualité) : « Ces sentiments de culpabilité, autour desquels on a fait tant de publicité, sont nécessairement factices. Il est presque agréable de se sentir coupable quand on n’a rien fait : l’on se sent alors plus noble ».
Il y a un effet pervers à l’œuvre dans les mécanismes compassionnels qui sont brandis par les journalistes pour nous prendre en otage. C’est celui de conférer aux victimes un caractère exclusivement vertueux. Et a contrario d’attribuer aux coupables de fait (vous, moi, nous) un caractère exclusivement égoïste. C’est un chantage redoutablement efficace, puisque cette escroquerie aux bons sentiments a des vertus performatives : sauf à passer pour un salaud, vous n’allez pas vous opposer à l’accueil des réfugiés. La grande presse ne s’y trompe pas, elle ne mobilise que le levier de la compassion, qu’elle sait le plus puissant. Tout le reste est passé sous silence. Rien sur les passeurs, rien sur les mafias, rien ou si peu sur la surreprésentation masculine, rien ou si peu sur les djihadistes qui s’infiltrent dans les colonnes des migrants, rien sur la menace de guerre civile qu’un trop plein migratoire fait peser sur nous. Mais les médias sont les médias. Comme on disait pendant la Seconde Guerre mondiale, Radio Paris ment, Radio Paris est migrant !
« L’antipopulisme » de gauche
Poursuivons la généalogie de Big Other. Dans un livre qui a fait beaucoup de bruit à sa parution, en 1993, Voyage au centre du malaise français. L’antiracisme et le roman national, Paul Yonnet a démontré comment et dans quel contexte de désaffiliation nationale, de crise de l’identité française et d’effondrement de la culture ouvrière, l’antiracisme – expression idéologique du culte de l’Autre – s’est déployé. Officiellement, il a vu le jour dans les années 80 avec SOS Racisme. Mais il a une histoire plus ancienne dans laquelle Mai 68 a été un jalon décisif. C’est la naissance de l’antipopulisme de gauche, « la révolte des élites », selon l’historien Christopher Lasch. Sur les barricades, le mythe ouvrier s’est effondré. L’ouvrier a failli. Il est apparu comme culturellement conservateur, sans esprit de classe et insensible à l’imaginaire prophétique et révolutionnaire de la gauche. Pour preuve, les grilles de l’usine Renault de Billancourt sont restées fermées aux étudiants quand ces derniers sont venus appeler les ouvriers à les rejoindre. La Commune étudiante n’est ainsi pas parvenue à accoucher d’une nouvelle Commune de Paris. Le monde ouvrier lui a adressé une fin de non-recevoir.
Ce que les gauchistes ont raté avec les classes populaires, ils vont s’efforcer de le réussir avec une nouvelle figure : le travailleur immigré, ou la rédemption par l’immigration. L’internationalisme venait de trouver son nouvel allié. C’est d’ailleurs à ce moment, début des années 1970, que Sartre et Foucault défilent à la Goutte-d’Or. L’immigré s’offre alors à tous comme un agent de déconstruction des identités. Il en est même le dispositif central.
Inversement, l’ouvrier devient un « beauf » selon Cabu, un « Français moyen », un « petit Blanc », un « Franchouillard ». De Dupont Lajoie à Canal Plus, des Deschiens à la Présipauté de Groland, c’est un même mépris d’une France présumée moisie, poujadiste et maréchaliste. Cette France d’en bas, déjà périphérique, est infériorisée selon les termes mêmes du racisme biologique. Ne manque que l’intentionnalité scientifique, mais pour le reste tout y est. C’est sur le plouc que se fixent désormais les stéréotypes racistes. Lâche et xénophobe, c’est une France génétiquement douteuse qu’on exhibe dans une perspective quasiment zoologique. Il ne manque que le pavillon colonial des expositions universelles pour s’y croire.
En résumé, prolophobie et xénophilie seront les deux mamelles de l’antiracisme.
Dans le même ordre d’idées, les années 1960-1970 sont aussi celles qui voient le triomphe du minoritaire. C’est au majoritaire qu’on va désormais demander des comptes. Le majoritaire est trois fois coupable : en tant que mâle (c’est le procès en misogynie), en tant qu’hétérosexuel (c’est le procès en homophobie), en tant que Blanc (c’est le procès en racisme). A défaut de le castrer chimiquement, on va le castrer textuellement, médiatiquement et finalement juridiquement.
Parallèlement, les années 70 voient fleurir une nouvelle génération d’historiens, dans la foulée de Robert Paxton, qui, à longueur de livres, va instruire le procès d’une France ataviquement antisémite, collabo et colonialiste. En est sortie la légende noire de Vichy, qui aboutira au fameux discours de Chirac sur la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs, en 1995. Un ressort, essentiel dans la psychologie des peuples, s’est cassé : l’estime de soi.
Ainsi posées, les années 1950 sont celles de la diffusion à grande échelle des travaux de l’ethnologie, avec pour conséquence la réévaluation de l’Autre et la dévaluation du Même. Les années 1960 sont celles de la déconstruction de la figure ouvrière et de la construction d’une utopie de substitution : l’immigrationnisme. Les années 1970, celles de la destruction de la mémoire nationale. Les années 1980, celles de l’antiracisme militant. Les années 1990, celles de la repentance des institutions. Les années 2000, celles de la promotion des minorités visibles et de la diversité. Quel accusé survivrait, je vous le demande, à une telle avalanche de charges ?
L’utopie de l’homme-monde
Mais ce n’est encore qu’une étape, parce que le terme du terme pour les déconstructeurs, celui qui doit voir le dernier étage de la fusée se détacher, c’est le déracinement universel : l’utopie de l’homme-monde. Ainsi la diversité elle-même est-elle à son tour appelée à s’évanouir. Comment en irait-il autrement dans une société mondialisée ? Premier moment : la mondialisation nous fait découvrir la pluralité des mondes ; second moment, cette même mondialisation abolit cette diversité en imposant un modèle unique de développement. « L’humanité s’installe dans la monoculture ; elle s’apprête à produire la civilisation en masse comme la betterave » (Lévi-Strauss, Tristes tropiques). Autrement dit, on a fait la promotion de la différence, mais c’était pour produire une société indifférenciée. Le monde doit redevenir une soupe originelle indifférenciée, un magma en fusion-confusion, où il n’y aura plus que des créatures hybrides, post-identitaires, accrochées à leur tour de Babel vacillante.
La chimère qui inspire cette vision des choses, c’est encore et toujours l’unification du genre humain, mais pour advenir, cette chimère doit au préalable abolir l’humanité historique de l’homme. Le genre humain ne s’unifiera qu’à la condition de substituer à l’homme enraciné dans la géographie et l’histoire un homme générique. Dans cette opération d’alchimie à l’envers, l’Europe et la France au premier chef ont vocation à accomplir le projet des droits de l’homme, qui suppose le dépassement et de la France et de l’Europe – ou leur universalisation. Et l’une et l’autre ne pouvant exister qu’à la condition de se désubstantialiser pour se diluer dans le grand Tout. L’Europe, celle de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe, est absence de territoires, no borders, no limits. Non pas un territoire, mais une idée : l’impolitique des droits de l’homme. On voit par là combien notre continent est devenu fou. On pourrait presque dire, à la manière de Chesterton, que le monde est plein d’idées européennes devenues folles.
Il ne faut donc pas se tromper. Si l’Autre n’a pas encore été relégué au rayon des antiquités, s’il demeure le véhicule d’une identité et d’une appartenance, son avenir est compté. L’Autre, le tout autre, désormais, c’est le devenir nomade, l’homme off-shore en train de poindre, la créature en transit, ces « multitudes » chères à Toni Negri et à la gauche radicale. Cette chimère libérale-libertaire, c’est à la fois le fantasme des trotskystes et des néolibéraux, de la révolution permanente promue par le père de la IVe Internationale et des sociétés ouvertes dont Karl Popper a fait l’éloge. C’est à la fois le projet des Lumières françaises et des Lumières anglo-saxonnes, de Kant et d’Adam Smith, des droits de l’homme et de la logique du capital, de la paix perpétuelle et de l’extension sans fin du marché. La dilution dans le tout et un tout réduit au même. La généralisation de la libre circulation – des hommes, des biens et des capitaux. L’internationalisation des flux, le désordre croissant, l’entropie. En un mot, le chaos.
Le but poursuivi ? Créer une société panraciale, panethnique. L’Autre n’est en définitive qu’une sorte d’objet transitionnel qui offre la possibilité de dépasser l’identité. Il y a un fantasme d’abolition, de disparition, dans l’autre, par l’autre. Et de prêcher par l’exemple, je veux parler des Européens. Mais c’est là un échange inégal. Car l’autre – le migrant, en l’occurrence – ne veut pas transcender son identité dans une post-identité mondiale, il veut au contraire la conserver et pourquoi pas l’imposer.
Mais les promoteurs du tout-monde n’en ont que faire. Un fait significatif : on ne parle plus de négritude dans les littératures africaines et antillaises complètement contaminées par les « cultural studies » états-uniennes. C’est une conception trop barrésienne, trop suprématiste, de l’africanité et de la négritude, celle du roi Senghor et d’Aimé Césaire, Césaire le bien aimé. La négritude a disparu au profit d’une mosaïque de motifs ; elle est devenue migritude. C’est la créolisation du monde, objectif avoué des études postcoloniales. Le tout-monde, les poétiques du divers, l’éloge de la bâtardise et de tous les syncrétismes. Dans l’univers de la migritude, ne règne plus que des processus d’hybridation et de métissage. Le modèle visé, c’est le Brésil et la Caraïbe. On commence d’ores et déjà à parler de transmigrants (Alain Tarrius), des populations en perpétuelle migration, comme les caravaniers d’autrefois, qui voyagent au gré des opportunités économiques ou sociales. C’est le rêve de l’OMC et de l’ultragauche, d’Alain Minc et de Jacques Attali.
Notre droit à la différence
Alors que faire, comme disait Lénine ? Porter la guerre sur le terrain de la culture, renverser le rapport des forces culturelles, largement en notre défaveur. Pour cela, s’approprier le langage de la différence que nos adversaires ne sont plus en mesure de tenir. Faire valoir notre droit à la différence. Lévi-Strauss nous a montré la voie lorsqu’il dit que les sociétés doivent se protéger les unes des autres. On ne peut pas avoir de diversité (impératif des sociétés multiraciales), sans concéder que « cette diversité résulte pour une grande part du désir de chaque culture de s’opposer à celles qui l’environnent, de se distinguer d’elles, en un mot d’être soi ». C’est le paradoxe que Lévi-Strauss a soulevé dans sa seconde conférence à l’UNESCO, Race et culture, qui a fait scandale. Si l’on veut protéger les cultures dans leur diversité, il faut donc qu’elles « veillent sur leurs particularismes », qu’elles conservent « une certaine imperméabilité ». Lévi-Strauss va même jusqu’à parler de la nécessaire indifférence des cultures les unes pour les autres. Chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés ! Mais il y a fort à faire. Car s’ils sont chez eux chez nous, comme l’a dit en son temps François Mitterrand, c’est que nous n’y sommes plus. Et si nous y sommes toujours, c’est qu’ils n’y sont plus, comme eût pu dire La Palice. Il reste donc beaucoup de chemin à parcourir.
Vous connaissez la phrase du grand juriste Carl Schmitt : Est souverain celui qui décide la situation d’exception. Eh bien, permettez-moi de corriger Schmitt, avec un peu de forfanterie. En vérité, est souverain celui-là seul qui maîtrise le champ symbolique des interdits ; est souverain celui qui dit le licite et l’illicite ; est souverain celui qui a le pouvoir de nommer le Totem et de désigner le Tabou. Il n’y a pas d’autre souveraineté. Ou plutôt : la souveraineté politique procède de cette souveraineté symbolique.
Or, et vous en conviendrez, cette bataille n’est pas gagnée, même si l’édifice prend l’eau de toute part, même si le glacis de mensonges craquelle, même si la parole se libère (quelle expression symptomatique, presque de l’ordre du lapsus linguae : si la parole se libère, c’est donc qu’elle était muselée).
C’est cette guerre, d’abord et avant tout culturelle, qu’il nous faudra gagner pour préserver et transmettre le sol très aimé de la patrie, selon le mot de Hölderlin en ouverture de son Hypérion. « Une fois encore, le sol très aimé de la patrie me donne joie et douleur ». Peu importe que la patrie soit charnelle ou mythique, c’est la nôtre.
François Bousquet (Colloque Iliade, 9 avril 2016)